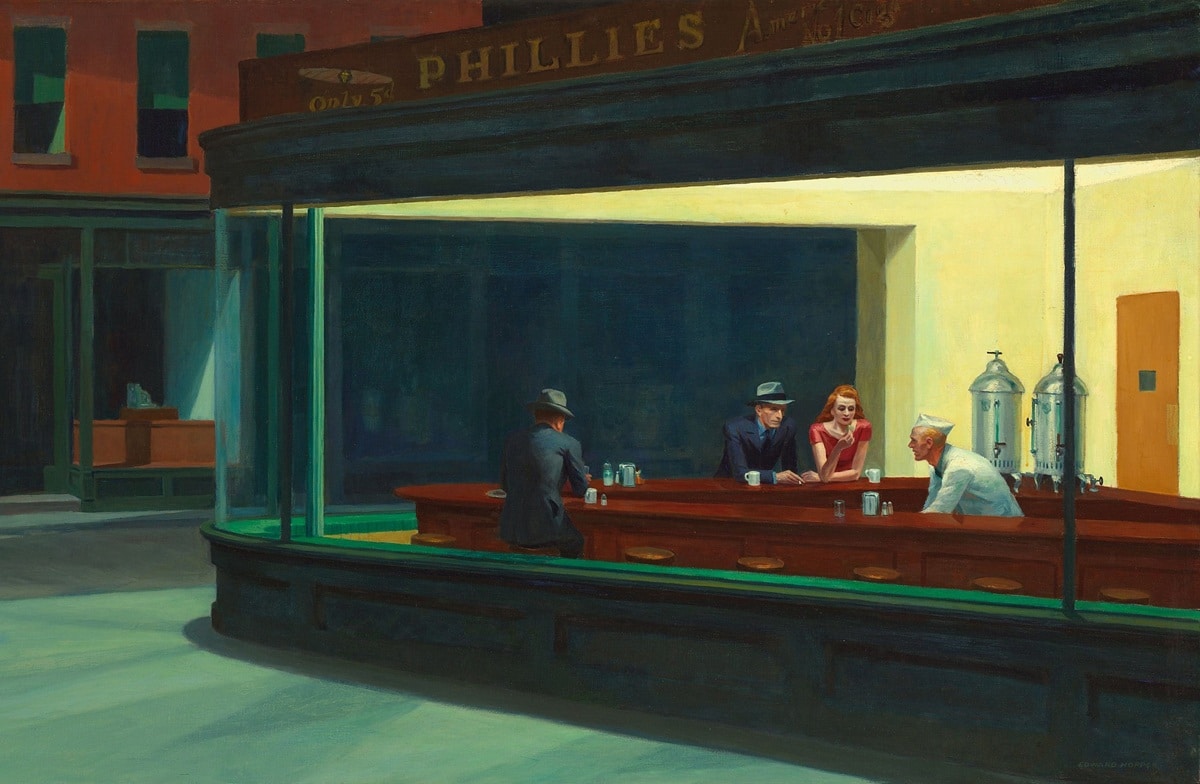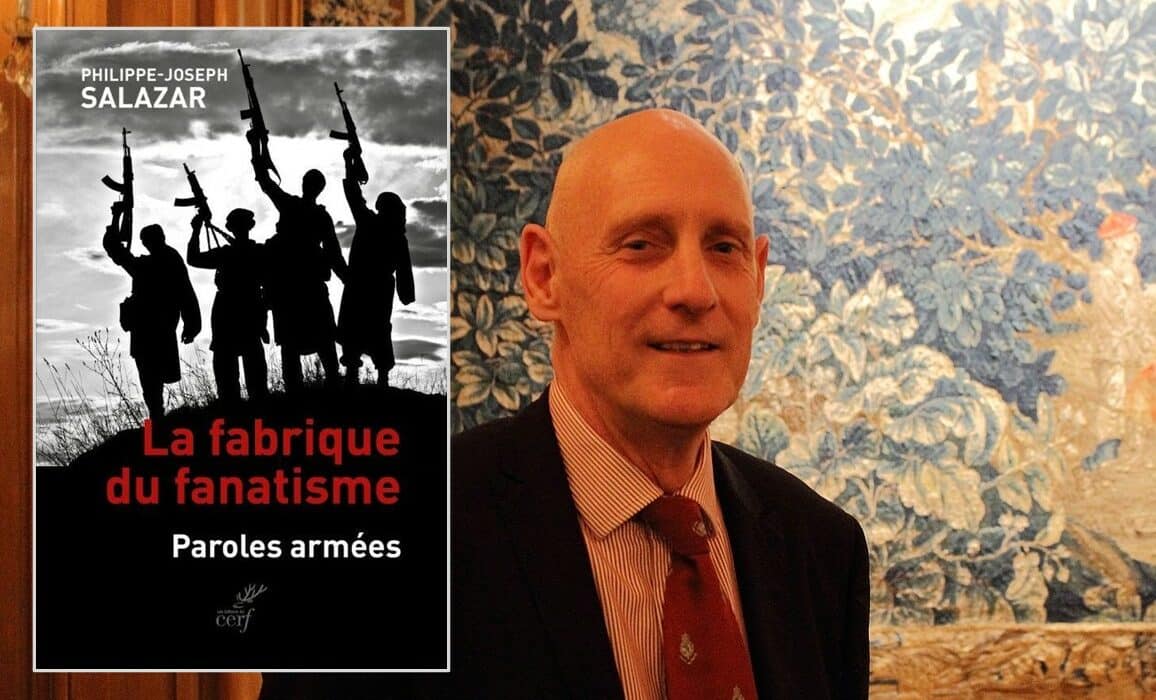J’ai participé, ces dernières années, au conseil de développement de l’intercommunalité où je réside. Il s’agit d’une instance participative, constituée (dans mon cas) sur la base du volontariat, qui étudie des questions et formule des avis ou des préconisations sur divers projets portés par l’intercommunalité. Il semblerait que ce type de structure énerve certains sénateurs, qui ont tenté de supprimer leur caractère obligatoire. C’est assez paradoxal, à l’heure où tout le monde se rend compte du fossé grandissant entre les acteurs politiques et les citoyens.
Ce fossé, pour ce qui me concerne, ne cesse de me questionner. Je ne le ramène pas au « mauvais exemple » que donnerait la classe politique. Il a, j’en suis convaincu, des racines bien plus profondes.
L’approche gestionnaire et technique des questions est excluante
Il faut faire feu de tout bois si on veut renouer les liens. Toutes les tentatives de participation sont bonnes à prendre. Mais elles ne touchent, de loin pas, tous les milieux sociaux. Si je fais le compte des membres du conseil de développement (auquel je participe) qui ont « tenu » pendant toute la durée du mandat, je pense que le niveau de diplôme moyen ne sera pas éloigné du master ! À l’occasion de certains chantiers, nous avons tenté d’associer des personnes moins diplômées. Avec des modes d’animation appropriés, il a été possible de leur donner la parole, mais pas vraiment sur le long terme. Elles se sont vite découragées, ne se sentant pas à leur place, ou « au niveau », et ne parvenant pas à faire réellement entendre ce qu’elles pensaient avec leurs mots.
Il s’agit là d’un écueil que beaucoup de spécialistes de la participation ont pointé du doigt. On m’a signalé, récemment, un article relativement ancien (2005), mais tout à fait suggestif, qui analyse la manière dont le parti socialiste s’est coupé de l’électorat populaire dès la fin du XXe siècle[1]. Les auteurs pointent deux évolutions majeures. Tout d’abord la gestion municipale ou locale, prise en charge par beaucoup d’élus, dont la technicité a rendu plus neutres, moins riches de sens, aux yeux des militants, les projets mis en œuvre. Et qui dit plus technique, dit aussi plus éloigné des perceptions spontanées de tout un chacun. Le deuxième point dur est la focalisation (implicite) sur un type de parole admissible, qui s’éloignait du témoignage direct pour viser d’emblée une formulation en termes de projet. Je cite, ici, deux extraits de l’article : « Nos observations à Lille montrent que les militants d’origine populaire tendent à déserter les assemblées générales qu’ils jugent trop complexes ». Et : « ces règles nouvelles de démocratie interne qui se développent au nom de l’ouverture sur la société civile ont des effets intimidants et excluants sur les adhérents d’origine populaire ou faiblement diplômés ». « Intimidants » et « excluants » sont deux mots forts, mais justes.
La parole populaire n’est pas une parole mal formée, c’est une parole différente
Au-delà du cas du parti socialiste, on se rend compte que cette parole, exclue des instances officielles, a refait surface ailleurs, et notamment sur les réseaux sociaux. Certains acteurs ont investi ces réseaux pour y développer une propagande très structurée. Mais, pour le reste, la plupart des échanges vont de témoignage en témoignage et ils sont, tels quels, quasiment inaudibles par les professionnels de la politique.
Il est facile de dévaloriser de tels échanges, brouillons, désordonnés et peu rationalisés. Mais un tel jugement relève largement d’un préjugé de classe.
Je suis sensible à la valeur de la parole-témoignage, car, entre autres choses, j’ai vécu l’essentiel de ma vie confessionnelle dans des églises évangéliques, et en dialogue avec le protestantisme luthéro-réformé. Un des points de discussion que nous avons souvent eus, dans ces dialogues, est la place conférée au témoignage du membre d’église de base : marque de lacunes théologiques, pour les uns, et d’authenticité, pour les autres.
Pensons-y : faire participer ce n’est pas seulement donner la parole, c’est d’abord admettre une diversité de formes de paroles.
[1] Je remercie Chloé Gaboriaux, professeure à l’Université de Poitiers, de m’avoir, à l’occasion d’une conférence, rendu attentif à cet article : Rémi Lefebvre et Frédéric Sawicki, « Le peuple vu par les socialistes », Contribution publiée dans : Frédérique Matonti, dir., La démobilisation électorale, Paris, La Dispute, 2005, p. 69-96.