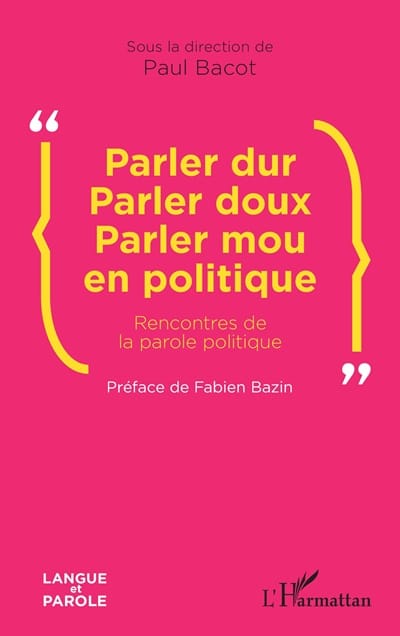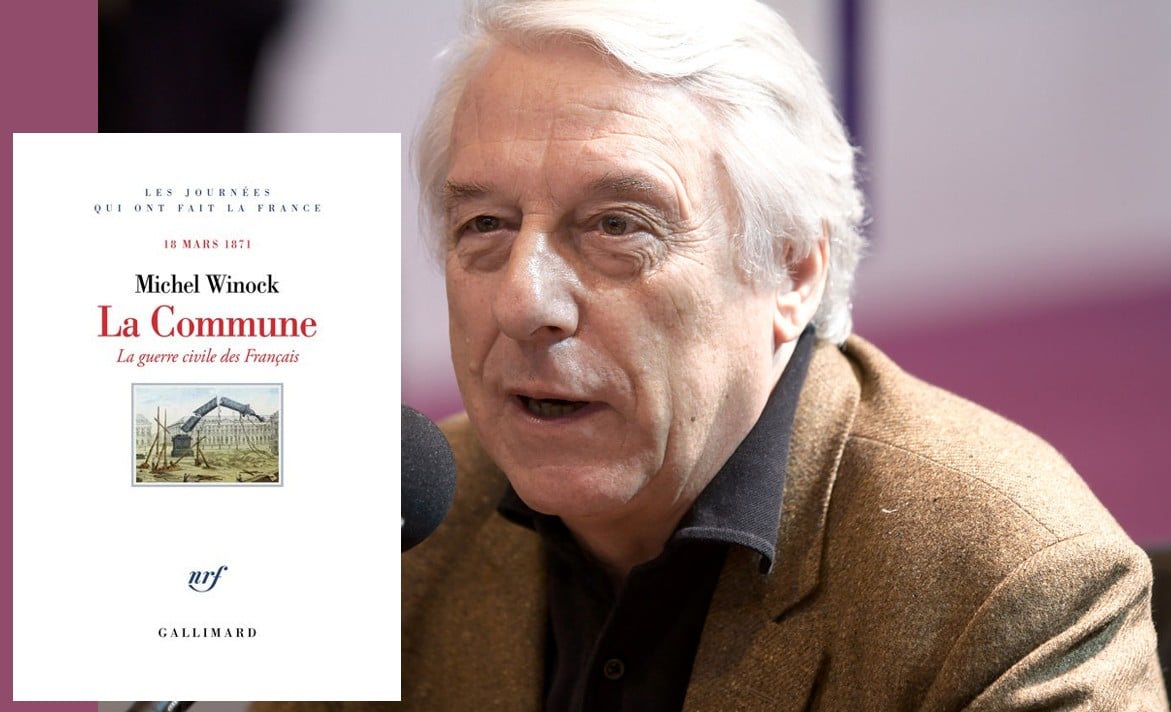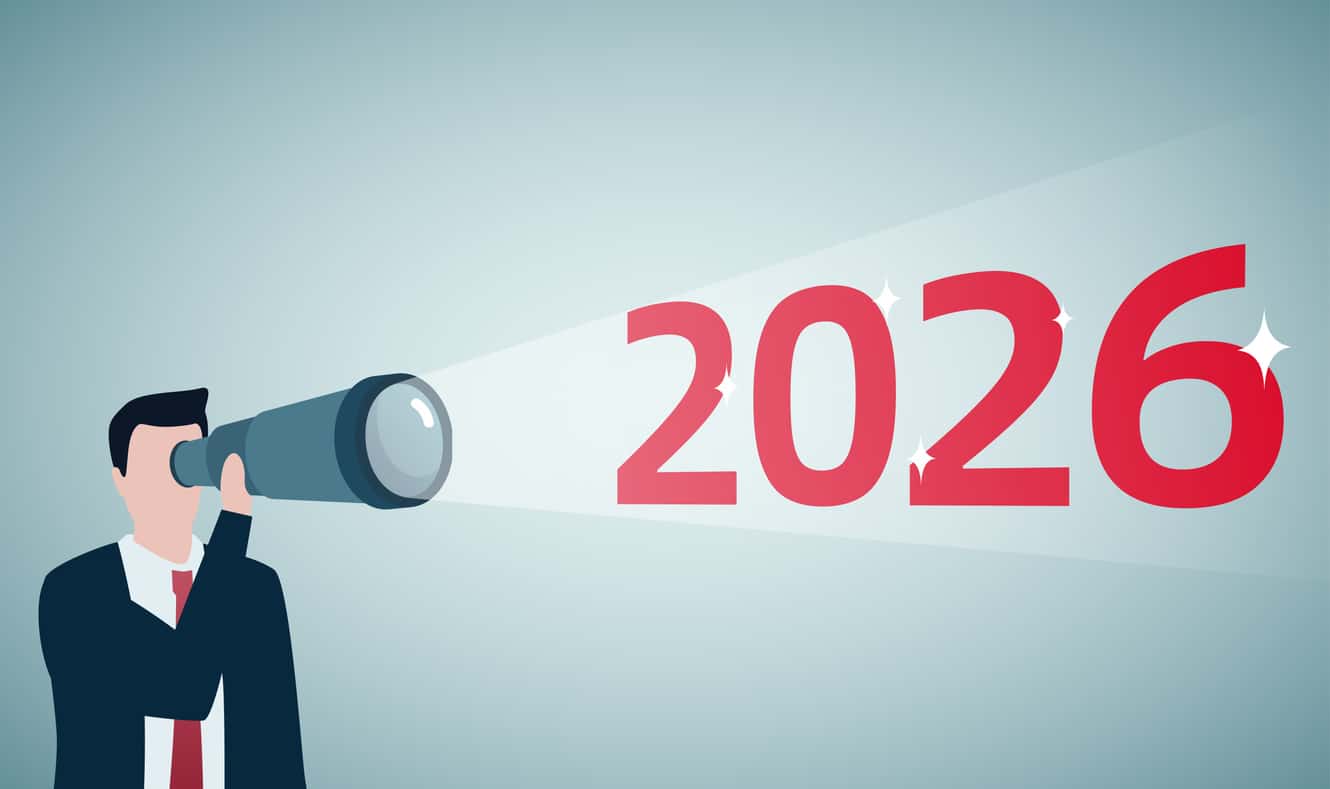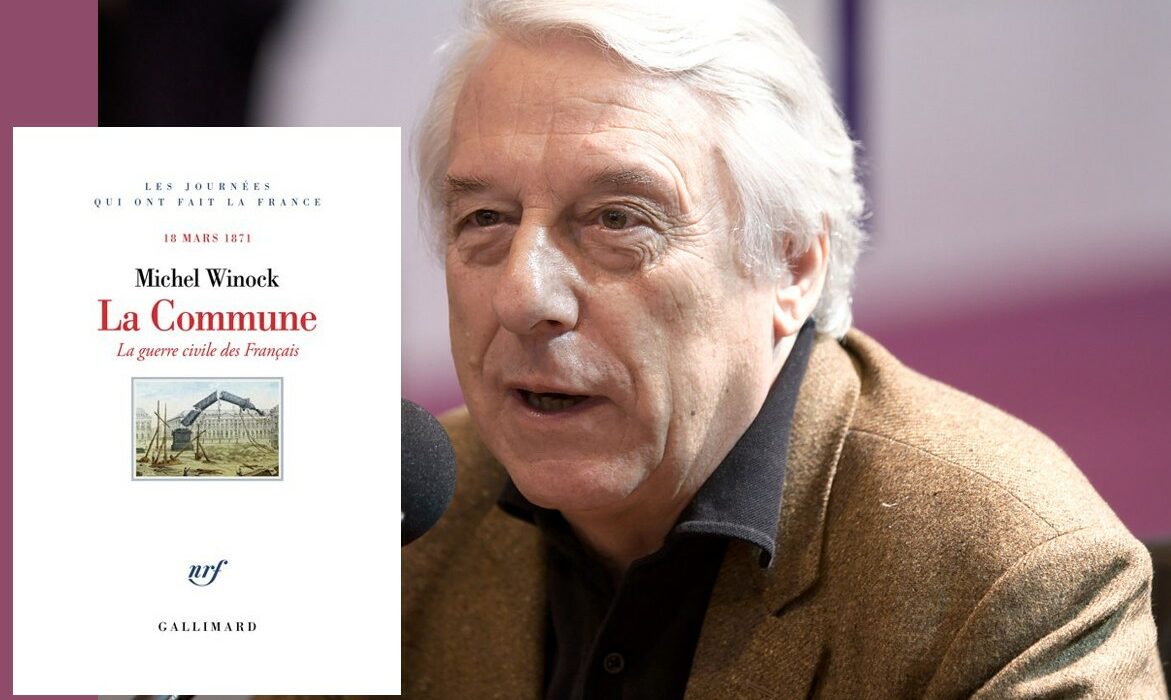Plonger dans les rivières d’archives pour mieux comprendre ce qui nous arrive ? On l’aimerait. Tenez, cette phrase qu’a prononcée Jacques Chaban-Delmas, en 1983 : « Tant qu’un homme politique n’est pas mort, il n’est jamais fini ». Cela tient d’une Lapalissade et pourtant c’est une loi qui nous vient à l’esprit, ce soir, comme François Bayrou se noie. Dans deux ans, qui sait ? Pour l’heure, il semble bien seul, abattu, vaincu pour tout dire.
François Bayrou : de l’espoir de 2007 à la défaite actuelle
Un souvenir plus frais cette fois. C’était en 2007. Un monde pourtant : presque vingt ans. Le fondateur du Modem conduisait l’une des plus belles campagnes de la présidentielle, même s’il ne parvint pas au second tour – et n’allez pas dire que l’on n’ait d’yeux que pour les Poulidor. A la fois lucide et généreux, François Bayrou exprimait la nécessité de surmonter la dette – il en avait déjà dénoncé l’importance en 2002 – mais aussi l’obligation de prendre en compte les douleurs sociales, de répartir les efforts de manière équitable. On a coutume, sous nos latitudes, d’appeler cela « justice sociale ». Un professeur de lettres à la culture classique – il pouvait au débotté, parler de Gracq en surplomb d’un paysage du Tarn –animait le débat d’une manière atypique, et l’on pouvait croire qu’il allait vaincre les réticences à l’endroit du principe de coalition. Las. Parvenu cette année sur le parvis de l’hôtel Matignon, l’homme de Pau s’est manqué. A lui-même, aux Français. L’universitaire Paul Bacot, qui vient de publier un très bon livre sur le langage en politique, nous aide à comprendre ce revers et les possibilités qui s’offrent à nous pour le dépasser.
Un revers à la fois personnel et politique
« Sans être un homme providentiel, François Bayrou aurait pu démontrer des qualités personnelles plus grandes, admet-il en préambule. Plusieurs facteurs expliquent son échec. Tout d’abord, je pense que sa nomination est intervenue un peu trop tard ; de surcroît, les conditions de cette nomination n’ont pas été bonnes : tout le monde sait qu’il a forcé la main du Président. Pour couronner le tout, il a payé une stratégie politique définie par Emmanuel Macron mais qui se trouve dans une impasse. » On songe à Marielle de Sarnez, fidèle entre les fidèles de François Bayrou, disparue voici trois ans, dont la présence lui serait sans doute précieuse, tant cette femme avait la vista politique, une expérience acquise dès ses jeunes années.
Nombre de nos concitoyens déplorent que nos responsables politiques, de tous bords, se révèlent incapables de s’entendre, au moins sur quelques points clés, pour résoudre les problèmes du pays.
La difficile culture du compromis à la française
Disons-le clairement, les protestants soutiennent, plus que d’autres, une telle orientation. Regardant vers l’Europe du Nord, ils expriment souvent le désir qu’une politique fondée sur le compromis l’emporte chez nous sur l’affrontement binaire. Mais tout le monde ne partage pas ce diagnostic.
« En France, contrairement à ce que l’on dit, on passe des compromis, note Paul Bacot. La différence entre nos voisins et nous c’est que, chez eux, notamment chez les scandinaves et les allemands, les partis politiques passent des accords après les élections, alors qu’en France, du fait de notre système électoral majoritaire à deux tours, chaque famille politique affirme au premier tour son identité, puis elle noue des alliances avant le second tour. »
Certains analystes ou responsables politiques pensent que le passage au scrutin proportionnel donnerait à notre vie publique un regain de vitalité. « Changer la règle du jeu, voilà bien l’un de nos sports favoris, note en souriant Paul Bacot. Beaucoup de gens crient « proportionnel, mais dans un paysage éclaté, rien ne dit qu’une quelconque majorité se révèle. En fait, la crise actuelle provient du fait qu’Emmanuel Macron a été élu non pas contre le camp républicain opposé, qui était susceptible de faire l’alternance, mais contre l’extrême droite, estime Paul Bacot. Il a réuni autour de lui, non pas des gens qui, d’accord ou pas, était prêts à faire un compromis, mais des gens qui voulaient seulement faire barrage à l’extrême droite. Le Président paye la façon dont il a refusé les conséquences des circonstances de son élection et sa réélection. Cela ne signifie pas forcément constituer un gouvernement d’Union nationale, mais qu’il aurait dû élargir un peu sa base, passer des compromis sur certains dossiers. »
Vers la fin du macronisme et le retour du clivage gauche-droite ?
La chute du gouvernement de François Bayrou marque peut-être le premier acte de la fin du macronisme, l’amorce d’un retour à l’opposition de la droite et de la gauche. Il ne faudrait pas s’en étonner. Dans son ouvrage « La droite et la gauche, histoire et destin », (paru chez Gallimard), Marcel Gauchet constate que le clivage entre les familles politiques demeure : « Tout se passe comme si l’on ne parvenait pas à se débarrasser de cette dichotomie que l’évolution des sociétés politiques tend à révoquer en doute. Signe de ce flottement, s’il en fallait un de plus, les citoyens qui en dénient le caractère pertinent, du point de vue du choix de leurs représentants ou de leurs gouvernants, acceptent néanmoins de situer eux-mêmes selon cet axe. » Observant qu’il existe un populisme de droite et un populisme de gauche, une écologie de droite et une écologie de gauche, le philosophe estime que le clivage gauche-droite permet d’identifier le fonctionnement du gouvernement représentatif : « Celui-ci se résout toujours, ultimement, dans le partage – temporaire et représentatif – entre une majorité et une opposition. »
L’avenir nous dira si nos concitoyens restent fidèles à cette identification collective, ou bien s’ils se lancent à l’aventure, et si oui, laquelle. En attendant, l’urgence commande. S’offrir une telle crise, dans le contexte économique et militaire actuel, apparaît comme une énorme prise de risque. Pour un peuple que l’on dit l’un des plus politiques de la planète, c’est un défi majeur.
A lire : Paul Bacot : « Parler dur, parler doux, parler mou en politique » (éditions de L’Harmattan, 188 p. 21 €)