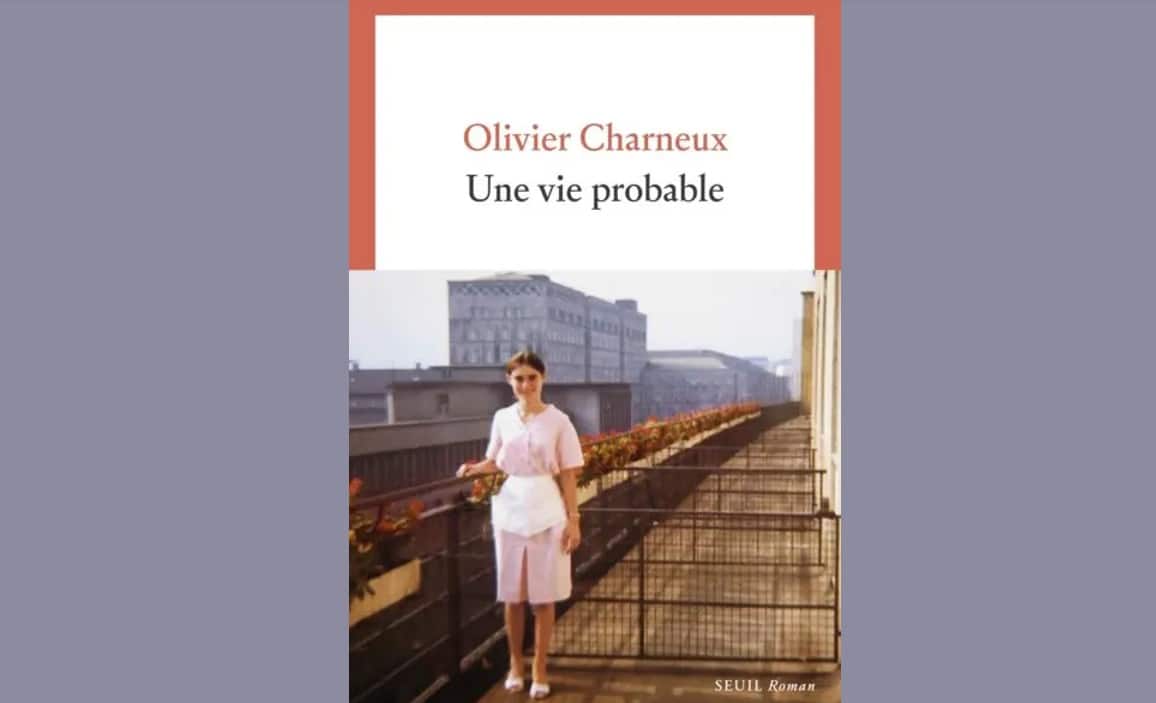« Pour un riche d’un pays riche, la frontière est devenue une formalité d’embarquement […] un point de reconnaissance symbolique de son statut social […]. Pour un pauvre d’un pays pauvre, la frontière est non seulement un obstacle très difficile à franchir, mais encore un lieu où l’on revient sans cesse se heurter, que l’on passe et repasse au gré d’expulsions […] et dans lequel finalement on séjourne » (Étienne Balibar).
La frontière est ce lieu où des centaines de milliers de personnes mènent « une vie qui est une attente de vivre, une non-vie » (Étienne Balibar), par la législation d’États qualifiés de démocratiques. Ils honorent des devises, à l’image de celle de la France : « Liberté Égalité Fraternité ». Cette devise est une promesse inachevée, à commencer par la fraternité. Étymologiquement, nous sommes tous frères : ce qui nous fait frères, c’est l’égale dignité. Le premier ou le second Testament, la Déclaration universelle des droits de l’homme ne cessent de le rappeler. Les exhortations à l’accueil de l’étranger, la lutte contre les discriminations figurent à toutes les lignes des textes fondamentaux qui régissent notre État de droit.
Mais voilà qu’une circulaire, déjà nommée la circulaire Retailleau, vient contredire toute éducation civique fondée sur la fraternité. Elle prive par exemple de droits élémentaires des milliers de personnes pendant deux ans de plus, soit sept ans, avant qu’elles puissent espérer leur régularisation, alors que la République en a besoin pour le fonctionnement de son économie.
De nombreuses associations, comme la Cimade ou l’ACAT, initiées par des protestantes, doivent plus que jamais être soutenues afin d’aider à lutter sans relâche pour que la vie ne soit pas « une attente de vivre, une non-vie » par la faute d’une frontière.
Christine Lazerges, professeure des universités, pour « L’œil de Réforme »