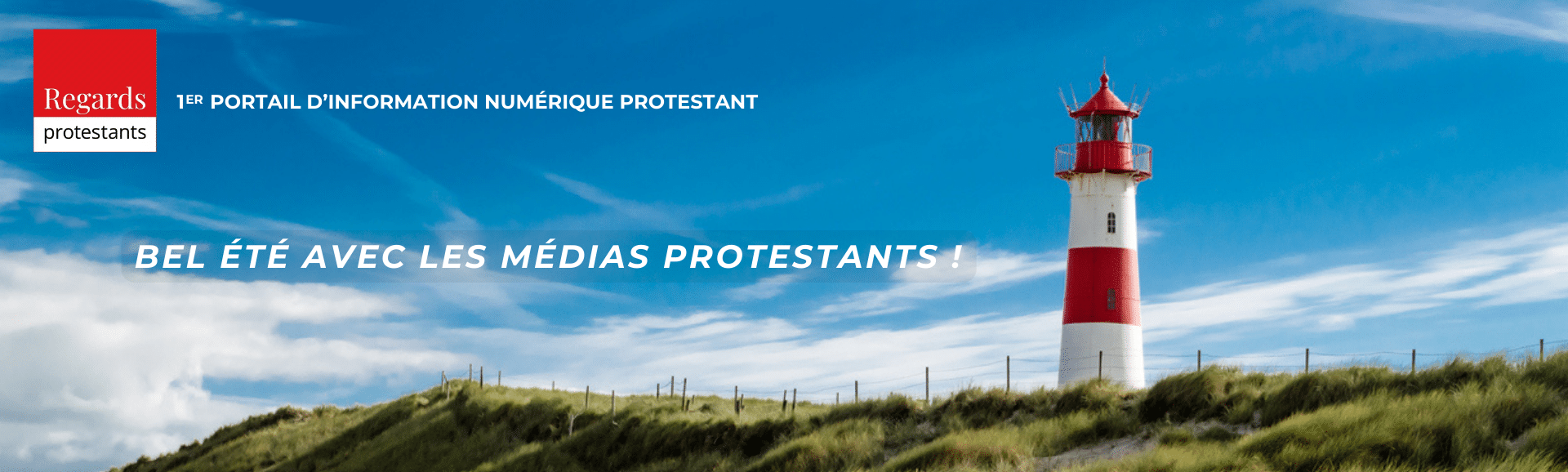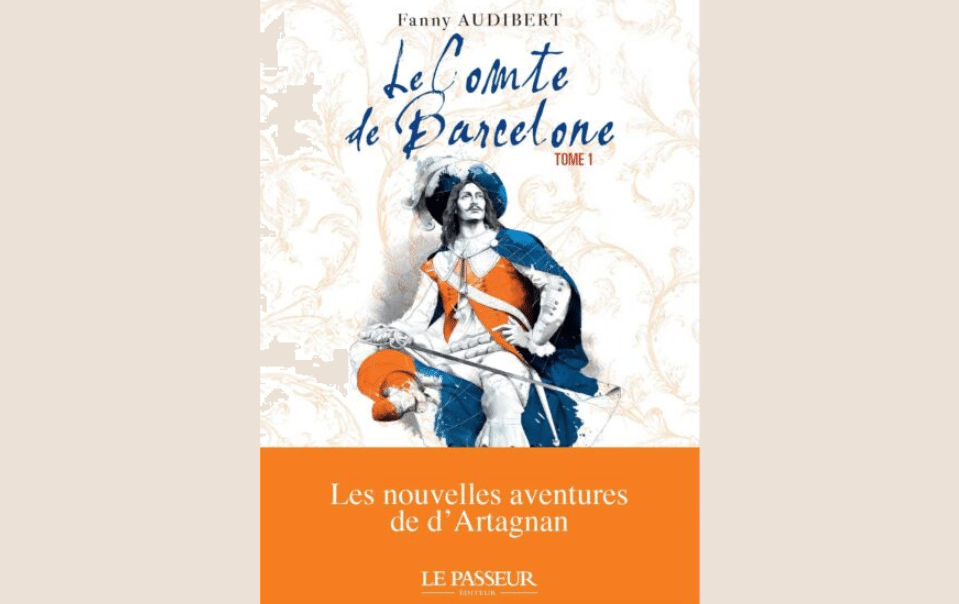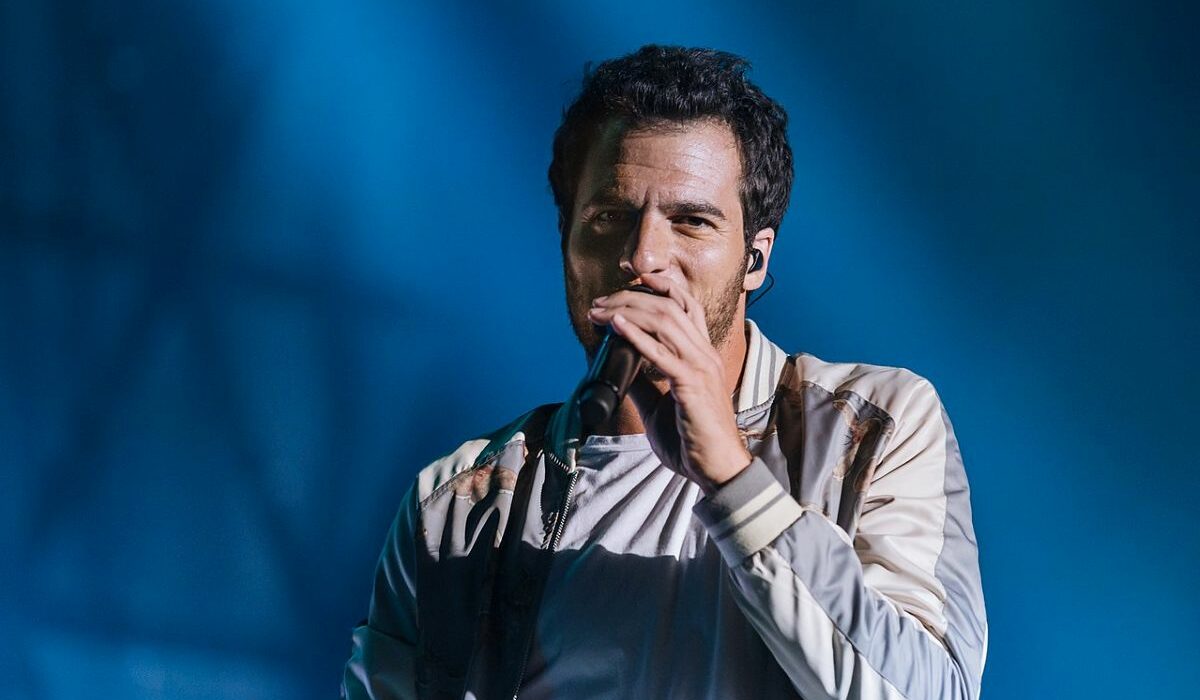L’initiative des parlementaires demandant un Référendum d’Initiative Partagée sur la privatisation d’Aéroport de Paris a été validée, jeudi dernier, par le Conseil Constitutionnel. L’histoire suit donc son cours. Il reste, désormais, à rassembler plus de 4 millions de signatures pour aller au bout de ce projet.
L’originalité de cette initiative est qu’elle a été portée, pour partie, par des parlementaires appartenant à « les Républicains » dont on pouvait supposer qu’ils étaient, par principe, en faveur de la privatisation. Il faut, évidemment, mesurer la part de stratégie politicienne dans un tel ralliement. Tout ce qui affaiblit le gouvernement en place est, pour un parti d’opposition, bon à prendre. Mais il me semble qu’il y a des motifs plus sérieux à cette réserve et qu’elle tire, notamment, les leçons de certaines des privatisations passées qui ont donné des résultats décevants, voire inquiétants.
En tout cas, 103 parlementaires appartenant à « les Républicains » avaient signé, dans le Journal du Dimanche du 24 février, une tribune où ils expliquaient les raisons de leur opposition et ces raisons méritent la réflexion. Elles permettent, en effet, de sortir des arguments a priori « pour » ou « contre » les privatisations en général et d’examiner de plus près, au cas par cas, les ressources et les dangers de telles opérations.
Ne pas encourager les monopoles en privatisant
Cette tribune mettait en avant, en l’occurrence, trois arguments. Le premier tient à l’exercice des fonctions régaliennes de l’Etat et me semble plutôt faible. On ne voit pas en quoi la privatisation d’un aéroport nuirait aux contrôles aux frontières, par exemple. En tout cas je vais me centrer sur les deux autres arguments qui concernent, de fait, les opérations de privatisation en général.
Je cite :
« L’intelligence économique devrait nous alerter. Un aéroport est par essence un monopole naturel : lorsqu’un Francilien voyage en avion, il n’a pas le choix entre Paris ou Berlin. Il prend celui qui est le plus proche de chez lui. Sans réelle concurrence, l’actionnaire détient alors une clientèle captive. Privatiser un monopole naturel conduit toujours à une situation de rente qu’il faut éviter plutôt qu’encourager ».
Voilà, c’est dit.
Ce qu’on appelle un monopole naturel est une activité qui repose sur des investissements tellement lourds qu’il serait contreproductif ne serait-ce que de les dédoubler, si on avait le projet d’instaurer une concurrence. Dans le cadre de la privatisation de la fourniture d’électricité, on a considéré, par exemple, que le réseau de transport à haute-tension était un monopole naturel. Personne ne se voyait en train de multiplier par deux les pylônes et les lignes à haute-tension. Le transport de l’électricité est donc entre le main d’un établissement public, RTE, dont une agence surveille les coûts de facturation pour vérifier qu’il n’abuse pas de sa situation de monopole pour surfacturer. Or, si on décide de privatiser une telle activité, il est évident que l’entreprise touchera ce qu’on appelle une rente de monopole et qu’il sera très difficile de faire pression sur elle. Et les parlementaires, manifestement échaudés par la privatisation des autoroutes, évoquent, au début de leur tribune, des cas proches : des cartels qui se partagent le marché et s’entendent.
Ils parlent également d’échecs et pensent, sans doute, à la privatisation des lignes de chemin de fer au Royaume-Uni où, pour des raisons qui tiennent, là aussi, à la lourdeur des investissements à effectuer, les gestionnaires des lignes ont laissé le réseau se dégrader, jusqu’à la survenue d’accidents dramatiques.
On ne peut donc, pas, et c’est ce qu’ils écrivent, privatiser n’importe quoi.
Comment faire agir au mieux un acteur : en le gérant directement, ou bien en passant un contrat marchand avec lui ?
Ensuite, il y a un troisième argument qui se situe, pour moi, au cœur du problème.
Je cite, une fois encore :
« Privatiser plutôt que réformer : voici le choix caché de la majorité à l’Assemblée ».
Oui, finalement, qu’attend-on de la privatisation ? Une rentrée d’argent ? En l’occurrence il s’agirait de 10 milliards d’euros, ce qui, en comparaison du budget de l’état, n’est pas grand chose.
Il pourrait donc y avoir une justification plus pérenne : en privatisant, l’Etat se donnerait les moyens de réformer le fonctionnement d’ADP, ce qu’il ne parvient pas à faire en étant son actionnaire. Dit de cette manière, l’argument semble absurde. Pourtant il a présidé à nombre de sous-traitances dans le privé, comme dans les entreprises publiques.
Il peut, en effet, arriver qu’un service d’une entreprise soit à ce point réfractaire à toute réforme qu’il est finalement plus simple de fermer ce service, de sous-traiter l’activité et d’obtenir ce que l’on veut par un contrat marchand. Et un argument du même style justifie certaines privatisations.
Quand les parlementaires écrivent « privatiser plutôt que réformer » ils sous-entendent que le gouvernement manque de courage ou ne se donne pas les leviers d’action pertinents pour agir comme il le faudrait et qu’il préfère se défausser du problème en privatisant.
Mais est-il si facile de « faire faire » ce que l’on veut à un acteur privé ? C’est toute la question posée par la « théorie de l’agence » en économie : peut-on écrire un contrat qui, avec des clauses économiques bien conçues, conduira l’acteur, à qui on délègue une mission, à produire le résultat escompté, avec plus d’efficacité qu’on ne l’aurait fait soi-même ? Même les économistes les plus optimistes ont admis qu’il existait, ce qu’on appelle un « aléa moral » : en gros, le délégataire ne communiquera pas vraiment sur ce qu’il fait, il cachera une partie de la réalité et, pour une large part, échappera au contrôle du commanditaire.
En tout cas, à propos du « faire faire », on est incontestablement sorti de l’âge d’or des Partenariats Publics Privés (PPP), où, précisément, la puissance publique pensait pouvoir atteindre ses buts en les faisant mettre en œuvre par des entreprises privées. Dans les chantiers de PPP complexes (comme des hôpitaux) l’état a montré qu’il était incapable de faire le poids face à des entreprises mobilisant des batteries d’avocat et qui montent au contentieux en permanence. Il s’est, finalement, révélé beaucoup plus difficile, pour l’état, de faire face aux malfaçons et aux aléas de chantier quand il avait délégué la maîtrise d’ouvrage à un opérateur privé.
En résumé, l’état n’est pas toujours un si mauvais gestionnaire que cela. En revanche il n’est pas armé pour peser sur de grands groupes privés qui ont des leviers d’action énormes.
Nul doute et c’est l’argument (au moins implicite) de la tribune des parlementaires que cela se reproduirait dans le cas d’ADP.
Une question de philosophie politique : comment produire une société juste avec des acteurs égoïstes ?
Les idéologues qui ont défendu, en France, en Angleterre ou en Écosse, au XVIIe et au XVIIIe, l’économie de marché, contre l’économie dirigée par la monarchie, avaient, en général, une anthropologie pessimiste, souvent liée à des convictions religieuses. Ils étaient persuadés que l’homme était un être pécheur, paresseux et tricheur. Il fallait donc trouver un moyen de lui faire faire des efforts et de produire des biens de qualité, même sans altruisme.
Ils auraient été, oh combien convaincus du risque d’aléa moral, si on leur avait expliqué la notion. Pour eux, faire faire quelque chose à quelqu’un d’autre (que ce soit via un règlement, ou via un contrat) était une entreprise risquée. Ils ne voyaient le salut que dans la concurrence d’un nombre significatif d’agents économiques qui, en quelque sorte, se contrôlaient les uns et les autres par leur concurrence et s’obligeaient mutuellement à améliorer leur offre.
Cette méthode a fait ses preuves, tant qu’un nombre substantiel de vendeurs sont en concurrence les uns avec les autres. En revanche elle devient très vite inefficace dès que des oligopoles émergent. L’anthropologie pessimiste, si on y tient, implique que dès que les producteurs seront suffisamment peu nombreux, ils feront tout pour s’entendre sur le dos des clients.
La question de fond demeure donc : quel résultat veut-on obtenir ? et quel est le meilleur moyen de l’obtenir ? On n’a pas la réponse à la première question. Dans la loi PACTE on lit simplement cette phrase plutôt passe partout : « le transfert au secteur privé de la participation au capital détenue par l’Etat permettra à la société Aéroports de Paris d’entamer une nouvelle phase de son développement, grâce à l’entrée de nouveaux investisseurs à son capital ». S’agissant d’une entreprise publique bénéficiaire, on s’étonne que l’Etat n’ait pas les moyens d’investir, si c’est nécessaire.
Et parler du développement en général est le signe d’un manque de vision politique. C’est ce que pointent aussi les parlementaires en écrivant « privatiser plutôt que réformer ». La régulation du trafic aérien est (et sera encore plus, dans les années à venir) un enjeu des politiques publiques. Or l’état sera forcément soumis à la pression d’un opérateur privé qui cherchera à étendre les créneaux de survol (limités pendant la nuit). Et les politiques environnementales qui voudront limiter l’usage de l’avion auront en face d’elle un opérateur qui, au contraire, voudra le développer.
L’aléa moral est un concept qui a, malheureusement, fait ses preuves. On a de nombreux exemples, aujourd’hui, d’entreprises privées qui jouent l’opacité, font pression sur les chercheurs ou sur les journalistes et ne cherchent nullement à se comporter en acteurs responsables. En clair, en déléguant un levier des politiques publiques de demain à un acteur privé on se complique singulièrement la tâche.
Découvrez d’autres contenus sur le blog Tendances, Espérance