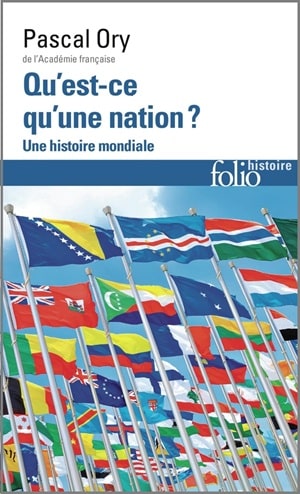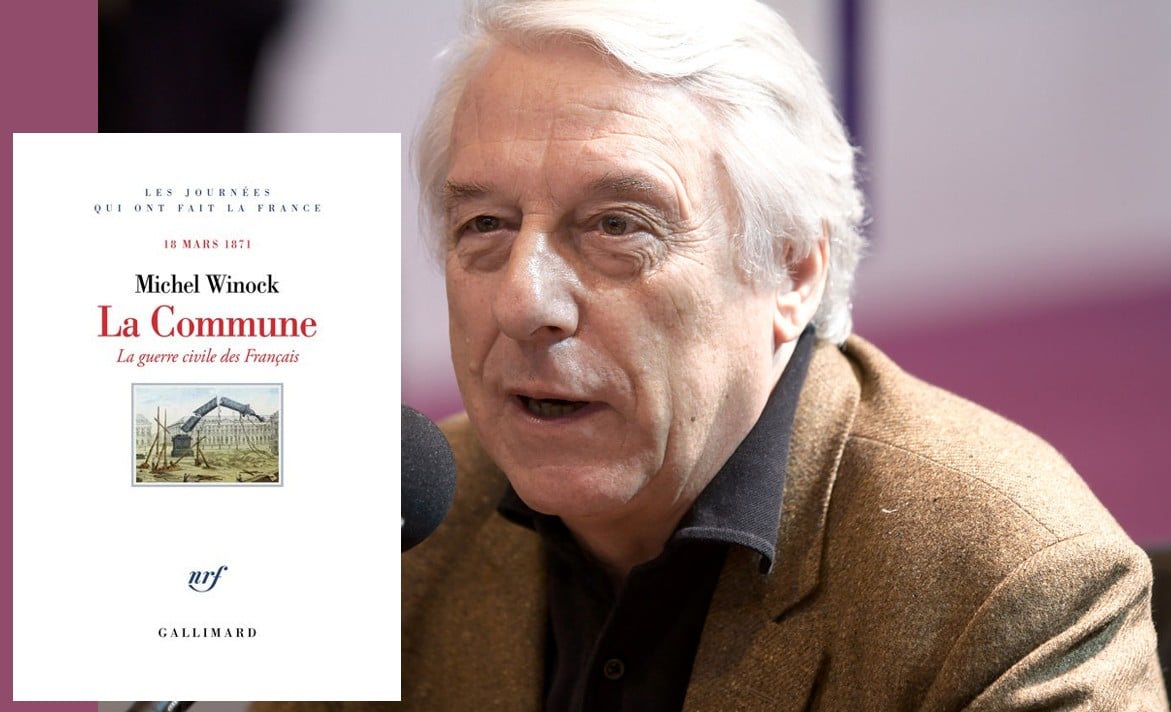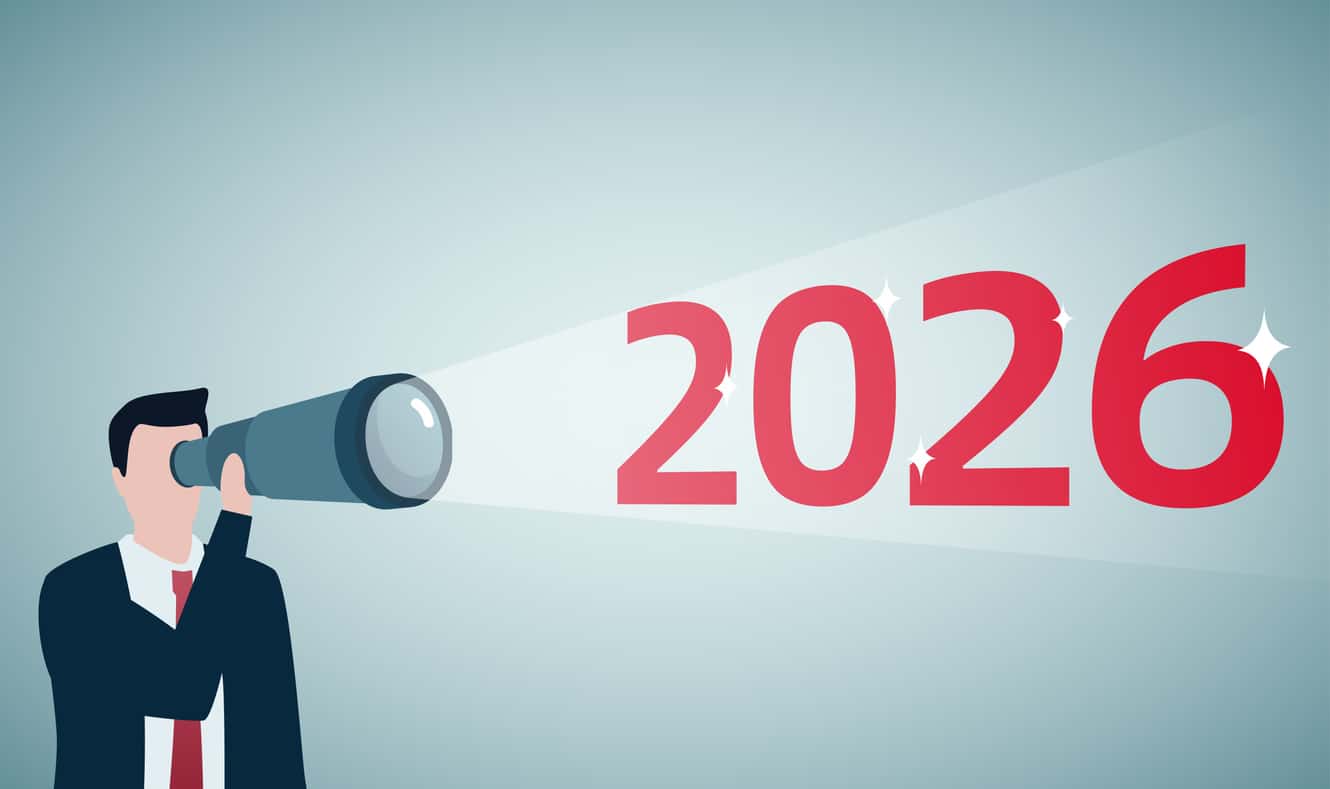Sébastien Lecornu consulte et promet la rupture. « Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions », a-t-il déclaré le 10 septembre, en présence de son prédécesseur François Bayrou – la vie politique est charmante…Pendant ce temps, la mondialisation n’attend pas : l’agence Fitch a fait perdre à la France son « double A », tandis que l’armée russe multiplie les provocations vis-à-vis des pays européens. Qu’allons-nous devenir ? Plutôt que de lire dans le marc de café, nous vous proposons de lire un livre.
« Ce livre, on le verra, a été conçu au milieu des années 1970. Il a paru une première fois en 2020. Il reparaît cinq années plus tard », explique son auteur en préambule. De quoi s’agit-il ? D’un ouvrage qu’édite la collection Folio : « Qu’est-ce qu’une nation ? » de Pascal Ory.
Naguère, l’historien, répondant lui-même à cette question lors d’un colloque, avait déclaré : « C’est un Etat. » Que les partisans de la déconcentration des pouvoirs ou, pour reprendre le titre d’un des premiers textes de Michel Rocard, de la décolonisation de la province, apprécient peu la formule, on peut l’imaginer. Mais puisque chez nous c’est l’Etat qui a fait la nation, comment contester cette assertion ? D’ailleurs, nous pourrions penser que la nation française est en danger, puisque l’Etat, depuis quarante ans, fait l’objet d’un démantèlement progressif mais constant.
La nation, une idée mal aimée, longtemps mal comprise
Pascal Ory, dans son livre, admet que la notion de nation sonnait mal à ses oreilles autrefois : « traumatisée par une guerre mondiale, bien décidée à construire une Europe Unie et, sur cette lancée, une planète qui ne le serait pas moins, ma génération a mal lu certains mots, donc mal compris certaines choses. » Durant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, hélas, la nation se confondit dans l’esprit du plus grand nombre avec le nationalisme, au point d’apparaître comme un épouvantail à moineau, fétiche de l’extrême droite. La démocratie, l’évanouissement des frontières, seules, représentaient l’avenir et la modernité. Bien sûr, quelques responsables politiques alertaient nos concitoyens sur les risques engendrés par une telle attitude. Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, se mobilisèrent. Mais avec si peu d’humour, un air aussi taciturne que tellurique, ils n’avaient guère de chance de convaincre. En passant par la littérature, en usant de ses mots qui sont un charme, Régis Debray sut mieux faire comprendre le problème.
Face à la crise mondiale, le retour assumé du fait national
De nos jours, où que notre regard se pose, on est bien obligé de constater que l’aspiration nationale opère un retour spectaculaire. « La démocratie a, en profondeur, partie liée avec la nation, puisque l’une et l’autre sont affaires de souveraineté, souligne Pascal Ory dans la préface – inédite – de son ouvrage. Pour autant, elle n’est pas nécessairement affaire de liberté. La seule démocratie compatible avec la liberté est (tautologie) la démocratie libérale. Mais sur la surface de la Terre – qui est donc, plus que jamais une surface de nations –, cette démocratie-là est beaucoup moins répandue que la démocratie autoritaire, sous toutes ses formes, jusque et y compris totalitaires. C’est ici sans doute l’enjeu ultime d’une histoire du national. »
On l’aura compris, la mondialisation sans frontières, utopie dont Garry Davis (1921-2013), militant pacifiste américain qui avait créé le Mouvement des Citoyens du Monde, demeure l’une des figures les plus touchantes, est aujourd’hui laissée pour morte. Elle tourne encore dans le domaine économique, mais pour combien de temps ? Pascal Ory remarque : « La nation – qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en lamente – a encore de beaux jours devant elle. » Et l’historien de proposer trois arguments pouvant expliquer ce phénomène, que nous réunissons comme en bouquet : « Parce qu’elle fut, dans l’Histoire, la fille aînée de la modernité politique », « parce qu’elle a été la plus durable de toutes les constructions politiques des Temps modernes », « enfin parce qu’elle est, dans le présent, une ressource pour les dominés ».
Un regard d’historien lucide, sans nostalgie ni dogme
Mais ne comptez pas sur Pascal Ory pour verser dans la nostalgie. Monsieur l’Académicien français conserve un air de jeune homme qui lui vient de son regard, tourné vers l’avenir, un brin sceptique à l’endroit des évidences, exigeant mais souriant. Souple par méthode mais ferme sur les principes, il nous aide à comprendre, sans donner de leçons, les temps obscurs qui sont les nôtres. « A celles et ceux qu’un tel diagnostic pourrait troubler, écrit-il à propos du retour du fait national, on fera remarquer que les hommes, à l’instar des dieux, sont passés maîtres dans l’art d’« écrire droit avec des lignes courbes. ».
Un historien qui cite Claudel ne saurait nous laisser de marbre. Foi de protestant.
A lire : Pascal Ory : « Qu’est-ce qu’une nation ? Une histoire mondiale » (Gallimard, folio, 576 p. 11,10 €)