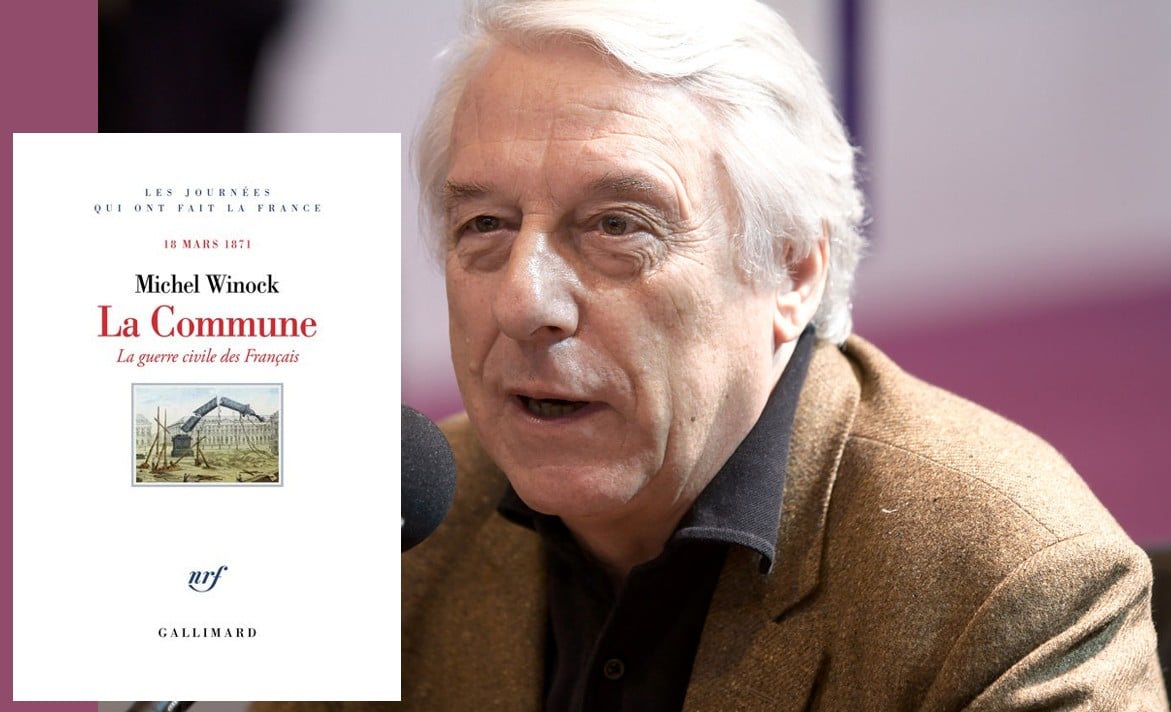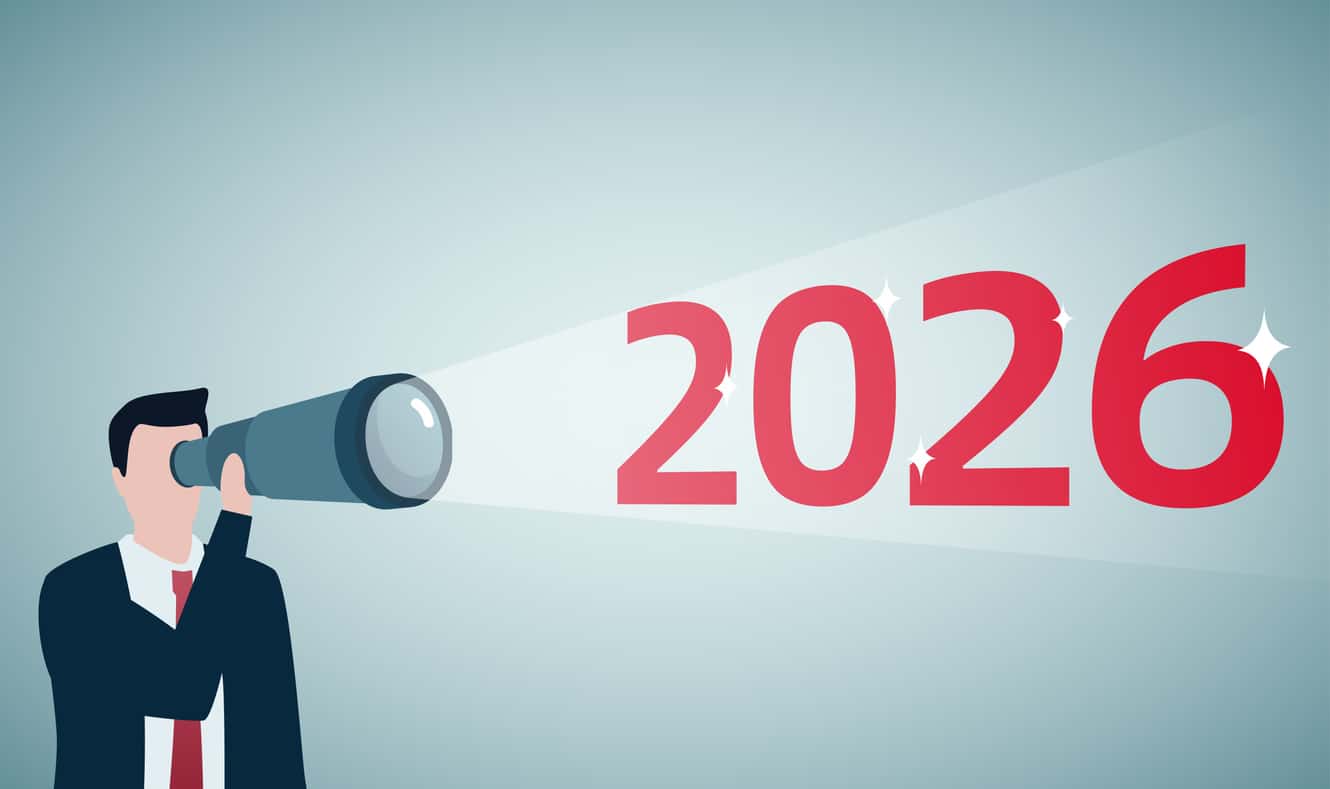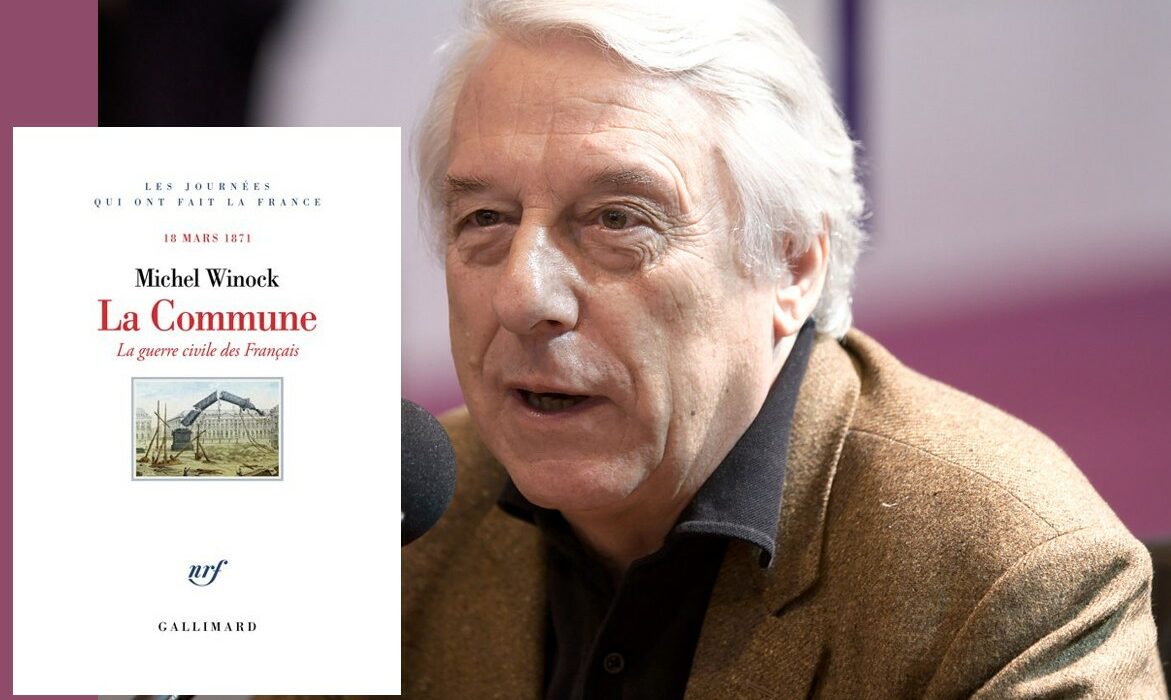Les Français broient du noir. La dernière étude menée par Ipsos pour le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne accrédite l’idée que nos concitoyens sont touchés par un désespoir alarmant : 90 % des personnes interrogées pensent que la France est en déclin, 75 % que notre pays se portrait mieux avant, sentiment qui ne concerne pas que les seniors, puisque 68 % des moins de 35 ans pensent la même chose. On pourrait leur conseiller la lecture du livre de Laure Murat, dont le titre, emprunté à Antonin Artaud, cache une invite à l’imagination : « Toutes les époques sont dégueulasses ». Mais cela serait-il efficace ? On a beau dire, chacun s’en va répétant que la situation politique, aujourd’hui, rappelle des temps révolus. Est-ce contradictoire avec ce qui précède ? Pas vraiment : c’est le désir d’un chamboule-tout qui mobilise les esprits surchauffés. Mais ce retour de manivelle peut inquiéter : s’il existe des analogies, faut-il s’en inspirer ?
Le retour du vieux démon de l’instabilité
Michel Winock, dans un texte disponible dans une anthologie passionnante, « La France Républicaine » (Robert Laffont, collection Bouquins) observe qu’à la fin des années cinquante la situation politique est bloquée : « Elle est d’autant plus bloquée que les gouvernements de la IVe République souffrent d’une fragilité structurelle : le défaut de majorité stable. On invoque à ce sujet les faiblesses de la Constitution, dont le général de Gaulle avait fait le procès retentissant dès 1946, en dénonçant la prépondérance du législatif sur l’exécutif. Certes, les procédures de l’investiture et de la confiance ont favorisé le pire parlementarisme, mais, plus que les textes, c’est la pratique constitutionnelle qui était fautive : démissions de gouvernements sans obligation, usage insuffisant de la dissolution… Le vrai problème est moins dans la défaillance des textes constitutionnels que dans la multiplicité des divisions politiques, interdisant tout système binaire majorité-opposition. » Voilà qui nous rappelle quelque chose.
De la Débâcle à la Révolution
Mais voici que certains se projettent au temps de la Débâcle. Ils peuvent ici trouver des arguments : « La société Française de 1939-1940 est une société compartimentée en grands ensembles humains relativement étanches », écrit Jean-Louis Crémieux-Brilhac dans son maître-ouvrage, « les Français de l’an 40 ». Et l’ancien résistant devenu historien d’ajouter cette remarque en forme de condamnation de nos us et coutumes : « Rupture dans l’histoire de la nation française, le désastre de 40 ? Oui, sans doute. Mais les états d’esprit qui l’ont précédé ou accompagné sont-ils eux-mêmes un phénomène aberrant dans la continuité française ? Ne sont-ils pas au contraire, dans leur ambiguïté, un chaînon auquel se rattacheraient plus clairement qu’on ne le pensait l’avant et l’après ? » Nous voici donc au pied du mur.
« Ah mais non, voyons ! », disent les autres. C’est en 1789 qu’il nous faut remonter : les caisses de l’Etat sont vides et notre souverain républicain, bien qu’intelligent, cultivé comme pas quinze, paraît débordé par le torrent des mécontentements. « La Révolution est en nous, dans nos âmes » écrit Michelet. Voilà qui nous annonce des lendemains qui chantent, mais aussi quelques piques et quelques têtes à la renverse.
Quand le passé sert de masque au présent
Pour calmer les esprits, nous pourrions rappeler que l’histoire ne se répète jamais à l’identique et, citant Karl Marx, affirmer que la première fois c’est une tragédie, la seconde une farce. Hélas, il nous faut lire la suite du texte pour faire comprendre que rien n’est jamais garanti. « La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants, écrit le philosophe allemand dans « Le dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte ». Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté. » Voilà qui devrait nous maintenir en éveil. Marine Le Pen se prend-elle pour de Gaulle ? Masque. Jean-Luc Mélenchon se prend-il pour Robespierre et Jaurès réunis ? Masque. François Bayrou pose-t-il au nouveau Mitterrand ? Masque. Et tant d’autres encore !
En attendant, pas à pas, le funambule avance. Une séance, puis une autre, un vote, encore un, puis un autre… A chaque étape, l’Assemblée nationale donne à Sébastien Lecornu le sursit nécessaire à l’élaboration d’un budget. Les optimistes affirmeront que l’ère advient du compromis qu’ils appellent de leur vœu depuis des mois – voire, pour certains, des années, car leur flamme ne s’est jamais évanouie. Les pessimistes ricanent, estiment que tout cela ne tiendra pas jusqu’à Noël. Quant aux autres, que l’on hésite à nommer réalistes de peur de passer pour un des leurs, ils constatent que les déclarations d’Emmanuel Macron, les mises en garde de Gérard Larcher (assurant que le Sénat rétablirait la réforme des retraites si celle-ci se trouvait suspendue par l’Assemblée Nationale), les cris d’orfraies de l’extrême droite et de la gauche extrémiste n’empêchent pas, pour le moment, les élus de négocier.
Les protestants et la justice sociale
Mais la pierre d’achoppement la plus volumineuse occupe encore le milieu de la route. On peut l’aborder par la droite ou par la gauche, par des changements modestes ou suivant les préconisations de Gabriel Zucman, il faudra bien que les grandes fortunes participent à l’effort collectif. Les protestants n’ont pas de sujet tabou, s’ils rejettent les mauvaises manières. Ils ne peuvent se reconnaître dans un slogan, « Taxer les riches » parce qu’ils devinent que cette formule respire la jalousie, parce qu’ils se distinguent des catholiques en estimant que ce qui est scandaleux, ce n’est pas la richesse, mais la pauvreté.
Ceci posé, les protestants savent leur histoire. Ils ne confondent pas Joseph de Maistre et Rabaut-Saint-Etienne, Thiers et Guizot, Maurras et Ferdinand Buisson. Voilà pourquoi, dans un contexte de désespérance, ils peuvent apporter leur pierre à l’édifice, contribuer, par des analyses multiples et des disputes constructives, à l’avancée du débat. Pas seulement par des analyses et des disputes : leur ancrage les portera, nous en faisons le vœu, du côté de la justice que l’on dit sociale. Pour le meilleur. Et pour éviter le pire.