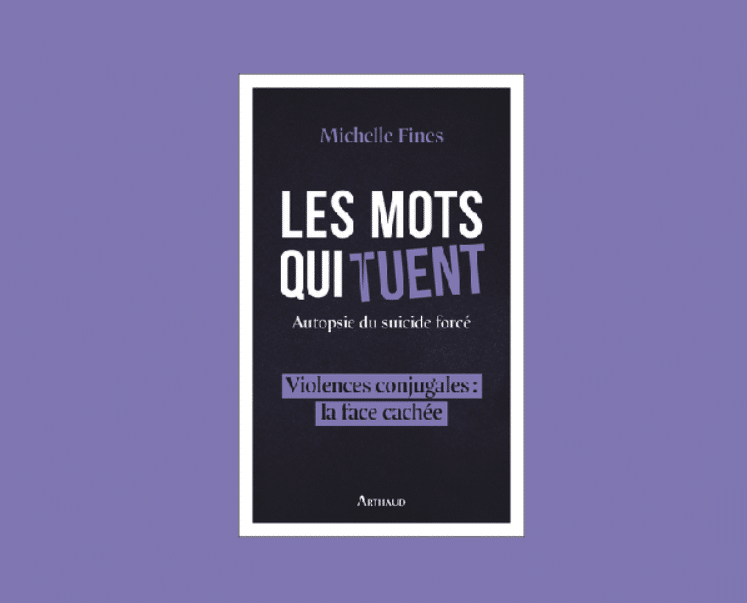Bien, je reprends le fil de l’écriture, après une pause liée à mon déménagement. Entre les cartons à remplir, puis les cartons à vider, les démarches, les bricolages de sortie et d’entrée dans un logement, j’ai été peu disponible pour écrire.
En revanche j’ai lu, à petites doses, le livre d’une auteure dont j’apprécie souvent les ouvrages : Clotilde Leguil. Il s’agit de sa dernière publication : Céder n’est pas consentir. Une approche clinique et politique du consentement. L’ouvrage de Vanessa Springora, Le consentement, qui relate la manière dont elle a été abusée sexuellement, comme adolescente, et les multiples séquelles qui s’en sont suivies, est l’impulsion de départ du livre de Clotilde Leguil. Son sous-titre : une approche clinique et politique, trace les contours du propos. Il s’agit à la fois d’une approche psychanalytique et d’une réflexion de philosophie politique sur ce qui est en jeu dans le consentement, et son dévoiement dans le forçage, l’abus sexuel ou la tyrannie. C’est ce double registre que je trouve particulièrement éclairant. En résumé, ce qui se joue dans le registre de l’intime et de l’interpersonnel est largement similaire à ce qui se joue dans le champ du gouvernement des sociétés.
 Autour du consentement
Autour du consentement
Une partie de l’ouvrage, évidemment, explicite la différence entre céder et consentir. Mais un autre propos consiste à dessiner les contours et la valeur du consentement en lui-même et c’est, je l’avoue, la partie du livre la plus déroutante, pour un homme. Clotilde Leguil explicite un mouvement qui se rattache à un désir féminin qui, certes, concerne aussi les hommes (féminin, en l’occurrence, est une étiquette, et non pas l’assignation à un genre), mais est, pour l’heure, surtout présent chez nombre de femmes. C’est l’idée, qu’en situation, et de manière surprenante, une proposition trouve un écho qui prend par surprise, pour des raisons difficilement déchiffrables par le sujet lui-même, qui peut trouver une jouissance à se laisser entraîner sans l’avoir anticipé. Il y a une part d’obscurité dans ce consentement qui en fait autre chose qu’un contrat signé : ce n’est pas parce qu’on acquiesce ici et maintenant que cela vaut accord dans la durée et dans une autre situation.
Voilà : mes quelques phrases constituent un résumé très réducteur et je vous encourage à lire le livre par vous-mêmes. Pour ma part, j’avoue que c’est cette obscurité du consentement qui reste, à mes yeux, une énigme. Même en sortant du domaine des relations intimes, il m’est évidemment arrivé d’adopter, en situation, une proposition à laquelle je n’avais pas pensé, mais il m’a souvent semblé possible de rendre compte de ce consentement, d’une manière relativement claire.
Cela dit, cette obscurité des ressorts du consentement montre bien comment on peut le manipuler, et basculer du côté du forçage qui conduit le sujet à céder et non plus à consentir.
Un consentement éclairé ?
Par ailleurs, en faisant un pas de côté et en allant explorer ce registre du consentement dans d’autres domaines que celui des relations intimes, cela fournit des mises en perspective suggestives. On parle, par exemple, en médecine, de « consentement éclairé » : le médecin est censé exposer tous les risques potentiels d’une stratégie thérapeutique afin que le malade se décide en connaissance de cause. Mais, pour le coup, Clotilde Leguil a raison de souligner que l’éclairage en question est forcément limité. Ce qui décide le malade, en général, est la confiance qu’il accorde au médecin, plus qu’une hypothétique pesée du pour et du contre qui demeure bien théorique tant que les risques restent potentiels.
Le cas médical dit, à mon avis, quelque chose de fort : il y a, à la base, un rapport social inégal. Le médecin est censé en savoir plus que le malade. Et le consentement est certainement mieux qu’un passage en force, mais il n’annule pas ce rapport social inégal. Les exemples pris, par Clotilde Leguil, dans le champ de la philosophie politique disent la même chose : le sujet d’une démocratie délègue une partie de son pouvoir de décision à des acteurs élus et il consent, en général, à respecter les lois. Cela dessine, là aussi, des positions sociales inégales et l’inégalité est adoucie, mais nullement éliminée, par le consentement accordé par le citoyen.
Faut-il en conclure que le consentement, dans le domaine des relations intimes, est une sorte de pis-aller, qui reflète, malgré tout, la persistance de la domination masculine ? Ce n’est pas le point de vue de l’auteure, qui célèbre, je l’ai dit, le plaisir du consentement. Mais c’est la question que je me suis posée en lisant son livre.
Une comparaison avec d’autres situations de domination
Je me suis d’autant plus posé la question que ce qu’elle décrit m’a rappelé deux situations.
- La première a été détaillée par Michel de Certeau dans L’invention du quotidien (paru en 1980). de Certeau expliquait que seul quelqu’un en position de domination peut déployer une stratégie où il pense avoir une vue d’ensemble de la situation. Celui qui est dominé n’a pas d’espace propre pour construire de tels calculs. Il agit pour le mieux en situation et développe des tactiques qui peuvent être tout à fait efficaces, mais qui sont plus locales et plus ad hoc. Juger et agir en situation, c’est bien ce dont il s’agit dans le consentement.
- Le deuxième écho concerne la littérature antillaise et la manière dont elle a été théorisée par Patrick Chamoiseau dans Ecrire en pays dominé (paru en 1997). A l’instar de Michel de Certeau, Patrick Chamoiseau dit que la situation de domination empêche d’écrire des histoires linéaires qui sont le propre de ceux qui disposent de moyens d’action suffisants pour déployer un agir technique rationnel et visible. La littérature antillaise, par contraste, est plus sinueuse, elle joue sur la répétition autour d’un but qui se dérobe sans cesse. En d’autres termes l’opposition obscurité / clarté doit quelque chose à la position que l’on occupe dans l’espace social.
L’amour à l’aune de l’amour du prochain
Voilà. Dans une relation à deux, que l’un propose et que l’autre dispose, cela peut s’entendre, à condition que les rôles ne soient pas figés. Clotilde Leguil est prudente, je le répète, et ne décrit nullement un supposé « éternel féminin » qui relèverait de la nature. Mais justement, si on s’interroge sur ce que peut être la relation entre deux êtres qui « aiment leur prochain comme eux-mêmes » pourquoi ne pas attendre et espérer, qu’ils puissent être deux sujets sur un pied d’égalité dont les désirs divergent, sans doute, mais cherchent à s’accorder en suivant des chemins analogues.
Un psychanalyste dira peut-être qu’un homme et une femme se construisent à partir d’histoires différentes. Mais différentes jusqu’à quel point ? Est-ce que la différence entre individus du même sexe n’est pas plus importante qu’entre les sexes ? Cela reste, pour moi, des questions ouvertes et il me semble, en tout cas, que la libération de la parole autour des abus sexuels, ces dernières années, pourrait conduire (au-delà de la dénonciation des forçages, indispensable par ailleurs) à vivre différemment la séduction et la vie amoureuse.





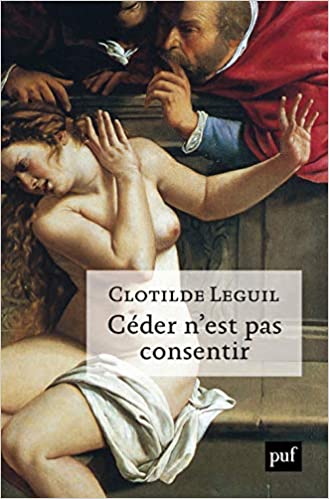 Autour du consentement
Autour du consentement