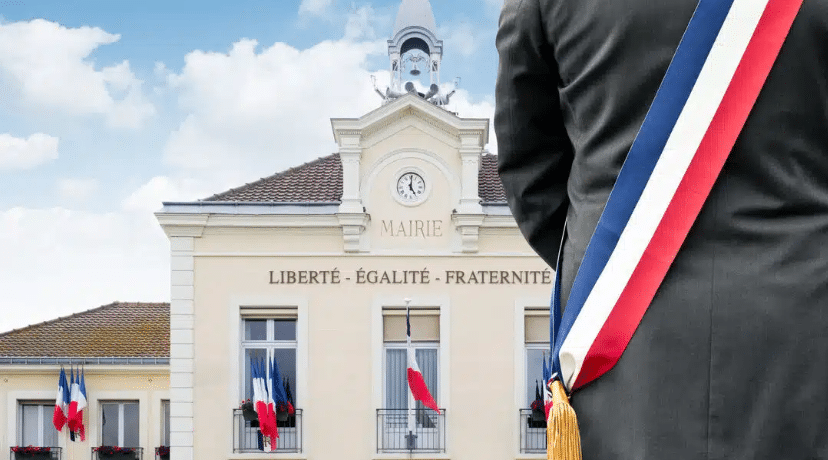On ne s’en rend pas forcément compte, mais la santé mentale des Français se dégrade. Elle engendre 14% des dépenses de santé : plus de 23 milliards d’euros par an, ce qui, quand on y réfléchit, est un chiffre énorme. Les confinements liés au COVID ont provoqué un pic, mais déjà, au cours des années 2010, les épisodes dépressifs ou anxieux, mineurs ou majeurs, avaient beaucoup augmenté (ils ont doublé entre 2014 et 2019 pour les hommes et augmenté de 50% pour les femmes qui partaient de chiffres plus élevés). Ils sont revenus, aujourd’hui, au niveau de 2019 et c’est, donc, une évolution sociale, antérieure au COVID lui-même, qui est en cause.
Les causes de cette dégradation sont multiples : perte de sens, isolement croissant, écoanxiété. Elles peuvent aussi résulter de situations pratiques qui mettent en tension ou qui sont objectivement anxiogènes. De ce point de vue, le travail peut aussi bien soigner que rendre malade : soit conférer un rôle et une activité dans le jeu social, soit, au contraire, enfermer dans un jeu de contraintes qui écrase. La conjonction, par exemple, d’une faible autonomie dans le travail et d’un fort niveau de contraintes, rend malade.
La pression croissante dans le travail rend malade
Aimer son prochain, c’est aussi se préoccuper des conditions de vie qui lui sont offertes ou imposées. Or ce qui se noue dans le travail dit beaucoup sur les rapports de domination, ou, au contraire, de coopération et d’ouverture qui se nouent dans la société : c’est une matrice de base qui conditionne souvent ce qui se joue dans les autres rapports sociaux.
Dans un document de synthèse publié, cet été, par le Ministère du Travail [1], on lit que les personnes qui déclarent avoir une bonne autonomie dans le travail avec pas trop d’intensité, font trois fois moins d’épisodes dépressifs ou anxieux que ceux qui déclarent une faible autonomie et une grande intensité ! Les auteurs vérifient (avec un luxe de précautions méthodologiques et d’outils mathématiques qui les honore, mais dont je vous fais grâce) que cela ne se résume pas à des caractéristiques de la personne qui préexisteraient à la situation de travail : quelqu’un qui va mal décrochera sans doute un travail moins motivant que la moyenne, mais la situation de travail actuelle joue, bel et bien, un rôle avéré.
On devine les inégalités sociales que cela provoque. Les femmes font deux fois plus d’épisodes dépressifs ou anxieux que les hommes. Elles expriment, sans doute, plus directement leur malaise. Mais elles sont, également, beaucoup plus sous tension : devant assurer une plus large part du travail domestique en sus de leur profession, se trouvant plus souvent seules avec des enfants et donc, avec une intensité du travail global plus élevée et moins de marge de manœuvre. Une autre inégalité se voit en suivant le niveau de diplôme : avoir un niveau de diplôme supérieur au bac protège. C’est, en effet, souvent le moyen d’avoir des métiers avec plus d’autonomie.
L’intensité du travail, aujourd’hui, doit beaucoup à des prescriptions qui s’ajoutent de manière désordonnée et contradictoire. Elle est le signe, en elle-même, d’une position subalterne où on n’a pas la possibilité de discuter ce qui est demandé.
Dans les enquêtes citées par le document, on la mesure au travers de la réponses positive à diverses questions comme : « travailler sous pression » ; « on me demande une quantité de travail excessive » ; « devoir toujours ou souvent se dépêcher pour faire son travail » ; « penser à trop de choses à la fois » ; « faire trop vite une opération qui demanderait du soin » ; « changements imprévisibles ou mal préparés » ; etc. La liste des items rappellera sans doute des contextes de travail familiers à beaucoup de salariés. Mais ce n’est pas parce que ce genre de pression désordonnée devient la norme que cela n’a pas de conséquences néfastes sur la santé. On ne peut pas demander sans cesse tout et son contraire à des salariés sans les mettre subjectivement en difficulté.
Le risque d’un travail en voie d’automatisation ou automatisable
Les auteurs de l’étude ont, par ailleurs, porté attention aux tâches qui paraissaient les plus faciles à automatiser (les plus standardisées et les plus normalisées). Elles provoquent une fragilité psychologique particulière chez les personnes qui les accomplissent. En utilisant des modèles qui permettent de raisonner « toutes choses égales par ailleurs » (ici aussi, je vous fais grâce des détails passablement techniques qui rendent une telle approche possible), on voit que cette fragilité est liée au risque perçu de perdre son emploi, ou bien de devoir changer de type ou de lieu de travail.
En clair, on peut discuter des effets macro-économiques des processus d’automatisation en cours, en disant, par exemple, qu’ils élèvent le niveau global de qualification des salariés. Mais ils engendrent des victimes collatérales qui sont loin d’être certaines de retrouver une place dans les postes de travail reconfigurés.
De fait, au fil du temps, ce sont les catégories d’ouvriers et d’employés dont les effectifs décroissent et elles sont prises en ciseau entre des professions intermédiaires qu’elles ne peuvent pas toutes intégrer et un fort volant de personnels de service (en position totalement subalterne), qui se maintient et qu’elles ont peur de devoir rejoindre. Et cette mise en tension a des conséquences sociales et électorales non négligeables : c’est là que l’on trouve les principaux réservoirs des votes populistes. D’ailleurs, et comme je l’ai écrit ici-même, le fait d’aller mal, physiquement ou mentalement, est corrélé au vote populiste.
On ne peut pas, en tant que chrétiens, se contenter d’une politique qui soutient l’économie, mais maltraite les travailleurs
La conclusion est brutale, même si elle est peu originale : les mutations économiques conduisent à maltraiter les travailleurs, salariés ou non, et cette maltraitance a des conséquences personnelles, intersubjectives et sociales fortes.
L’hostilité qui structure de plus en plus les rapports sociaux et dont on retrouve le résultat dans les urnes est une source de préoccupation majeure, pour moi. Et ce que l’on voit, ici, c’est qu’il ne suffit pas de quelques mots d’ordre d’appel au calme et à la bonne volonté, encore moins la recherche d’une autorité policière plus affirmée, pour faire face à ce problème. Les politiques menées ces dernières années, qui stimulent l’économie, créent des emplois, mais maltraitent les travailleurs sont en cause.
Il faut au moins, si on se prétend artisan de paix, ou si on tente de l’être, tirer la sonnette d’alarme.
[1] Sylvie Blasco, Julie Rochut, Bénédicte Rouland, Impact de l’intensification et de l’autonomie au travail sur la santé mentale, Valorisation de la recherche, 2024, n° 4.