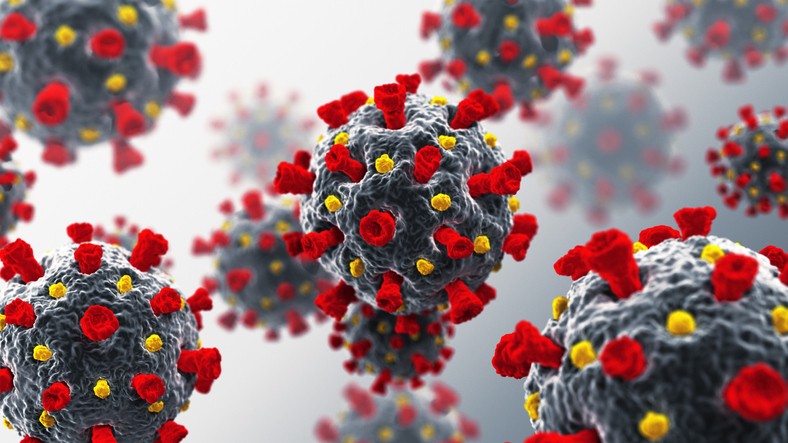La psychologie sociale ne cesse de répéter, à longueur d’articles, que notre manière d’interpréter les événements est la dernière chose que nous sommes prêts à modifier.
Pour prendre un exemple, les partisans de la théorie du complot ont trouvé une idée : le virus aurait été produit par un laboratoire. Autre variante : « ils savaient » ; c’est à dire que les gouvernants savaient, mais ont tardé à agir. Ces deux rumeurs me frappent, parce qu’elles sont (sans s’en rendre compte) porteuses d’une croyance désespérée dans la toute puissance des élites scientifiques ou politiques. Il semble plus confortable d’imaginer que l’on est la victime de quelques puissances machiavéliques, que d’accepter que personne ne savait, que nous avons tous été pris par surprise et que les scientifiques tâtonnent avant d’en savoir davantage. On pourra mesurer, après coup, ceux qui ont suivi la meilleure stratégie. On pourra gloser sur : « il aurait fallu ». Mais la vérité est que les retours d’expérience récents sur les épidémies antérieures ont joué contre la perception de l’épidémie actuelle. Donc on sait certaines choses. Les médecins peuvent soigner dans certains cas. Mais il y a beaucoup de choses que l’on ne sait pas. Et l’épidémie a pris tout le monde de vitesse. Certains pensent que l’on a confiné trop tard. Mais quand le confinement a été décrété, il a été plutôt mal accepté. Qu’est-ce que cela aurait donné une semaine plus tôt ?
Chacun reprend donc, d’abord, ses chevaux de bataille. Ceux qui pensent que la mondialisation est allée trop loin, soulignent le rôle des transports internationaux dans la diffusion de la pandémie. Les écologistes disent que notre mépris du vivant nous a rendus vulnérables à ce type d’événement. Les nationalistes en profitent pour rappeler qu’ils sont pour la fermeture des frontières. Les partisans du contrôle social soulignent l’efficacité des stratégies de suivi rapproché des individus. Ceux qui défendent le service public se réjouissent que la solidarité nationale et le rôle de l’état soient enfin reconnus à leur juste valeur. Seuls les partisans du libéralisme pur et dur sont un peu à cours d’arguments (mais ils seront au rendez-vous, n’en doutons pas, quand il s’agira de relancer l’économie).
Chacun s’accroche, mais, au fil du temps, il est évident que c’est, pour chacun d’entre nous, une claque magistrale. Notre croyance de base dans la maîtrise (même partielle et mesurée) de notre destinée est profondément ébranlée. Même si nous ne sommes pas touchés directement par la maladie, l’existence même de cette épidémie qui n’est pas sous-contrôle, est une blessure infligée à notre amour propre collectif et à la confiance fragile qui nous habite. Je me souviens d’un psychanalyste évoquant la réaction des ses patients face à l’événement du 11 septembre 2001. Il disait que plusieurs avaient fait écho à leur propre crainte de s’effondrer intérieurement. Je pense que la menace épidémique fait, elle aussi, écho à des craintes profondes en chacun de nous.
Des retentissements à long terme
C’est après, longtemps après, que cette blessure, ce traumatisme, aura des effets. Si je reviens à l’attentat contre les tours jumelles, il est clair qu’il a profondément changé la donne politique et qu’il a donné un coup de pouce décisif aux mouvements populistes. J’ai encore en tête la campagne présidentielle française de l’hiver et du printemps 2002 et sa progressive contamination par des thèmes de plus en plus noirs, jusqu’au 21 avril qui a propulsé Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Et la France n’est qu’un cas parmi d’autres. Dans la plupart des pays, les thèmes xénophobes et sécuritaires qui étaient déjà présents se sont considérablement renforcés, à partir de cette date. Une barrière s’était effondrée dans la protection que les pays riches pensaient avoir contre les attentats de grande ampleur.
Aujourd’hui aussi, une barrière est en train de s’effondrer. On compte les morts et, grâce à la mobilisation de toutes les énergies, il est possible, qu’au final, on arrive à une surmortalité du même ordre de grandeur qu’une mauvaise grippe annuelle (soit, environ, 15.000 décès en France). Mais cela aura été au prix d’un effort sans commune mesure avec la routine d’une grippe hivernale.
Les jours de confinement qui s’ajoutent les uns aux autres, les nouvelles de proches ou de connaissances atteints par la maladie, la difficulté à venir à bout de ce germe, resteront dans les mémoires. Cela n’engendrera pas forcément des effets positifs, pas forcément non plus des effets entièrement négatifs. Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, on n’en sait rien.
Le leçon du livre de Job
Je lis ces événements à partir de ma grille d’interprétation personnelle (il n’y a pas de raison que j’échappe à la règle commune) qui est largement le fruit de mon histoire, et notamment l’histoire des claques que j’ai essuyées.
La naissance, puis l’évolution lente et laborieuse d’une fille handicapée, dans mon foyer, a été une de ces claques où, contraint et forcé, j’ai dû constater que le devenir des mes proches m’échappait de manière radicale.
La blessure que j’ai subie (pour ne parler que de moi, mais toute ma famille a été impactée) a prolongé ses effets pendant des années. Elle m’a conduit à lire, puis à relire le livre de Job. J’ai même écrit un ouvrage à un moment de cette lecture (Sur les routes d’une sagesse nouvelle, le livre de Job, Emmaüs, 1998). J’ai encore approfondi ma réception du livre depuis. Dans ce livre, les amis de Job cherchent à avoir une prise rationnelle sur les événements malheureux. Ils ressemblent à ceux qui fantasment sur la toute-puissance des élites : il faut qu’il y ait un coupable. Job, pour sa part, crie que le malheur l’a blessé personnellement et que c’est injuste. Et finalement Dieu répond. Cette réponse ne nous est pas directement accessible, car elle est remplie d’images poétiques dont il faut aller rechercher les codes dans les textes de l’Antiquité. Mais, en gros, Dieu dit à Job qu’il a concédé un espace et un temps pour le mal et que telle est la destinée (de la nature et de l’homme) qu’il a conçue. Job tombe des nues, mais la réponse, finalement, le satisfait.
Les chrétiens repenseront à cette réponse, au cours de la semaine sainte qui commence, où on fait mémoire du moment où le Christ a lui-même payé le prix de cette puissance (limitée mais réelle) concédée au mal. Dieu ne s’est pas payé de mots en répondant à Job : il a assumé en personne cette situation.
Au bout du compte, il n’y a pas de « parce que » et de « pourquoi », il y a une histoire dans laquelle nous sommes embarqués. Quand j’ai admis que ma fille avait une vie diminuée, mais que c’était sa vie, que c’était une vie possible, je suis sorti du tunnel. Et je repense à cette leçon ces jours-ci. Il n’y a pas de « parce que » et de « pourquoi ». Naturellement, on pourra tirer des enseignements de cette expérience. Mais d’autres événements nous surprendront.
Je peux le dire différemment, en citant la parabole de l’ivraie. « Il en va du Royaume des cieux comme d’un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu ; par-dessus, il a semé de l’ivraie en plein milieu du blé et il s’en est allé. Quand l’herbe eut poussé et produit l’épi, alors apparut aussi l’ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il s’y trouve de l’ivraie ? Il leur dit : C’est un ennemi qui a fait cela » (Mt 13.24-28). Voilà : il y a des événements hostiles qui se mettent en travers de notre route.
Alors au bout de la parabole de l’ivraie, au bout du livre de Job, il y a Dieu. Mais ce n’est pas un technocrate éclairé qui vient régler les problèmes en quelques secondes. C’est une présence qui se tient à nos côtés et qui nous rejoint dans notre histoire complexe et difficile, parce qu’il a voulu avoir des enfants qui se confrontent à la réalité du mal, qui fassent leurs choix et qui aient les moyens d’être vainqueurs du mal par le bien. Dieu vient vers nous, comme il est venu en Jésus-Christ : il vient là où nous sommes. Il est, il a été, il sera vainqueur du mal par le bien, mais cela suppose d’être prêt à se heurter au mal en question.
Voilà le fruit de cette histoire qui est la mienne. Elle me donne une assise pendant ces journées chahutées.
Et, finalement, c’est une leçon optimiste : la blessure que j’ai connue m’a, au fil des années, renforcé, elle m’a donné les moyen de faire face à des coups du sort, alors que, pendant longtemps, elle avait commencé par m’affaiblir. Il est donc possible que la cicatrisation nous rende plus forts. Oui, c’est possible.