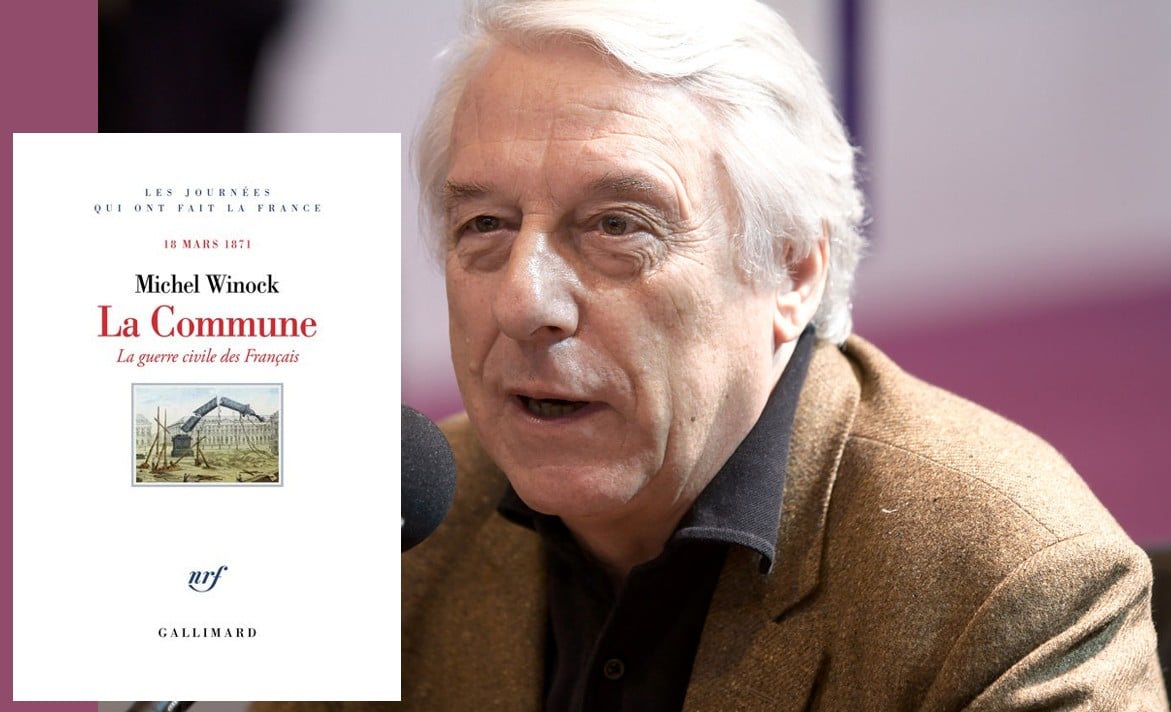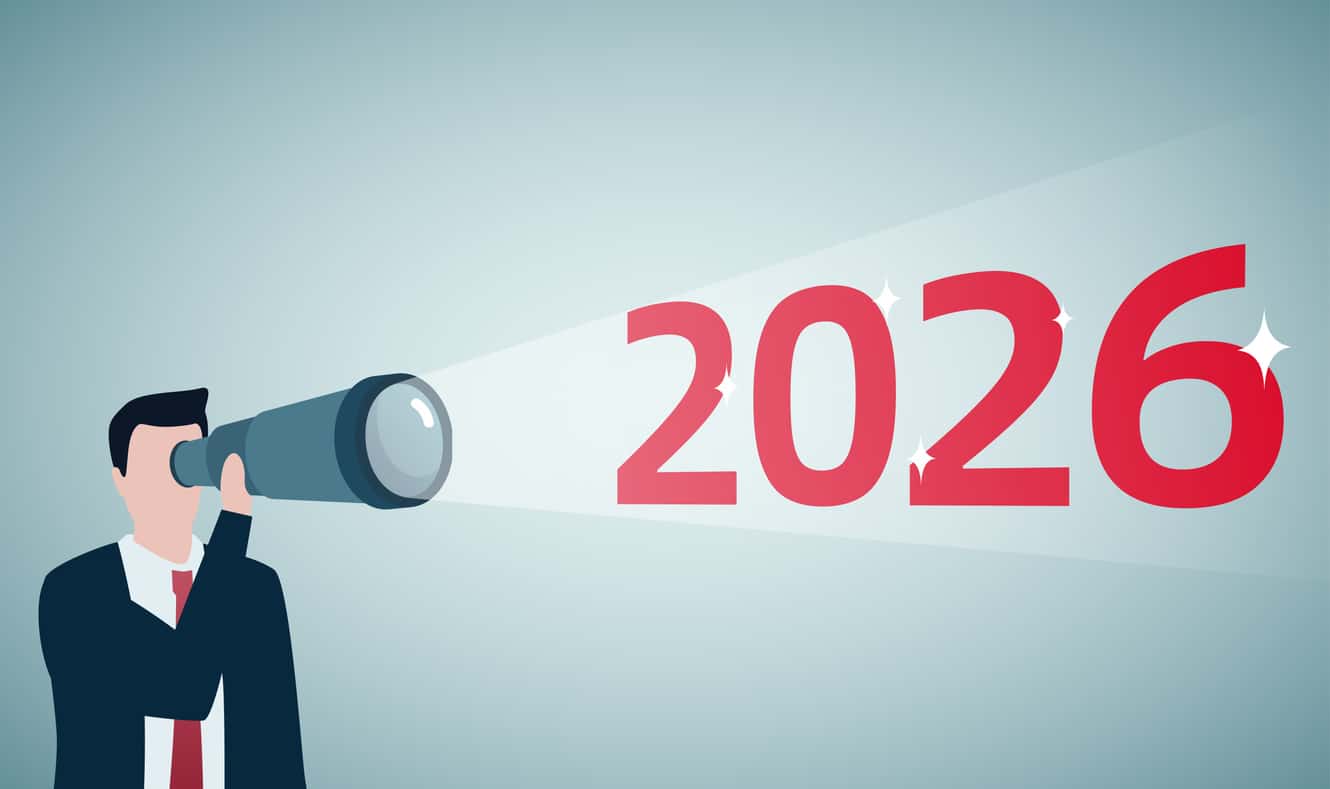Les avez-vous vues, ces petites automobiles surmontées d’un mégaphone, haut-parleur de fortune, qui parcourent les villes et les plages à la conquête des estivants ? Portées par une passion de tous les diables, à toute allure et de toutes couleurs, elles promettent monts et merveilles : « A 20 heures ce soir, un spectacle éblouissant, des artistes exceptionnels, des rires, et des voltiges, oui, mesdames et messieurs, venez nombreux ce soir, Esplanade des pins-parasols et vous serez conquis. » Les cirques, en été, distribuent plus qu’il n’en faut de l’enfance.
Donnés pour mort, en France, à la fin des années soixante-dix, les cirques ont été sauvés par la volonté de Jack Lang, ministre de la Culture (de 1981 à 1986, puis de 1988 à 1993). Par un système de subventions, par un encouragement à la création d’écoles et de formations rigoureuses, l’Etat a donné une impulsion formidable à un secteur jusque-là réduit à des expédients, parfois des pratiques financières obscures. De nos jours, on compte environ 450 compagnies de cirque, un chiffre qui a été multiplié par cinq en vingt ans. L’engouement des spectateurs en est la raison majeure.
Si l’on en croit le ministère de la Culture : « de toutes les disciplines de spectacle vivant, le cirque est celle qui enregistre le plus faible taux de non public. Seulement 22% des Français de 15 ans et plus déclarent n’être jamais allés à un spectacle cirque au cours de leur vie, tandis que 42% ne sont jamais allés au théâtre. »
La langue du cirque
Longtemps, le cirque a vécu suivant des codes aussi bien techniques que poétiques dont le vocabulaire traduisait la singularité. Agnès Pierron, linguiste, en a répertorié les richesses dans un ouvrage passionnant : « Le dictionnaire de la langue du cirque » (Stock, 593 p. 42,60 €). Ainsi répertorie-t-elle une foule de numéros : le numéro à Bluff, qui mise sur les apparences, le numéro baronné, qui utilise un comparse que l’on surnomme baron et qui, souvent, joue les ivrognes, ou bien encore « un numéro de cycle dans la tête », image qui désigne une personne qui devient légèrement zinzin ; quelques mots rares : la gardine est un rideau, la stracasse un saut périlleux exécuté sur place, les pantres des individus qui ne font pas partie du milieu circassien ; enfin différentes sortes de femmes : araignée, canon, fantôme, girafe, mouche, projectile, crocodile, gorille, ou de multiples espèces d’hommes : canon, caoutchouc, de barrière, de bronze, de l’entrée, de marbre, obus, renversé, serpent.
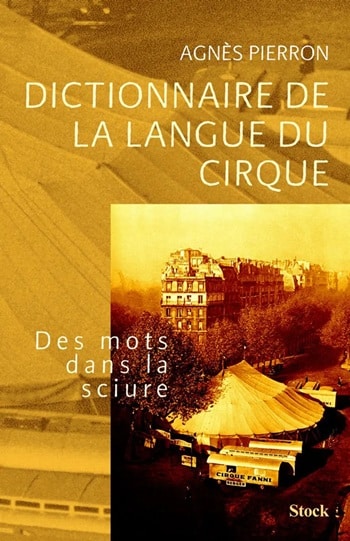
N’allez pas croire que ce beau monde se montre libre de tout engagement. Quand les comédiennes et les comédiens se laissent prendre au jeu de l’infidélité, les circassiens cultivent une rigueur de comportement que les risques pris justifient : les scènes de ménage sur un trapèze ou dans la cage aux fauves pourraient provoquer des accidents.
Parlons-en, justement des accidents. « La plupart des artistes ont eu des accidents de gravité variable, explique Agnès Pierron. L’accident est toujours en suspens chez le circassien. Il peut même être anticipé ; « Quand j’aurai mon accident, je ferai les colombes ou la barbe à papa. » La menace permanente du tragique a longtemps justifié l’atmosphère un peu trouble régnant parmi les spectateurs ; avoir peur par procuration, trembler pour le dresseur ou la voltigeuse, n’est-ce pas aussi se rappeler qu’en nous dort un sadique assoiffé de sang ?
Mais dans une société qui cherche à refouler la mort, à condamner toute forme de violence, il était inévitable que la tradition soit un peu bousculée.
Cirque traditionnel et « Nouveau cirque »
Comme le note Agnès Pierron : « le cirque est hybride et impur. Sa meilleure part se trouve dans son étonnante faculté à intégrer ce qui se passe. » Le cirque traditionnel et ce que le nomme le « Nouveau cirque » se sont rapprochés. Les artistes sont attachés quand les voltiges sont très dangereuses, et des filets se dressent partout, gages de tranquillité. La protection des animaux a provoqué la disparition des lions, des tigres, éléphants. Le pasteur Michel Leplay, dont la mémoire nous est chère, avait d’ailleurs publié, en 2020, « Quel Cirque ! » (Ampelos, 14,50 €), livre dans lequel il dénonçait le mauvais traitement infligé aux bêtes féroces dans la cage des dresseurs. Les nostalgiques peuvent le déplorer, qui n’aimaient rien tant que les sensations fortes et le parfum des ménageries. Mais cette évolution semble irréversible, imposée par les pouvoirs publics, sensibles à l’évolution de l’opinion.
Le cercle de sciure et de sueur demeure un espace où le sacré s’invite sous le trivial. Bien à l’abri d’un ciel de toile et d’étoiles, chapiteaux d’un soir, installations de quelques jours, il vous sera possible de croire à l’incroyable. Du 22 au 26 juillet, se déroulera le Festival de cirque d’été à Niort. Au menu : du cirque néo, contemporain, traditionnel, forain… Pinder – malgré quelques bisbilles entre père et fils – arpentera la région du Grand-Est jusqu’au début du mois d’août, pendant que le cirque Zavatta parcourra la Vendée et l’île de Ré. La famille Morralès, qui tente la fusion des genres circassiens, donnera quelques spectacles dans le sud-ouest. Un bonheur fugace, des souvenirs pour toujours.