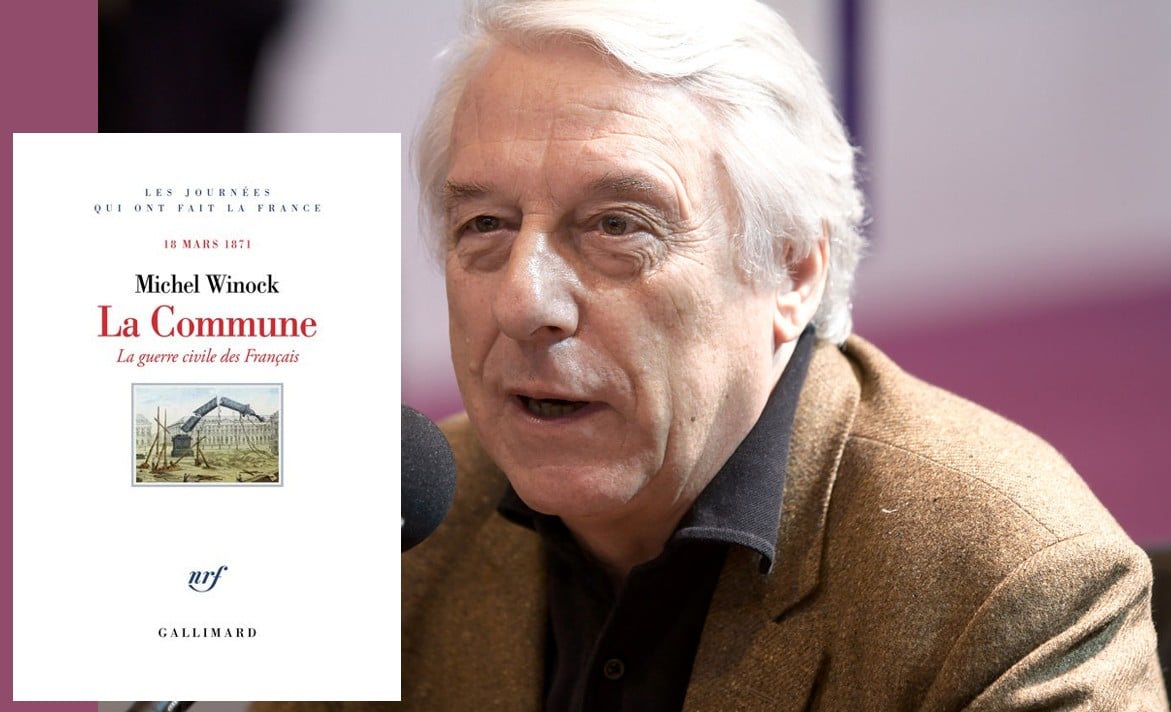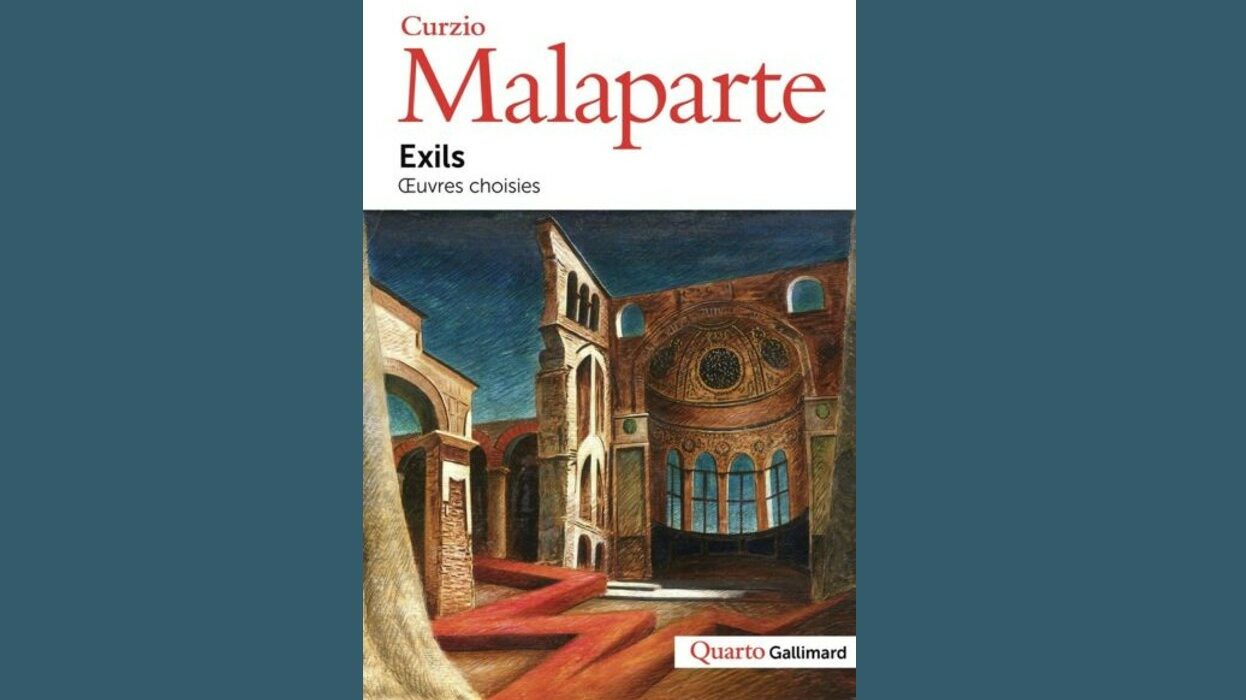De toute éternité l’avenir a fait peur. Il suffit de consulter les archives de l’INA pour constater que nombre de nos concitoyens, durant les années cinquante, soixante et soixante-dix, en dépit du réel progrès dont ils bénéficiaient, regardaient les changements que nous jugeons positifs comme des ruptures épouvantables, un abandon fatal, une course à l’abîme.
« Nos trente glorieuses »
Sous cet angle, on aime l’album d’Armelle Leroy et Laurent Collet, « Nos trente glorieuses », (Albin Michel) non seulement parce qu’il est drôle, tendre et richement illustré, parsemé de références à cet élan d’optimisme qui traversa la France autrefois, mais parce qu’il rappelle aussi, sans perdre son humour, en sous-titre : « c’était mieux avant, mais pas pour tout le monde ». Une leçon de sagesse, car enfin, faut-il rappeler qu’en France il y eut quelques morts et de nombreux blessés pendant les grandes grèves de 1947 et 1948 ? Qu’au mois d’octobre 1962 la guerre nucléaire passa si près que le chapeau de Khrouchtchev en tomba deux ans plus tard ? Aux lecteurs qui veulent offrir un cadeau joyeux mais perspicace, on recommande ce livre.

Pour de vrai, c’est bien la marche du temps, qui nous effraie. Chaque génération, redoutant la mort, projette l’ombre de ses tourments sur la jeunesse qui vient. Triste topique. A quoi bon regarder les menaces qui pèsent, la pression qui s’accroît, si nous restons figés sur de vieilles représentations ?
« Un monde sans boussole »
L’ouvrage d’Amin Maalouf qui paraît ces jours-ci chez Bouquins, regroupement de quelques livres édités depuis trente ans, porte un titre prémonitoire : « Un monde sans boussole ». Il nous invite à la lucidité. « L’époque dont il s’agit, c’est celle où nous nous trouvons encore et dont nous subissons chaque jour les secousses, explique en préface l’écrivain, secrétaire perpétuel de l’Académie Française. Nous ne savons évidemment pas sur quoi elle pourrait déboucher, mais nous pouvons déjà affirmer avec certitude qu’elle se distingue nettement de toutes celles qui l’ont précédée, et qu’elle mérite d’être contemplée avec attention et avec clairvoyance. »
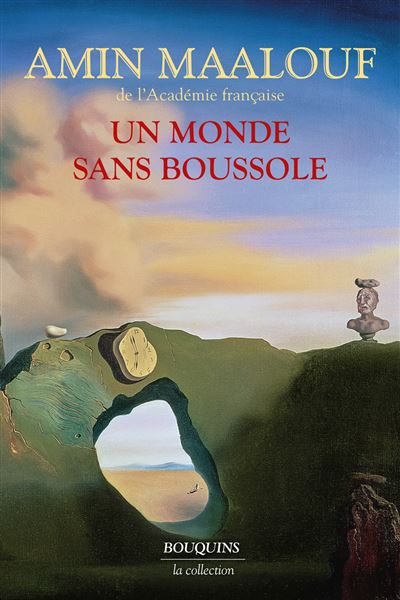
On aime l’attention de l’auteur à ce que l’on pourrait prendre pour un détail – ainsi le décompte méticuleux des bulletins de votes en Floride, à l’automne 2000, battement d’aile de papillon de l’Histoire qui modifia le cours des choses, puisque l’élection d’Al Gore à coup sûr n’aurait pas entraîné la seconde guerre du Golfe et la ruine du crédit des Etats-Unis au Proche et Moyen-Orient, quoiqu’elle n’eût pas empêché les attentats du 11 septembre. On aime surtout l’articulation que propose l’auteur à l’endroit de l’imaginaire et des identités. Puisant sa réflexion sur la guerre entre israéliens et palestiniens, considérant que tous les juifs et tous les arabes ont un rôle à jouer dans la recherche de la paix, Amin Maalouf écrit ceci : « Le souhait que je viens de formuler concernant le rôle des diasporas rejoint chez moi un espoir plus ample, et qui concerne l’ensemble des populations migrantes, où qu’elles soient, d’où qu’elles viennent et quelles qu’aient pu être leurs trajectoires. Elles ont toutes des liens puissants avec deux univers à la fois, et elles ont vocation à être des courroies de transmission, des interfaces, dans les deux sens. S’il est normal qu’un migrant défende, dans son pays d’accueil, une sensibilité venue de sa société d’origine, il devrait être tout aussi normal pour lui de défendre, dans son pays d’origine, une sensibilité acquise au sein de sa société d’accueil ».
Migrations, modernité et nouveaux équilibres humains
Bel humanisme qui prend en considération les bouleversements de notre monde. A cet instant le souvenir nous revient de Tobie Nathan, psychologue, ethnopsychiatre bien connu, pour qui la démocratisation du transport aérien puis l’avènement d’Internet ont profondément modifié les rapports que les migrants peuvent entretenir avec les habitants de leur pays d’accueil, obligeant les uns et les autres à des aménagements, des compromis, des prises de conscience inédites.
Une scène politique polarisée
Sur un plan politique, on voit bien que cette affaire n’est pas, comme on le dit de façon familière dans les estaminets, de la petite bière. A droite, Bruno Retailleau, patron du parti Les Républicains, veut reprendre la main dont le Premier ministre l’a privé, durcir la législation sur le narcotrafic et les tendances islamistes qui selon lui traversent l’islam, en France, aujourd’hui. Face à lui, comme on le devine, la France Insoumise hurle à l’islamophobie mal déguisée. Entre les deux, le silence et la candeur paraissent avancer de concert.
Ne pourrions-nous pas regarder ces questions de manière plus sereine ? Au cours des années quatre-vingt, la gauche a laissé penser qu’elle abandonnait l’usage symbolique du drapeau tricolore à l’extrême-droite. Elle commettrait une faute nouvelle en permettant au Rassemblement national de prétendre défendre la cause des femmes, l’égalité des citoyens devant la loi, la justice sociale. De son côté, la droite gagnerait à larguer les amarres que lui tendent Marine Le Pen et Jordan Bardella, devrait renouer avec ce qui fait sa marque de fabrique : la conjugaison d’un conservatisme de fidélité et la prise en compte d’une aspiration légitime à l’évolution des sociétés.
Mais déjà l’inquiétude nous gagne. Ces quelques phrases ne sont-elles pas pétries de clichés ? Pour lutter contre les idées reçues, rien de plus stimulant que la chronique de l’essayiste Pierre Larrouy : « Des signifiants à l’insignifiant ». Chacun d’entre vous peut la consulter en ligne. En voici quelques mots :
« Nous ne sommes pas dans une époque du conflit, mais dans une époque de la simulation du conflit. Le clash est devenu un code, l’insulte un format, l’excès un style. On ne transgresse plus : on mime la transgression. On ne rompt plus : on joue la rupture. On ne dérange plus : on occupe. Ce n’est pas la colère qui manque – elle est partout. Ce qui manque, c’est la coupure. Cette chose qui fait le véritable contenu dystopique par sa capacité d’invention. Car il y a une différence radicale entre un mot qui excite et un mot qui fracture. Le premier réveille les nerfs, le second déplace l’os. Le premier crée du bruit, le second transforme la charpente invisible du monde. Or nous avons fabriqué une langue qui ne touche que la surface. Tout circule, rien ne s’imprime. Tout claque, rien ne marque. »
Le règne des « signifiants vides »
Et cet économiste, essayiste inspiré par la culture psychanalytique, d’expliquer les méfaits du vide conceptuel dont nous sommes abreuvés, notamment depuis que le « en même temps », version new-look du mitterrandien « ni-gauche-ni droite » a pris le contrôle de la parole présidentielle : « Ce discours repose sur une vieille illusion : celle de l’évidence partagée. « Tout le monde est d’accord », dit-on. « Il faut être pragmatique. » « On voit bien que ça ne marche pas. » Cette rhétorique ne cherche pas l’adhésion, elle la présuppose. Elle parle à la place de l’opinion, elle ventriloque le peuple en feignant de l’écouter. C’est là que les signifiants deviennent insignifiants. Podemos, en Espagne a théorisé de tels procès et s’est directement inspiré d’Ernesto Laclau (La raison populiste). Idée centrale : Un signifiant vide n’unit pas parce qu’il dit quelque chose de précis mais parce qu’il est assez vide pour que chacun y projette ses propres attentes. Exemples typiques chez Podemos : “Le peuple”, “La caste”, “La démocratie réelle”. »
A partir de ce constat, que faire ? Eh bien poursuivre, chacun suivant son inclination, chacun suivant sa sensibilité, la recherche d’un juste équilibre – ce qui doit se distinguer d’une molle complaisance à l’endroit de la pensée. L’avenir est à vous.