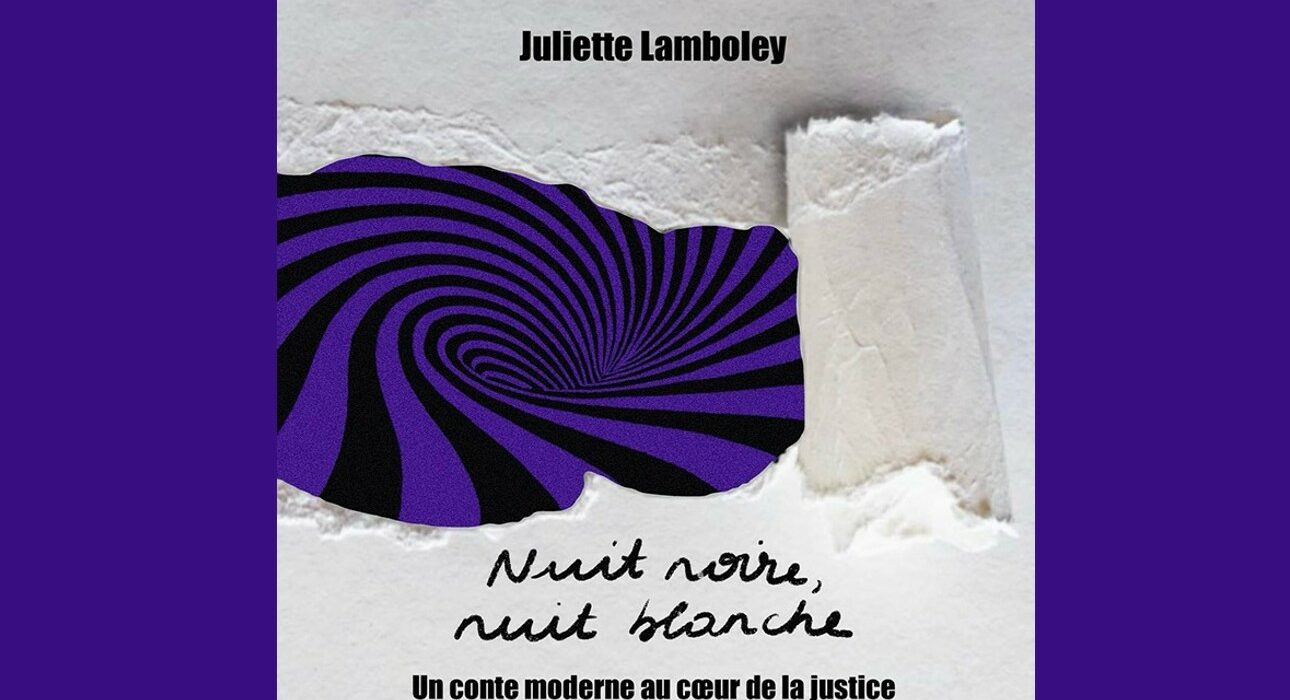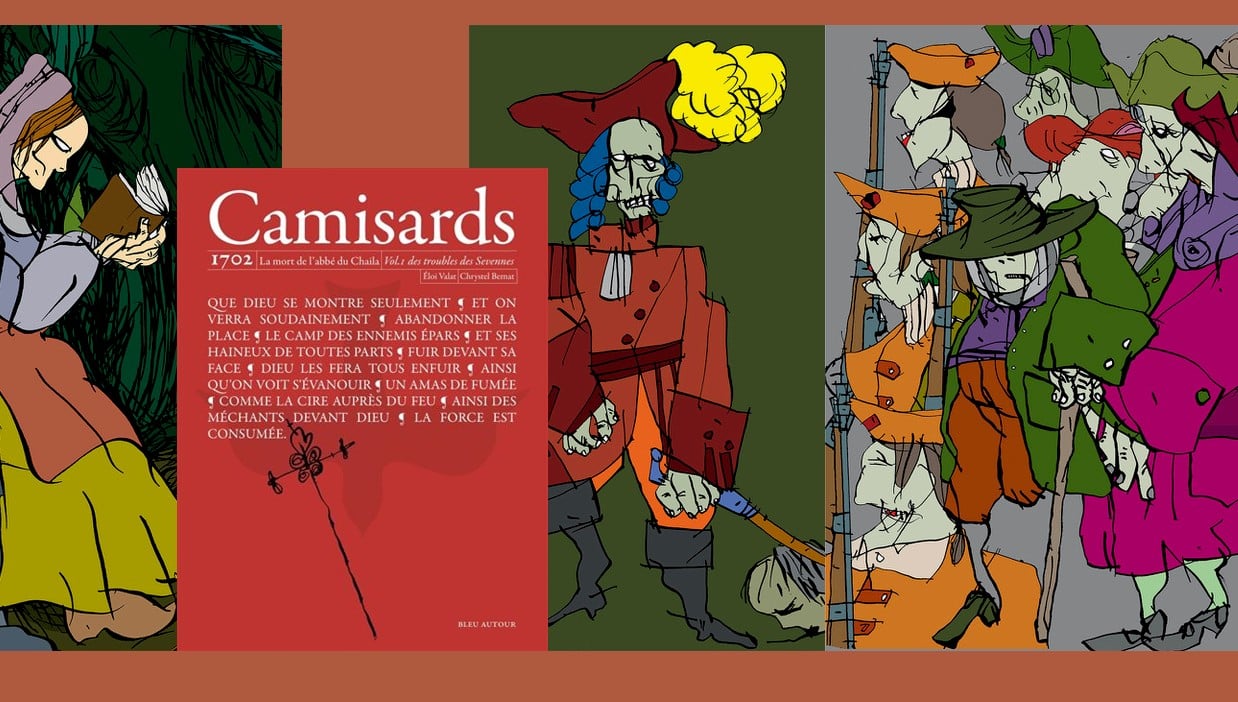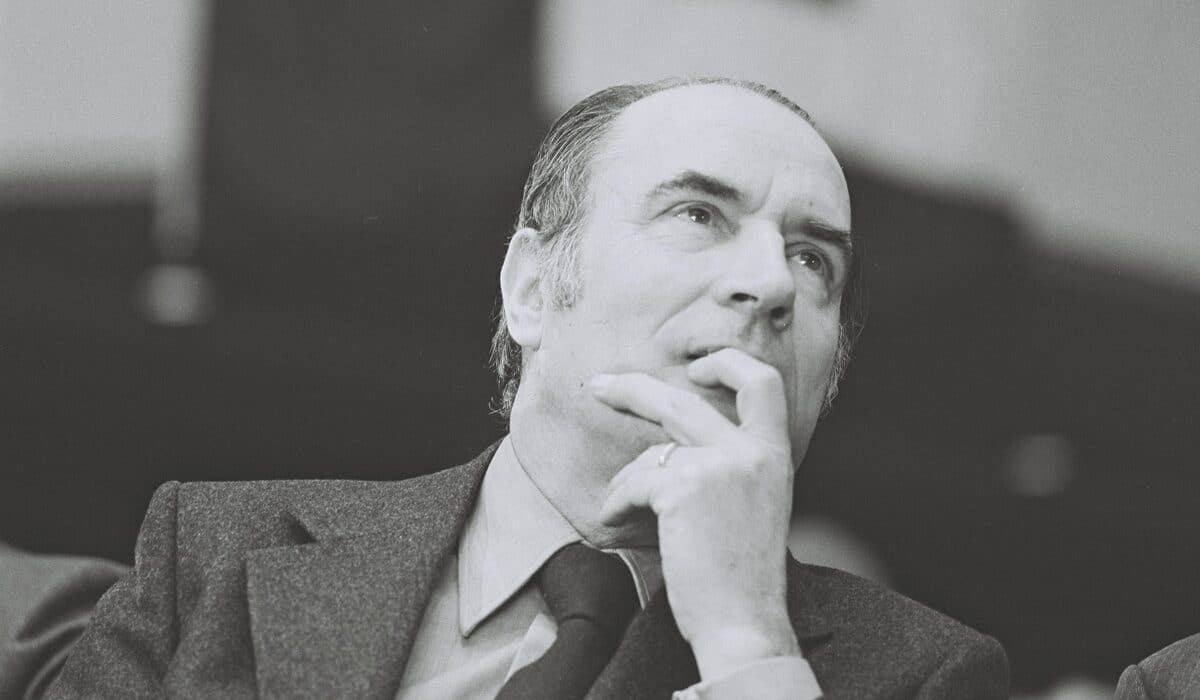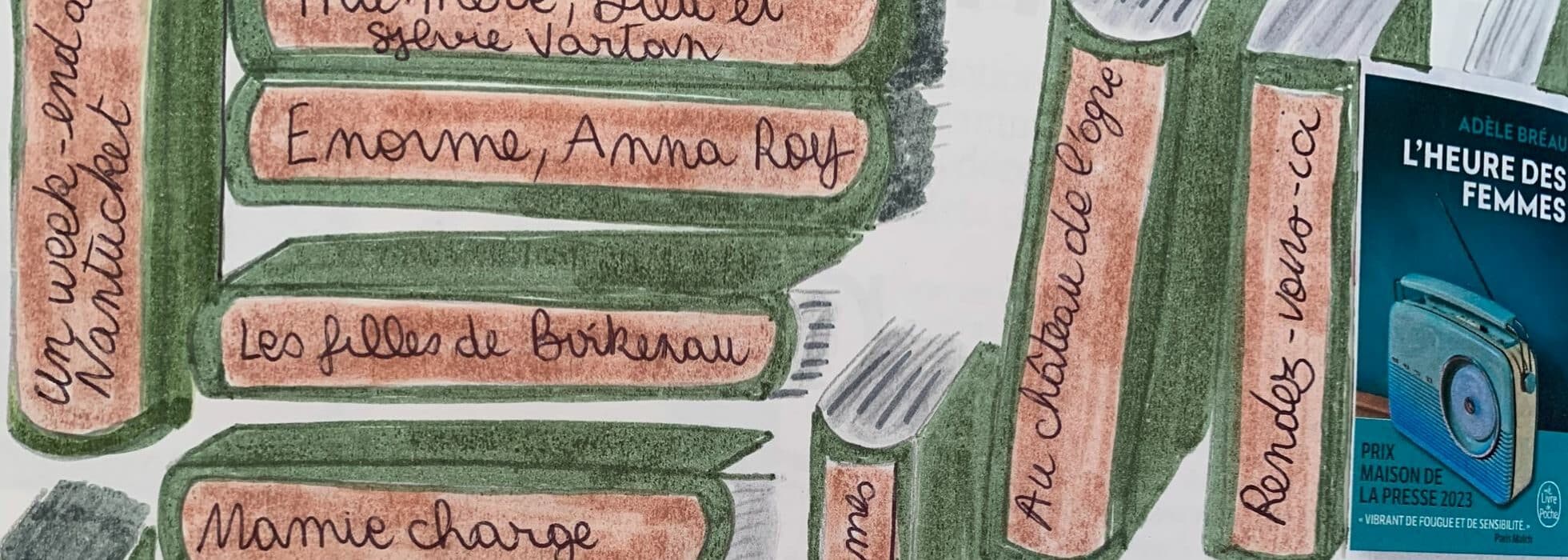La fiction sonore a parfois ce pouvoir singulier : mettre en scène ce que l’on n’arrive pas à dire autrement. Avec Nuit noire, nuit blanche, Juliette Lamboley signe une œuvre intime et nécessaire, née d’une histoire personnelle et transfigurée en un conte moderne, au cœur même de la justice. Produite par Paradiso Media et Labo Studio, cette série audio en huit épisodes d’un quart d’heure chacun sera disponible à partir du 25 septembre sur toutes les plateformes d’écoute.
Comédienne depuis l’adolescence, on l’a vue dans 15 ans et demi avec Daniel Auteuil, dans la série Les bracelets rouges, au théâtre dans Edmond d’Alexis Michalik, Juliette Lamboley prend ici une autre place : celle d’autrice et de témoin. Car le point de départ de cette fiction est un épisode de sa propre vie, enfoui durant des années, avant de resurgir par un hasard qui n’en est pas vraiment un. Tout commence par des retrouvailles avec une amie de collège, Gigi, devenue avocate après un drame. Au fil d’une soirée joyeuse, elle lui confie qu’elle a choisi sa vocation après avoir été témoin direct d’un viol, celui vécu par Juliette… mais que cette dernière avait refoulé. « Amnésie traumatique, on appelle ça », écrit-elle. De ce souvenir retrouvé naîtra une plainte, et avec elle, cinq années de procédure judiciaire.
Une fiction sonore au cœur du parcours judiciaire
Nuit noire, nuit blanche plonge l’auditeur dans ce parcours. Non pas comme un documentaire brut, mais sous la forme d’un récit sonore où la poésie se mêle à la douleur, où le conte éclaire la réalité sans l’édulcorer. « Il y a des contes qu’on nous lit enfant, et ceux qu’on découvre adulte. (…) En suivant au plus près une procédure de dépôt de plainte pour viol, ce podcast en fait partie. » La citation, extraite du texte de la série, dit bien la volonté de Lamboley : transformer l’expérience individuelle en une histoire partagée, qui ouvre les yeux sur ce que signifie réellement « porter plainte ». Dans un paysage médiatique où les témoignages post-MeToo ont trouvé un écho puissant, l’originalité de Nuit noire, nuit blanche est de faire entendre la voix de la justice, avec sa temporalité, ses lenteurs, ses épreuves. Que se passe-t-il une fois la porte du commissariat franchie ? Qu’implique d’affronter, devant la loi, ce qui a déjà brisé une vie ? La fiction sonore se fait ici pédagogie sensible, rendant audible un chemin souvent invisibilisé.
La voix devient acte de résistance
Mais si le sujet est sombre, l’écriture et la mise en scène sonore ouvrent aussi des espaces de lumière. C’est tout le sens du titre : une oscillation entre la nuit du traumatisme et la blancheur fragile de la résilience. On pense aux contes modernes qui, derrière les ténèbres, laissent filtrer une possibilité de reconstruction. En cela, Juliette Lamboley ne livre pas seulement un témoignage : elle invente une forme artistique où le réel devient partageable, où la voix devient acte de résistance. La série s’inscrit ainsi dans une tradition nouvelle du podcast français : celle de la fiction engagée, qui fait dialoguer la mémoire individuelle et l’expérience collective. Elle rappelle que la honte, comme on l’a souvent dit à l’époque de MeToo, doit changer de camp. Et que l’art, même dans ses formats les plus intimes, peut y contribuer.
Avec Nuit noire, nuit blanche, Juliette Lamboley ne raconte pas seulement son histoire. Elle offre une œuvre qui interroge, bouscule et accompagne. Un récit qui se vit à l’écoute comme une traversée : éprouvante, nécessaire, mais jamais désespérée. Entre la nuit du silence et la clarté fragile de la parole, se joue souvent le combat de toute vie blessée : trouver une justice, mais aussi une espérance.