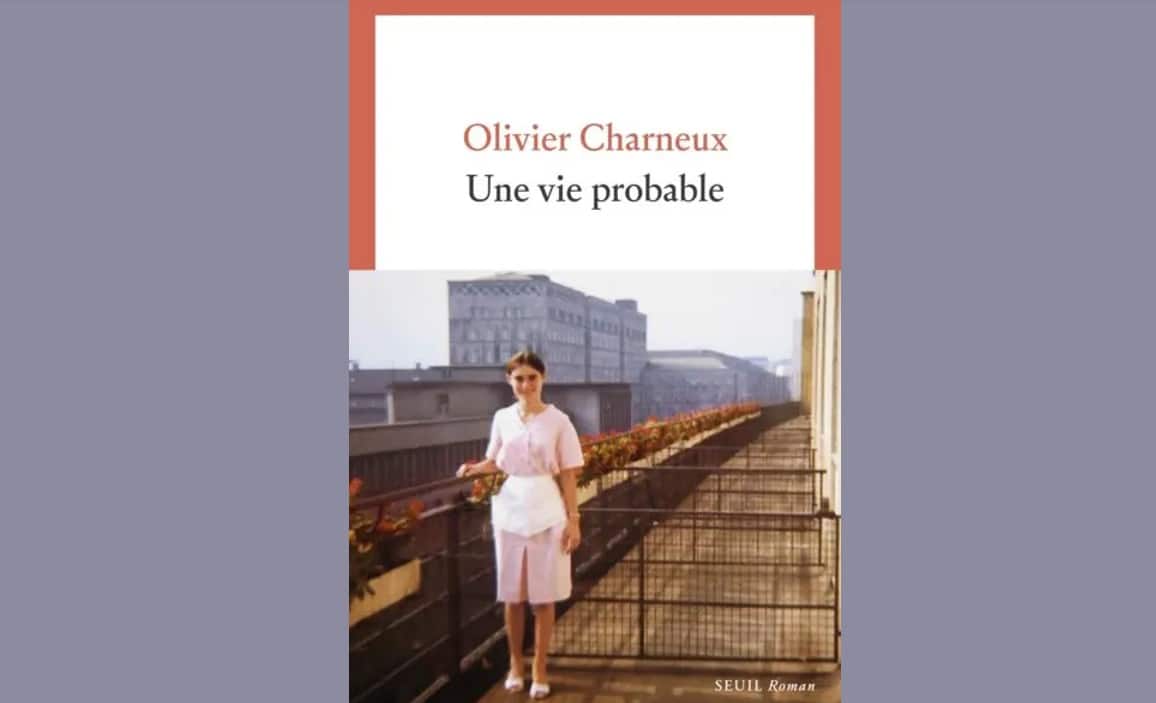La révolution numérique nous laissait envisager une ouverture sur le monde, une mise en réseaux de la terre entière, un élargissement de la conscience à toutes les réalités vécues par nos contemporains, l’instauration harmonieuse d’un village planétaire. Las ! Ces promesses ne semblent guère avoir été tenues.
La mondialisation de la communication et de l’information produit en retour nombre de crispations identitaires, nationalistes, ethniques ou religieuses. Mais surtout, nous sommes entrés dans l’ère de la culture du silo : rien ne nous plaît davantage que l’entre-soi, rien ne nous rebute plus que l’altérité. Nous nous retrouvons avec ceux qui partagent nos goûts, nos convictions, nos engagements. Les fameux biais de confirmation conduisent à privilégier tout ce qui conforte nos opinions, et à refouler tout ce qui les mettrait en cause. Les réseaux sociaux sont l’expression la plus visible de ce déficit de « monde commun ».
Que faire pour retrouver le goût de la rencontre, de l’accueil de la différence, de la bienveillance inconditionnelle envers ceux qui pensent, vivent, croient autrement ?
Renoncer au quant-à-soi, se laisser déplacer par la parole de l’autre. Penser contre soi-même, cultiver la posture contre-intuitive. Varier nos sources d’information, lire les textes publiés par ceux qui ne nous ressemblent nullement sur un plan politique, idéologique, éthique, religieux.
À l’université, espace privilégié de l’esprit critique et autocritique, on suscite des disputatio, sous forme de jeux de rôles, en demandant aux étudiants de défendre la position qui au départ n’est pas la leur. Et si nos Églises pouvaient favoriser la sortie de la culture du silo ? Être chrétien, c’est peut-être parcourir, et reparcourir chaque jour, le chemin qui mène de Babel à la Pentecôte.
Frédéric Rognon, professeur de philosophie, pour « L’œil de Réforme »