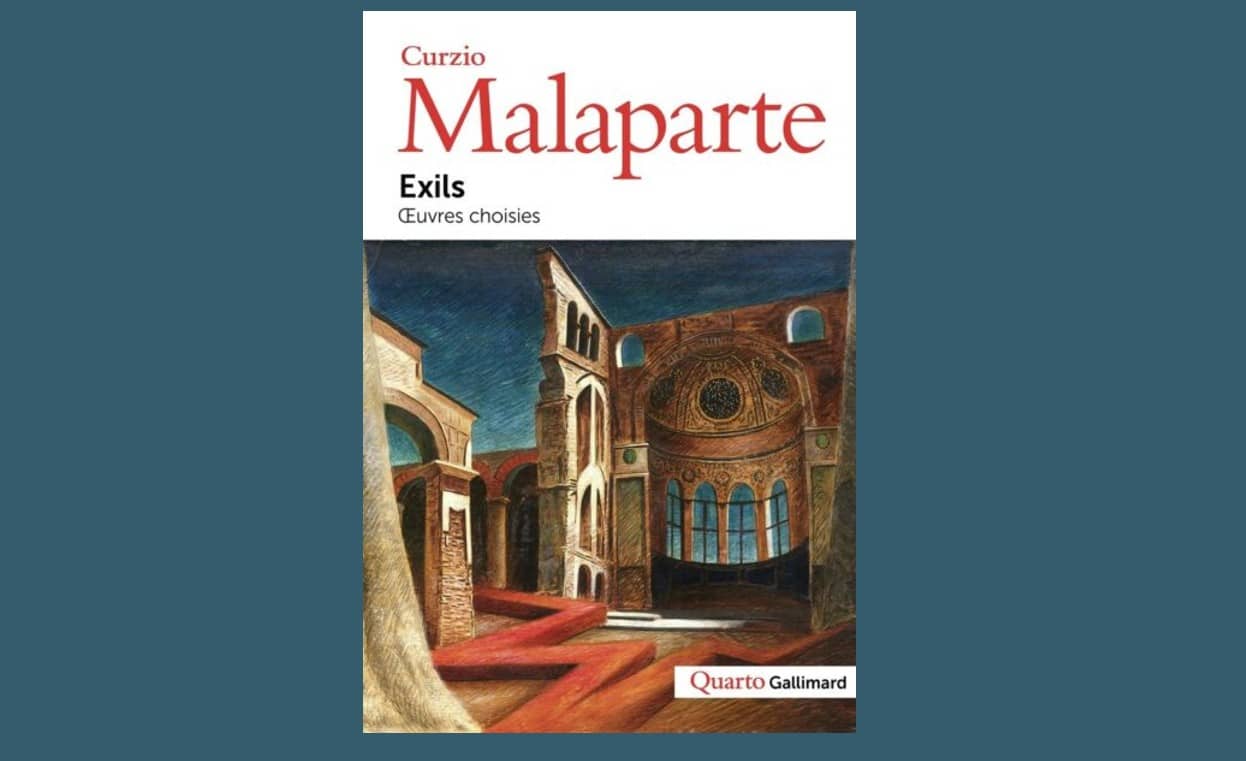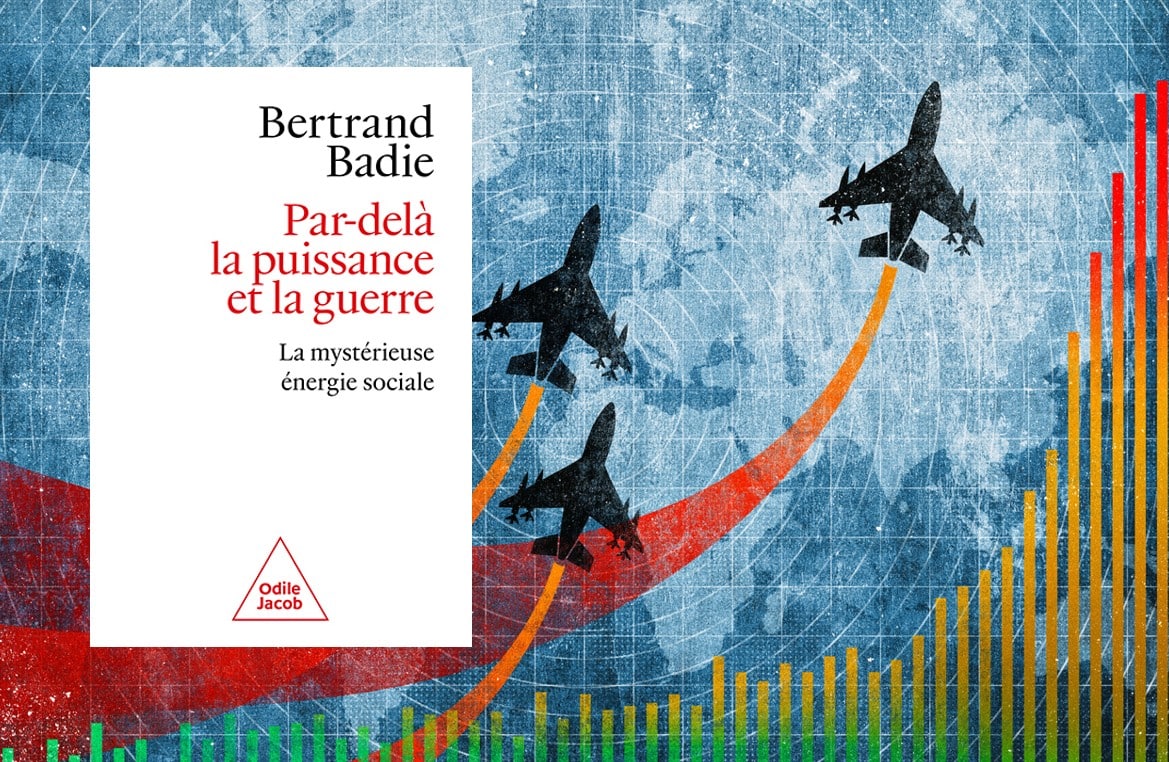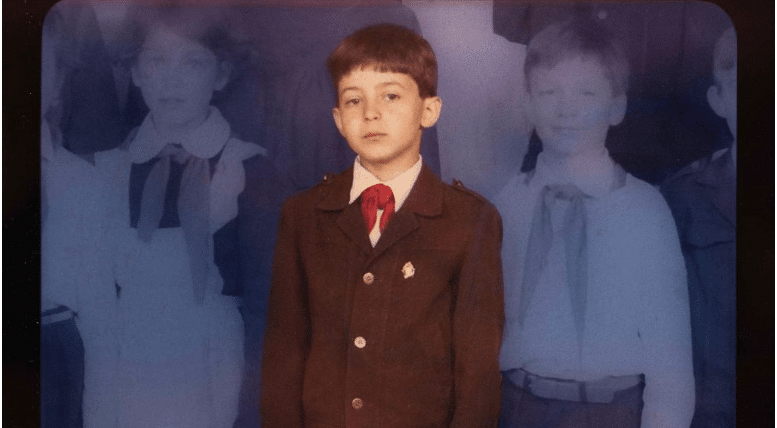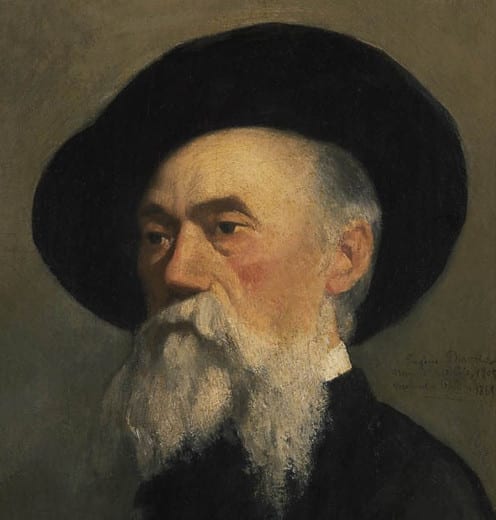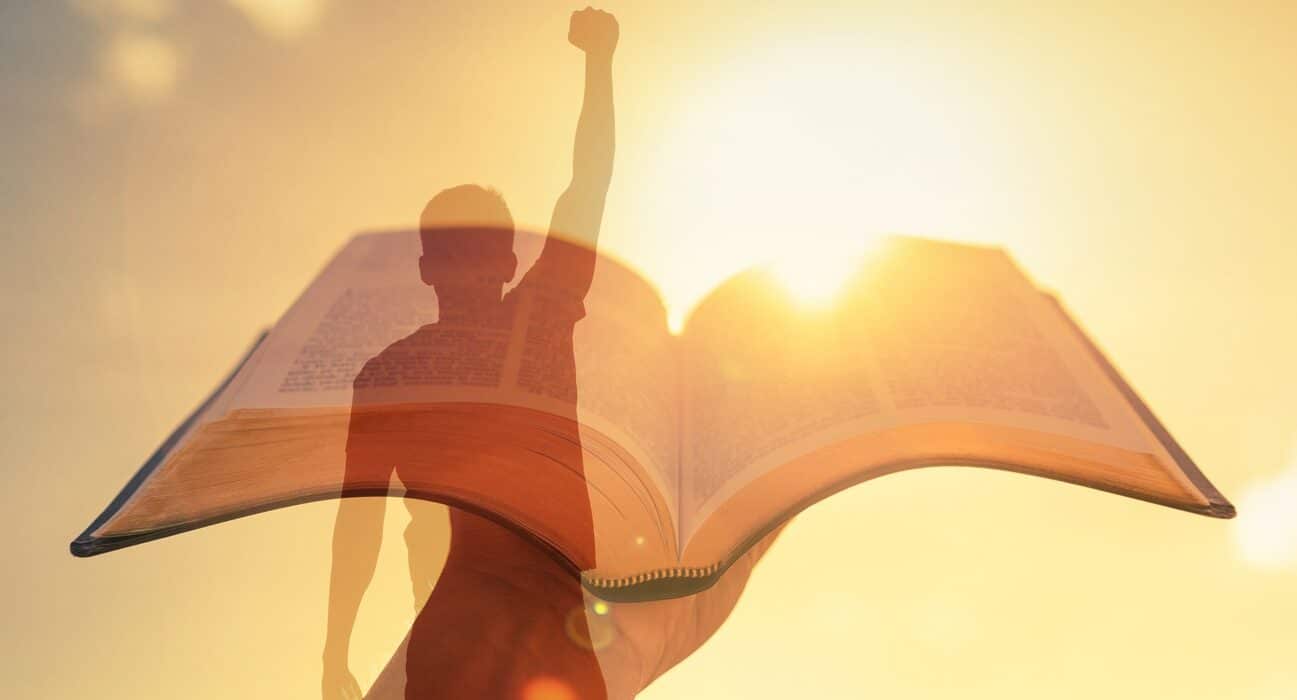En février 2025, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a produit une étude intitulée : De la banalisation de la violence verbale au discours de haine. Décrypter, mieux agir pour restaurer le lien social.
Nous le constatons : la violence verbale – insultes, dénigrements, menaces, mépris, caricatures, stigmatisations – est aujourd’hui monnaie courante dans l’espace et le débat publics, en France, aux États-Unis, et ailleurs. Transports en commun, établissements scolaires, monde du travail, services publics, réseaux sociaux, médias, classe politique sont aujourd’hui traversés par des discours de haine, xénophobes, racistes, antisémites, homophobes, etc.
Or, l’usage de la parole a un autre but. Comme l’écrit Jean-Marie Muller, « l’homme reconnaît l’autre lorsqu’il entre en conversation avec lui. Reconnaître l’autre, c’est lui parler. Le langage est ainsi l’acte de l’homme raisonnable qui renonce à la violence pour entrer en relation avec l’autre. L’essence de la parole est accueil et bienveillance, hospitalité et bonté. Lorsque la parole devient malveillance et violence, elle se renie elle-même. L’essence du langage est non-violence. Faire violence, c’est toujours faire taire, et priver l’homme de sa parole, c’est déjà le priver de sa vie » (Dictionnaire de la non-violence, Le Relié-Poche, 2014).
Voici – parmi bien d’autres – deux versets de la Bible qui, s’ils étaient appliqués dans notre société, pourraient la rendre plus paisible : « Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l’excite » (Proverbes 15.1). « Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun » (Colossiens 4.6).
À bon entendeur…
Christophe Hahling, pasteur, pour « L’œil de Réforme »