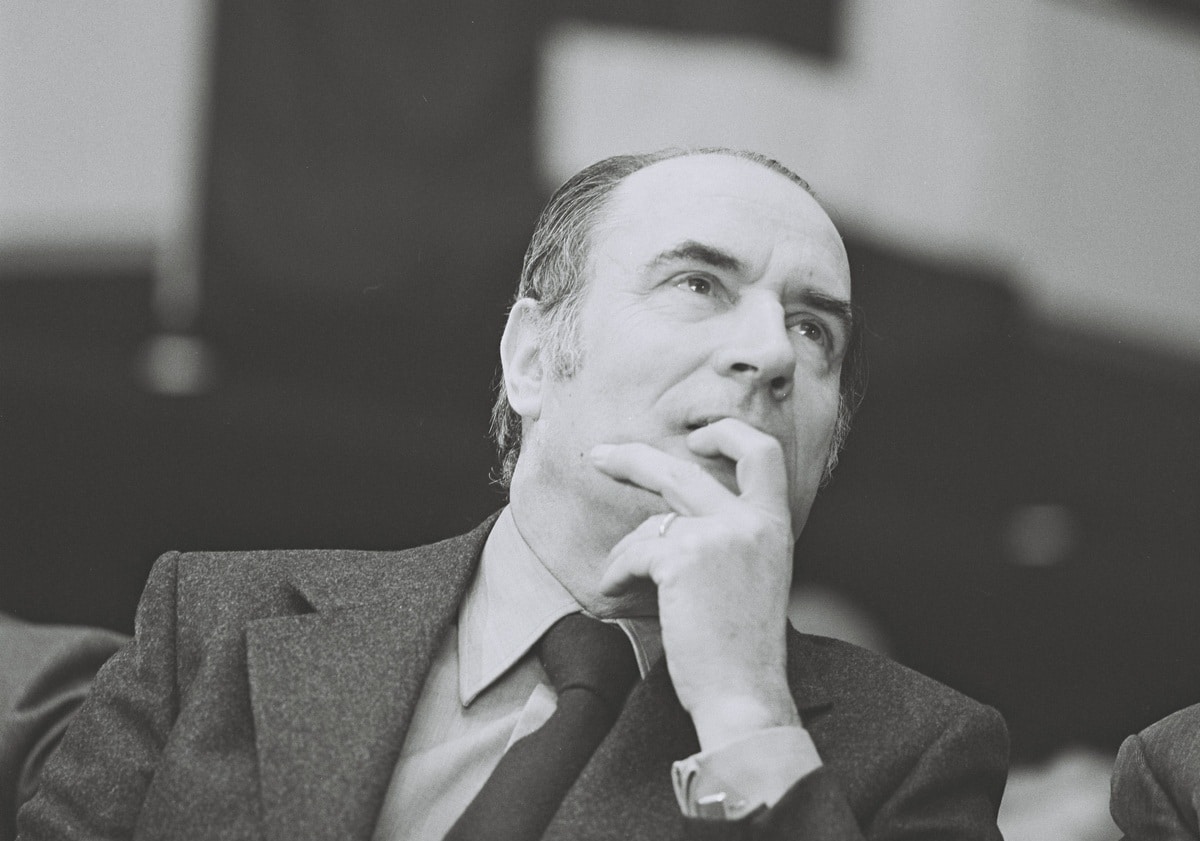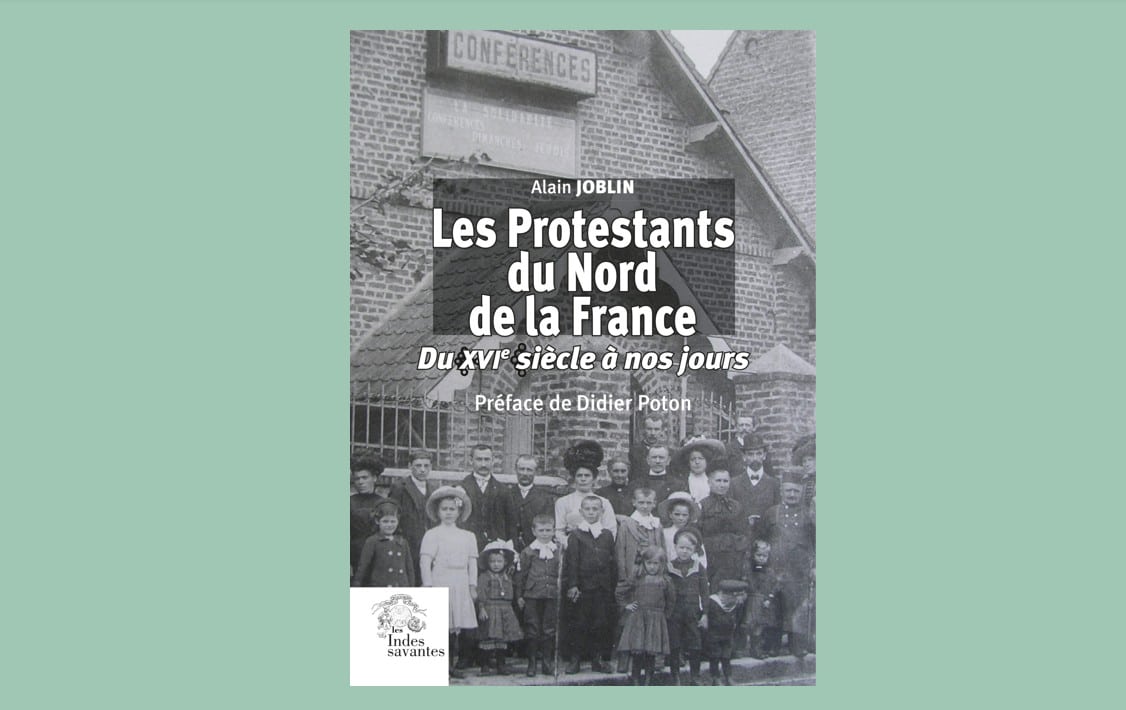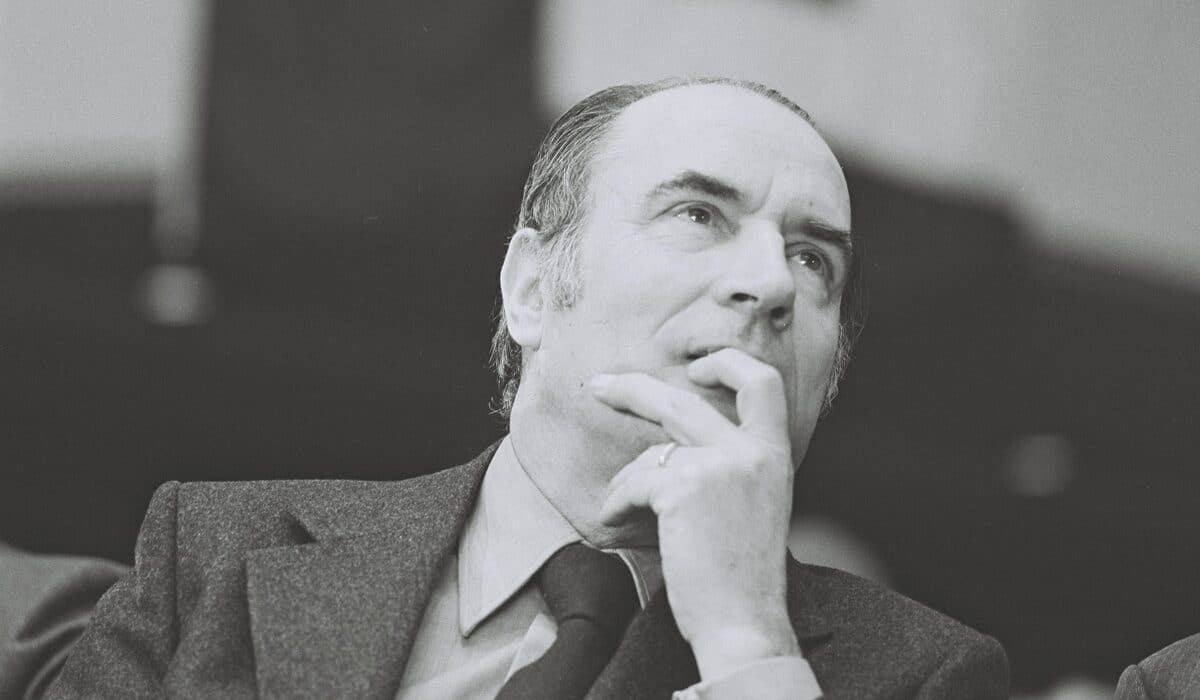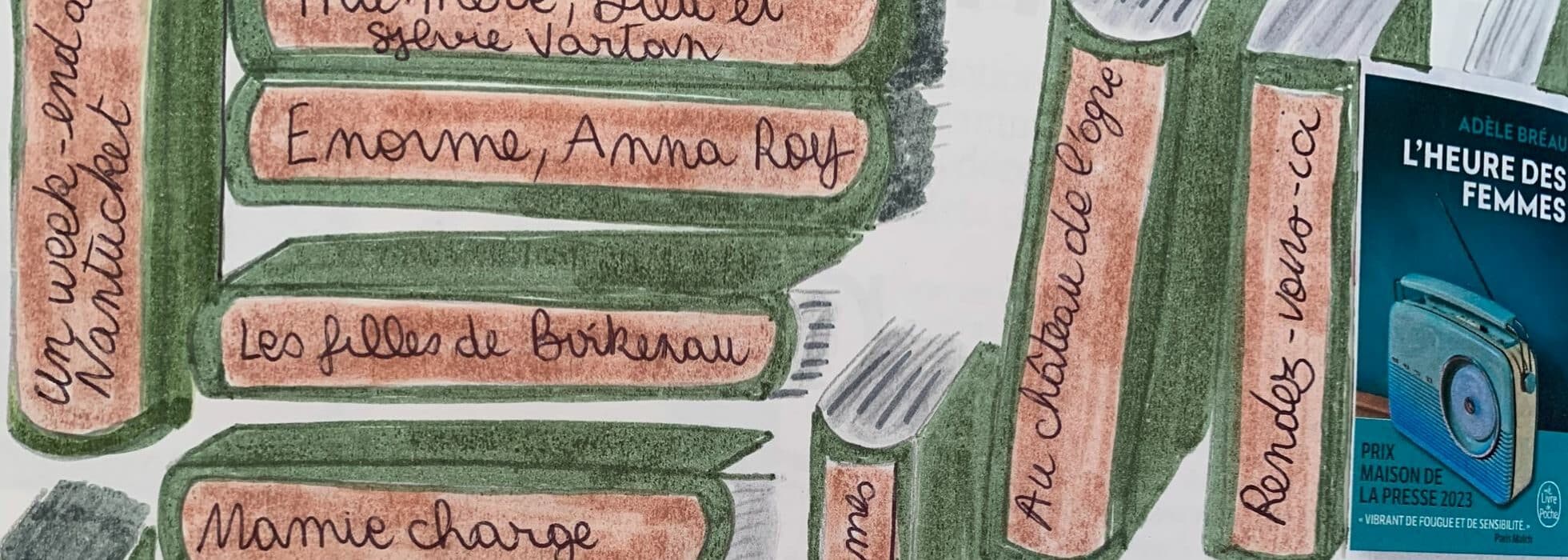La condamnation de Nicolas Sarkozy à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt à effet différé et avec exécution provisoire a été décrite comme un choc, voire un séisme.
Sans même avoir pris connaissance du jugement, les deux types de commentaires habituels dans ce genre d’affaire se sont répandus : pour les uns, justice est passée, l’égalité de chacun devant la loi respectée ; pour les autres, beaucoup plus bruyants, il s’agit de la décision scandaleuse d’une justice politisée et haineuse.
Les dénonciateurs du gouvernement des juges, souvent ceux-là mêmes qui réclament davantage de sévérité et fustigent le laxisme de la justice, ont donné de la voix. Ce n’est cependant pas pour exposer les faits, objets du procès, ou décrypter les questions juridiques, mais pour laisser croire que ce qui anime les juges serait la volonté revancharde d’imposer leur pouvoir.
Or, le travail du juge consiste à examiner des faits et à déterminer s’ils constituent une infraction prévue par la loi. Il ne s’agit pas d’exprimer un sentiment, une position personnelle, mais d’accomplir une tâche qui exige la mise en œuvre d’une méthode.
L’application du droit requiert un apprentissage, une connaissance et une pratique. Ce travail se traduit par la motivation du jugement, soit l’exposé des faits et leur analyse juridique, ici en près de 400 pages. Bien loin des officines complotistes fantasmées par nombre de contempteurs ignorants. La discussion juridique est bien sûr fondée. Le dénigrement malveillant de l’institution qui incarne la justice est délétère.
La condamnation d’un ancien président de la République est certes un événement. Elle remet en cause la sacralisation du monarque républicain. C’est peut-être le signe d’une démocratie qui assume l’indépendance de sa justice.
Jean-Marc Defossez, magistrat, pour « L’œil de Réforme »