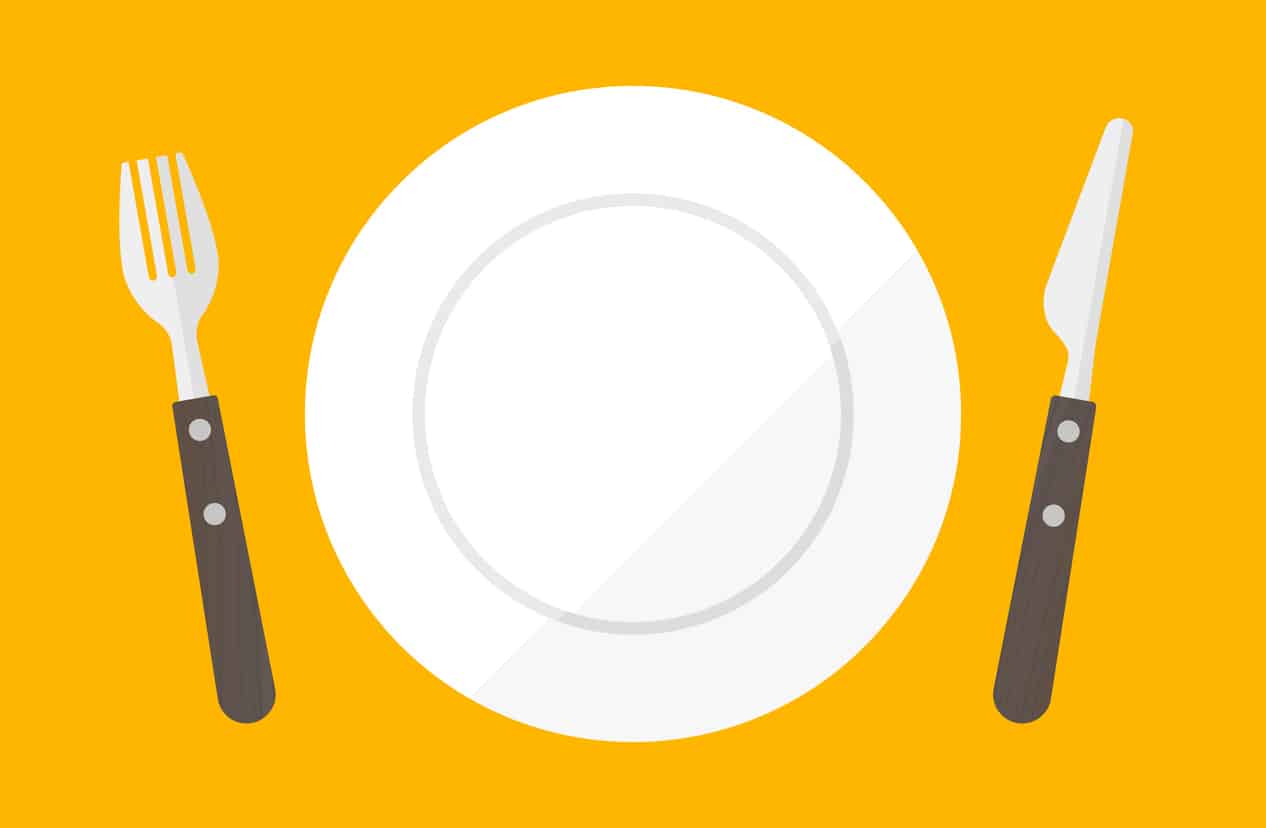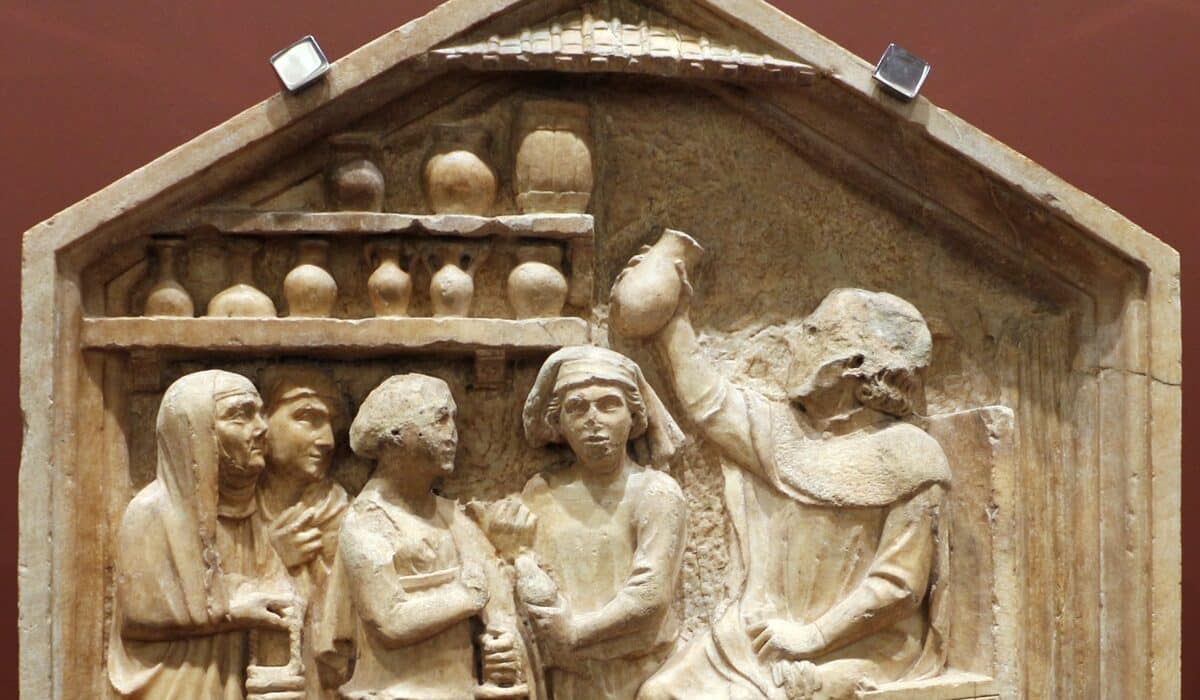La polarisation est devenue la norme sur les réseaux sociaux. Non seulement encouragée par les algorithmes, elle est aujourd’hui méthodiquement recherchée. La brutalisation des échanges n’est plus une dérive, mais une stratégie politique. Dans un espace régi par la visibilité plutôt que par la qualité, le scandale devient l’arme centrale de la guerre discursive. Ce qui importe, c’est de choquer, de faire réagir, de générer de l’audience – fût-ce au prix de la vérité ou du respect de l’autre.
La haine banalisée
Chaque fait divers devient le prétexte d’un récit simplificateur. La haine s’attaque à des figures floues – l’étranger, le journaliste, l’élite… – et prospère sur les stéréotypes, la méconnaissance et l’efficacité de sa diffusion. L’autre est une figure travaillée, non pour dialoguer, mais pour s’y opposer et renforcer les assises communautaires. À force de répétitions, l’opinion s’habitue, adhère, et propage. La haine se pare alors d’atours nobles : elle s’approprie des références historiques valorisées, invoque Jean Moulin ou l’esprit de la Résistance, détourne les symboles pour légitimer ses attaques. Elle se prétend respectueuse, « résistante à la pensée unique », défenseuse d’une vérité que d’autres voudraient censurer.
Dans ce contexte, comment réagir ? Appeler à plus de modération semble illusoire tant les plateformes, de plus en plus opaques, peinent à encadrer les abus. Le récent rachat par Elon Musk de X n’est qu’un des signes de cette tendance. La modération peut-être facilement détournée et pose la question du choix de l’instance capable de modérer.
Les débats qui ont encadré, en 2019, la loi Avia en France démontrent la difficulté de cette question. Faut-il alors s’indigner ? Oui, mais à quel prix ? La parole critique expose à la meute numérique, au cyberharcèlement, à l’épuisement émotionnel. Pour beaucoup, le silence devient une stratégie de survie.
Une nécessaire éducation
Car, derrière la violence numérique, se cache une crise plus large : fatigue démocratique, informationnelle, défiance généralisée… Les réseaux ne sont pas la cause, mais l’amplificateur de ces fractures. Un sursaut démocratique collectif est nécessaire, seule solution possible face à la violence numérique.
Peu à peu, face à la montée des populismes, l’opinion publique se mobilise et la stratégie du scandale s’expose aux yeux de tous. Pour que celle-ci devienne intolérable, l’éducation aux médias est un levier essentiel. Il faut apprendre dès le plus jeune âge – et tout au long de la vie – à repérer les manipulations, à mesurer la portée de nos paroles, à comprendre les effets réels de la violence en ligne. Combien d’utilisateurs, impliqués dans des attaques numériques, affirment ne pas avoir mesuré la gravité de leurs actes ? Le gouvernement a lancé un plan contre le cyberharcèlement à l’école. C’est un premier pas. Mais il est temps que la lutte contre la violence numérique devienne une priorité nationale.
L’utopie d’un web démocratique n’est pas morte. À condition de reconnaître que notre naïveté numérique nourrit sa violence. Il est temps de la combattre, ensemble.