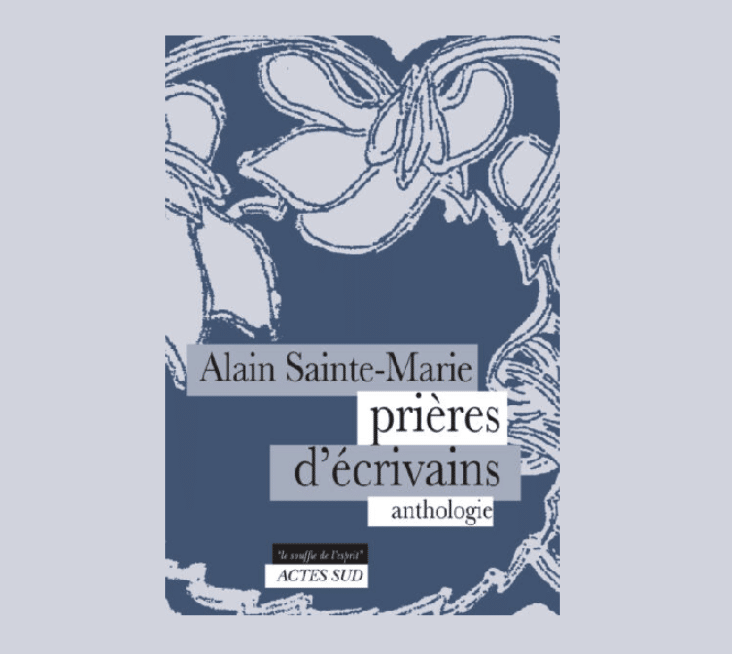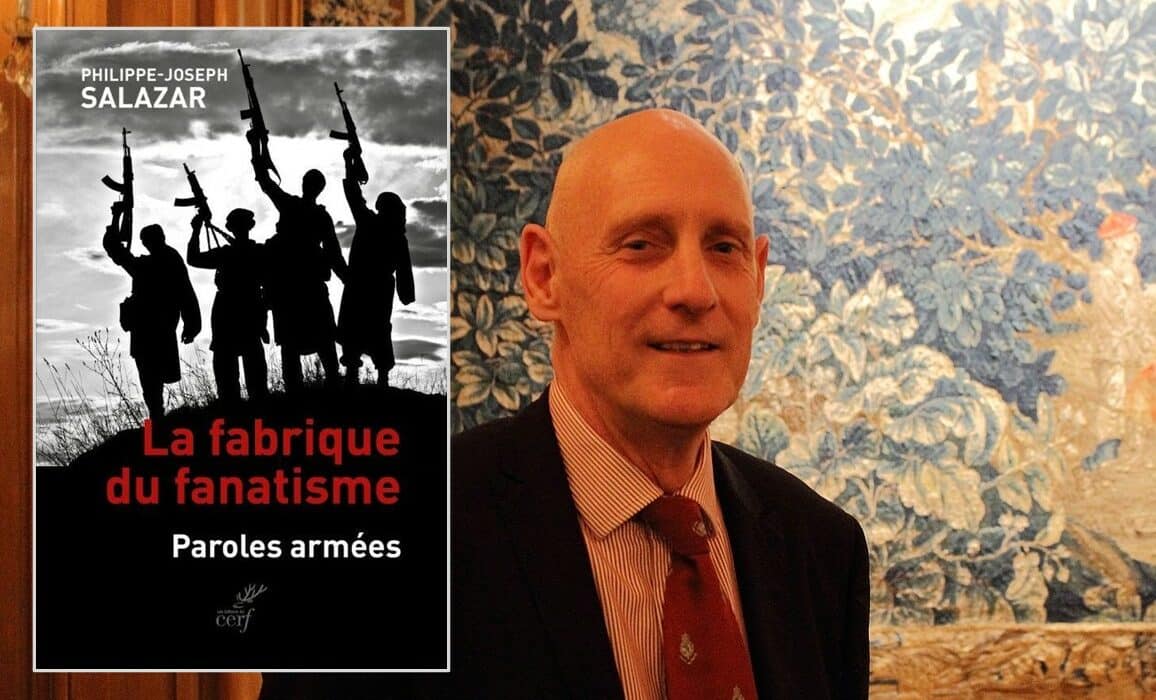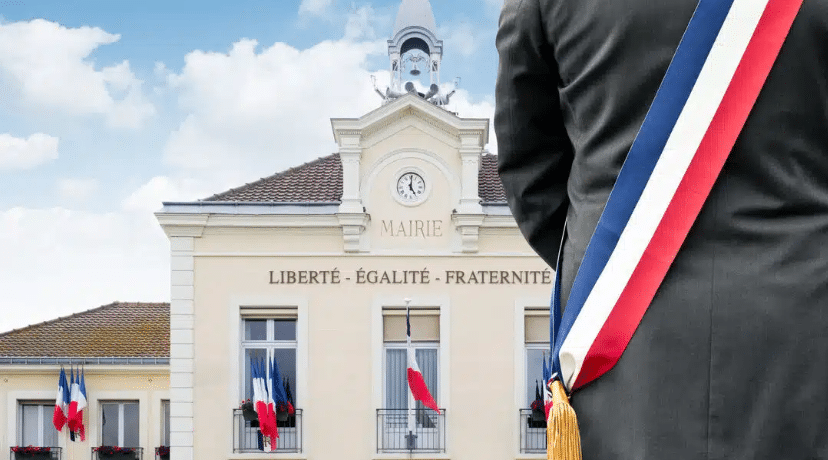Il demeurait dans le Code pénal un flou dans la définition du viol. S’agissant ou non d’un viol, le consentement n’était pas inscrit comme une condition préalable à toute forme d’acte sexuel à la différence de nombreux codes pénaux en Europe. La loi du 6 novembre 2025 répond à ce vide juridique en introduisant dans l’article 222-22 du Code pénal un alinéa 1er posant le préalable du consentement : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti ». Ces quelques mots répondent à la fonction pédagogique de la norme pénale. C’était indispensable ; pour autant qu’est-ce que consentir ? Comment prouver le consentement ? À quoi a-t-on consenti ?
Muriel Fabre-Magnan (Consentir à quoi?, Tract Gallimard, 2026) explore avec une extrême justesse ce qu’est le consentement, qui détermine sa preuve (l’auteur et/ou la victime ?) et ce à quoi on ne peut pas consentir. Les choses sont assez simples lorsqu’il y a violence, contrainte, surprise ou menace, mais qu’en est-il en cas d’emprise ? Comment la victime, qui peut être ou non dans le déni de l’emprise, va-t-elle prouver cette dernière alors que l’auteur, à qui incombe en principe la charge de la preuve du consentement, la niera ?
En anglais l’emprise se traduit par « domination ». On comprend dès lors qu’il ne puisse pas y avoir de consentement lorsque la victime a moins de 15 ans. La domination peut résulter simplement d’une différence d’âge, de la particulière vulnérabilité de la victime, d’une différence de fonction. C’est la situation bien connue du chef d’entreprise et de sa salariée ou du professeur d’université et de son doctorant ou sa doctorante. Cerner l’emprise ou la domination de l’auteur de l’agression est au cœur de la question de la preuve du consentement qui se doit d’être libre, éclairé et révocable.
Christine Lazerges, professeure de droit pénal, pour « L’œil de Réforme »