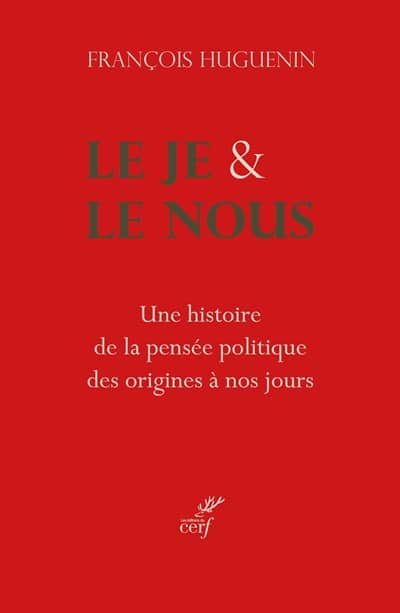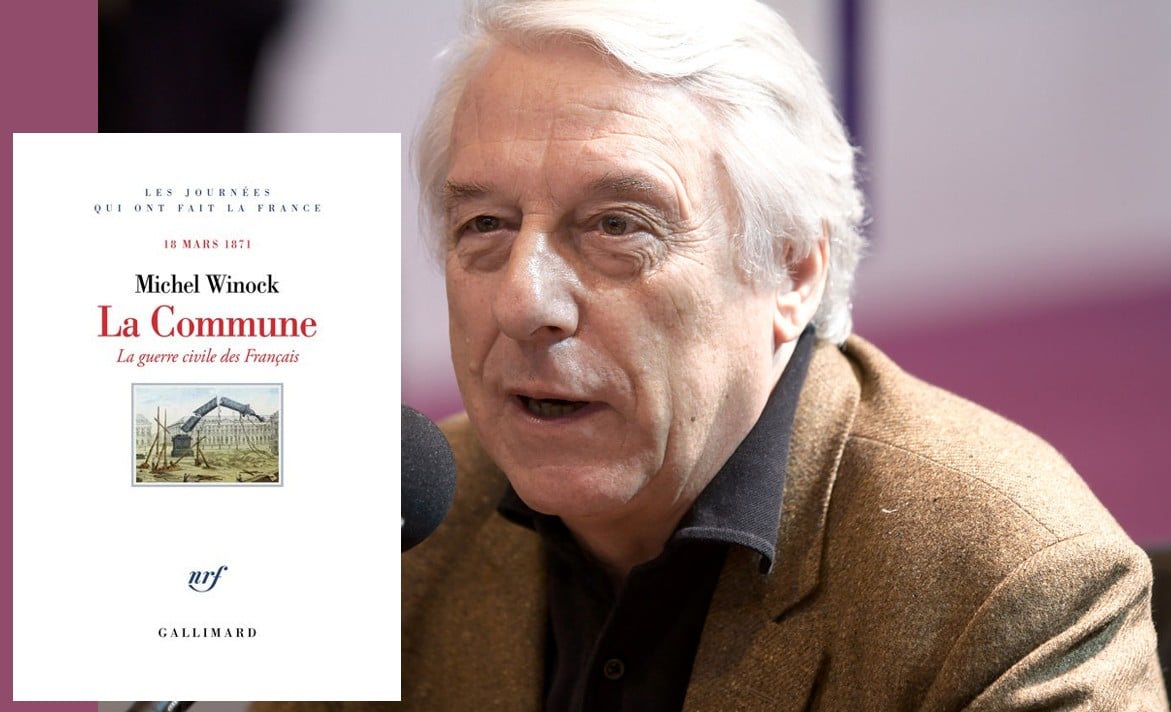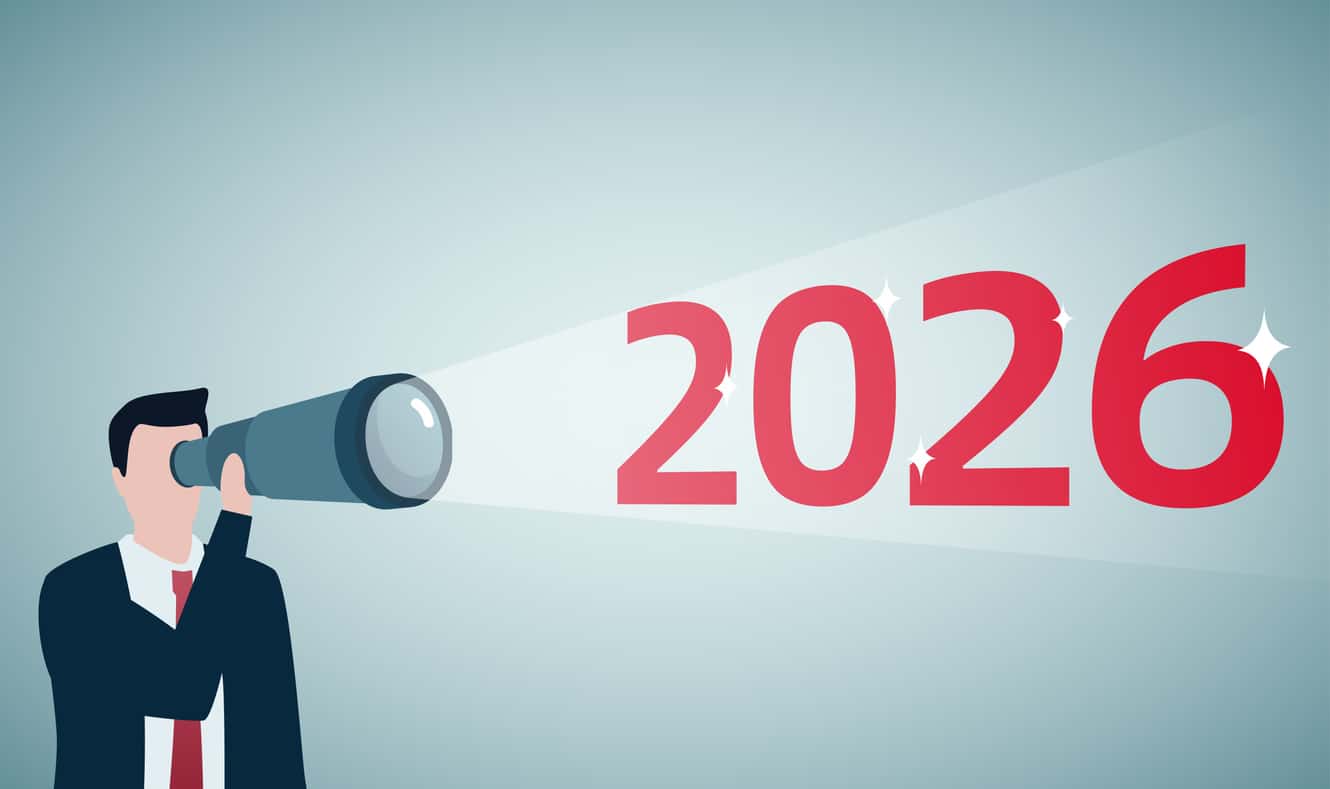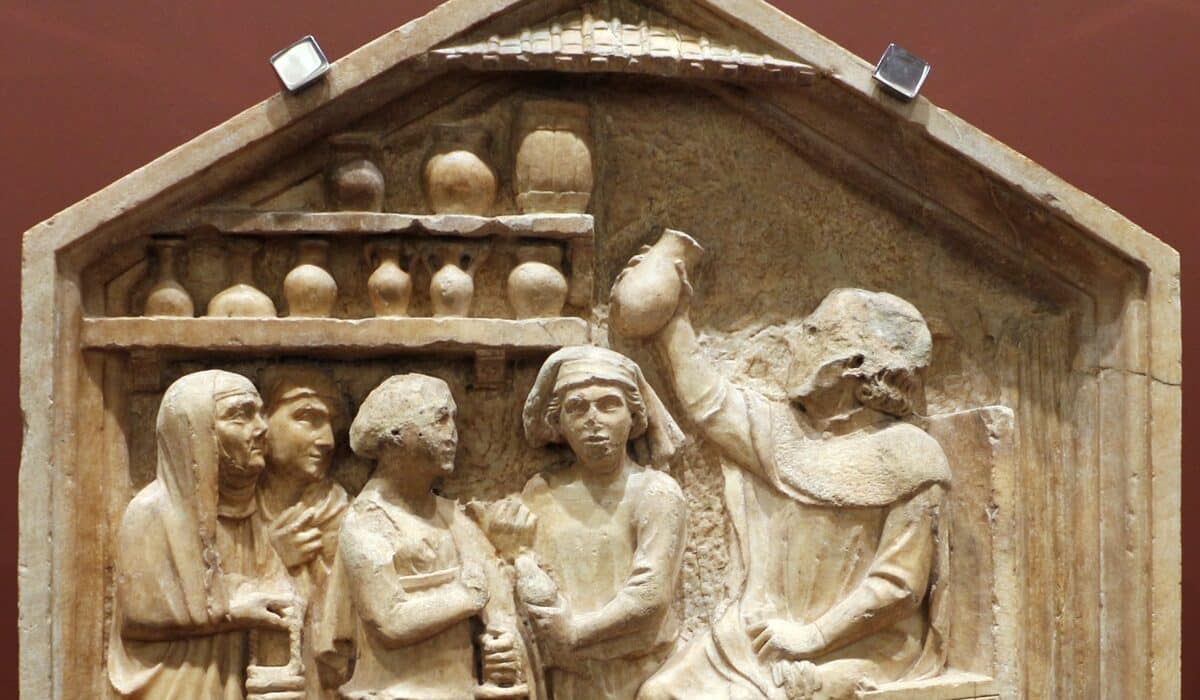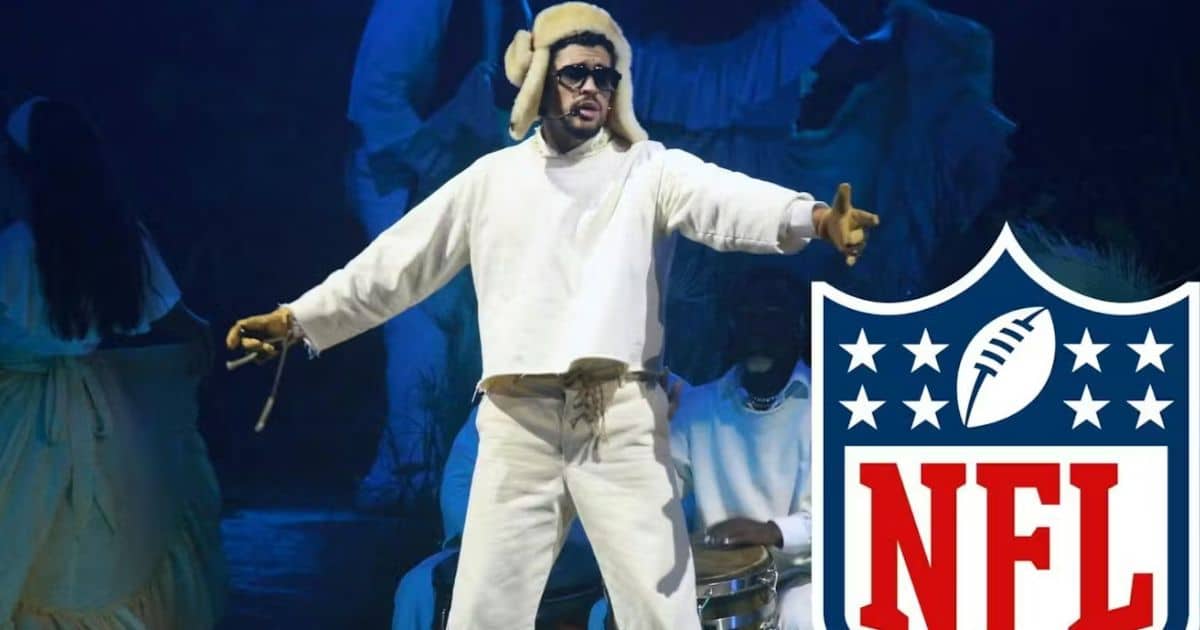L’océan d’une manifestation syndicale tétanise nombre de nos concitoyens, qui le confondent avec les prémices du vandalisme. A contrario, lorsque Bernard Arnaud prend Gabriel Zucman à partie, le traitant de militant gauchiste avec une mauvaise foi des plus comiques, il semble en phase avec les pratiques de notre temps. Nous avons perdu le sens de l’expression collective, quand la confrontation des personnalités nous semble une banalité. L’« individualisme de masse » dont parle Pascal Ory dans l’un de ses derniers livres, submerge le débat public. Au point de gangréner les consciences ? Pas sûr. Il est connu depuis Rousseau que l’être humain n’est pas fait pour vivre seul.
Alors que les inégalités n’ont jamais paru si fortes, un désir de solidarité gagne les esprits. François Huguenin, qui enseigne l’histoire des idées politiques à l’Ircom (Humanités et management) et à l’Institut Catholique de Paris, vient de publier « Le Je et le Nous » (aux éditions du Cerf). Il propose à Regards protestants son analyse du moment politique.
La société de l’individualisme
« A mon sens, nous vivons dans une société de plus en plus traversée par l’individualisme et nous ne devons pas nous en étonner, dit-il pour commencer. Tocqueville, dans le second volume de son célèbre ouvrage « De la démocratie en Amérique », paru en 1840, affirmait de façon prophétique que l’individualisme était le péril qui menacerait la démocratie moderne, rendrait inapte les citoyens à la vie politique et ouvrirait la porte, par voie de conséquence, à un éventuel despotisme. » Ce péril, on en trouve la trace dans certaines idéologies contemporaines.
Ainsi le libéralisme de Friedrich Hayek ou de John Rawls a-t-il peu de choses à voir avec le courant de pensée dont Raymond Aron ou Isaiah Berlin furent les références durant les années cinquante et soixante. « Ceux-ci avaient le souci du commun, rappelle François Huguenin. Ceux-là, tout au contraire, affirmaient, pour Hayek qu’il n’y a pas de fin commune entre les individus, qu’il n’y a que des fins individuelles, qui parfois convergent, pour Rawls que l’on doit définir les principes de justice d’une société en faisant abstraction de toute conception du bien. Cette dérive du libéralisme fait le lit de ce qu’on retrouve dans le wokisme : un individualisme absolutisé de revendications subjectives qui font que plus rien n’est partageable en commun. Comme en retour, le trumpisme se déploie dans une conception « viriliste », impulsive, très peu raisonnée, galimatias d’idées souvent contradictoires, absence de cohérence que l’on retrouve en France dans le discours du RN. » Hors de toute polémique, il nous est plaisant de rappeler que Michel Rocard avait un jour déclaré qu’il aurait fallu traduire les penseurs ultralibéraux devant un tribunal pour crimes contre l’humanité…
Une crise de confiance envers le politique
Les manifestations de la semaine dernière ont-elles à voir avec cet affrontement idéologique ? « Il est indéniable que nombre de Français se sentent abandonnés, n’ont plus confiance dans une classe politique dont ils pressentent, même s’ils ne le formulent pas comme ça, qu’elle n’agit plus pour le bien commun, souligne François Huguenin. Nos dirigeants sont marqués par cette culture que certains nomment ultralibérale. Emmanuel Macron, incarne quelque chose de cette pensée politique contemporaine, en prétendant s’être créé lui-même, en portant la puissance de l’argent au premier plan, par une hypertrophie du moi – jusqu’à l’hubris, nous l’avons plusieurs fois constaté. » Dans ces conditions, le sentiment de détresse et d’abandon conduit nombre de Français à se radicaliser.
Rétablir la notion de bien commun
Comme on le sait le Rassemblement national profite au premier chef de cette évolution. Mais La France Insoumise, dans une stratégie qui pousse au communautarisme, elle aussi cherche à tirer bénéfice de la situation. La vérité pourrait être la première victime d’un tel affrontement. L’analyse que donne François Huguenin s’appuie sur l’ouvrage emblématique de Guy Debord, « La société du Spectacle », paru en 1967. « Il nous donne une clé de compréhension de ce qui se passe aujourd’hui, notamment quand il écrit que le vrai est le moment du faux, note l’historien des idées. Dans toutes les idéologies progressistes, il y a du vrai. Prenons l’exemple de l’intersectionnalité, qui n’est au fond que la remise au goût du jour du concept marxiste de la conscience de classe. On peut considérer qu’une femme, de couleur de peau noire, et qui est ouvrière, peut se trouver victime de multiples sources d’inégalités. Les idéologies progressistes partent d’une situation vraie. Mais elles en tirent des conclusions mortifères, par une segmentation du corps politique en autant de revendications subjectives qui se dressent les unes contre les autres et finissent par démembrer le corps social, puis le corps politique. »
Attentif à ne pas verser dans la nostalgie, François Huguenin sait bien que le passé ne reviendra pas. Jamais il n’appelle à un retour à l’antique. Tout au contraire, il aime à reconnaître les bienfaits de la modernité, des libertés, des droits qui sont reconnus dans notre société. Sa démarche nous invite à renouer avec la notion de bien commun, cet héritage de la pensée antique dont le judéo-christianisme a su faire la base de notre civilisation. Préserver la modernité du naufrage de ce que l’on nomme aujourd’hui le progressisme ? Les protestants ne sauraient manquer ce rendez-vous.
A lire : François Huguenin : « Le Je et le Nous – Une pensée de la pensée politique des origines à nos jours », Le Cerf 448 p. 25 €