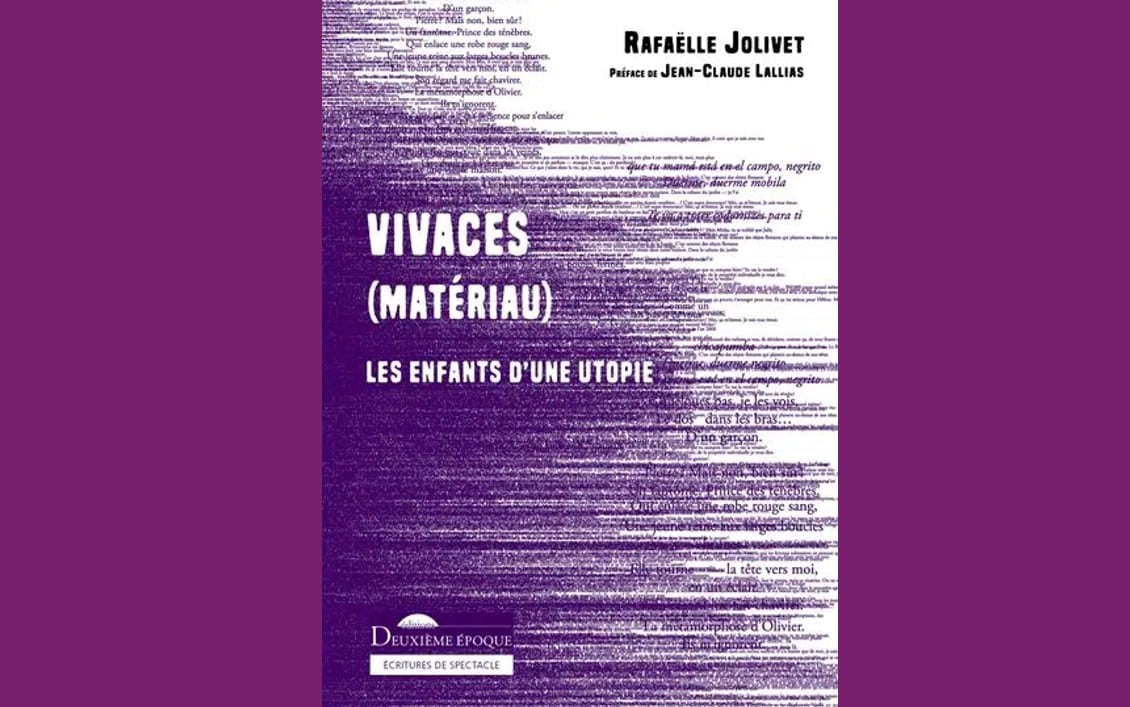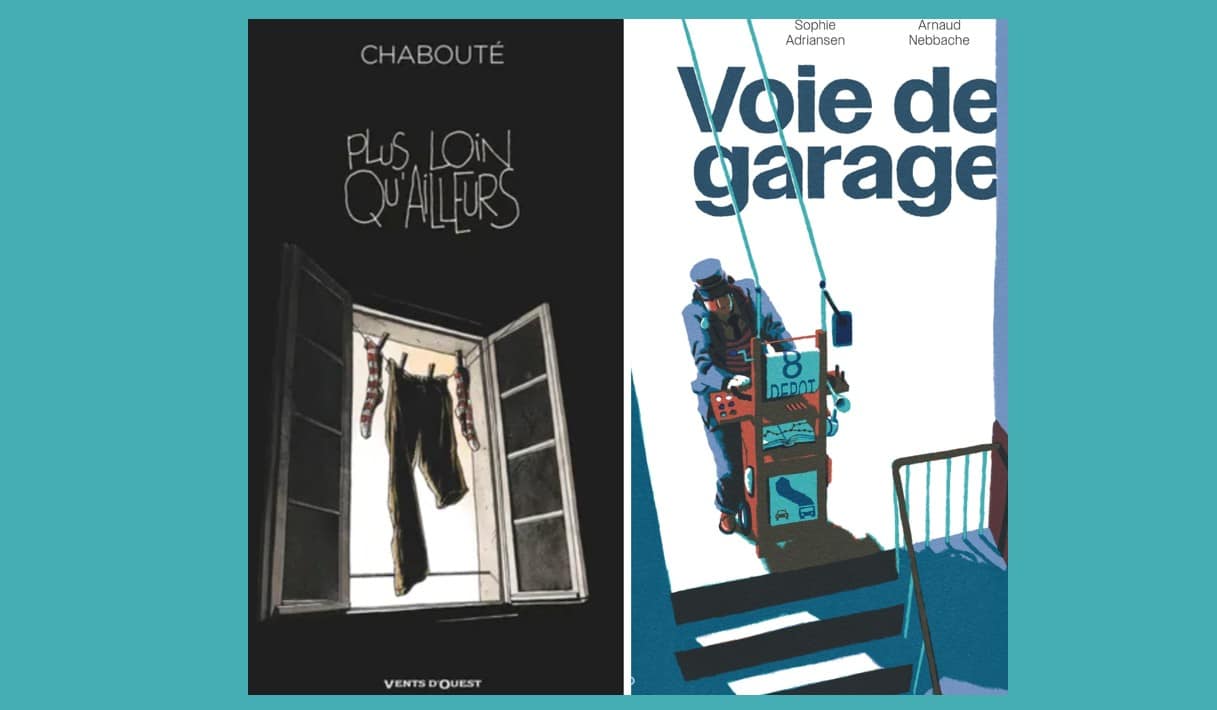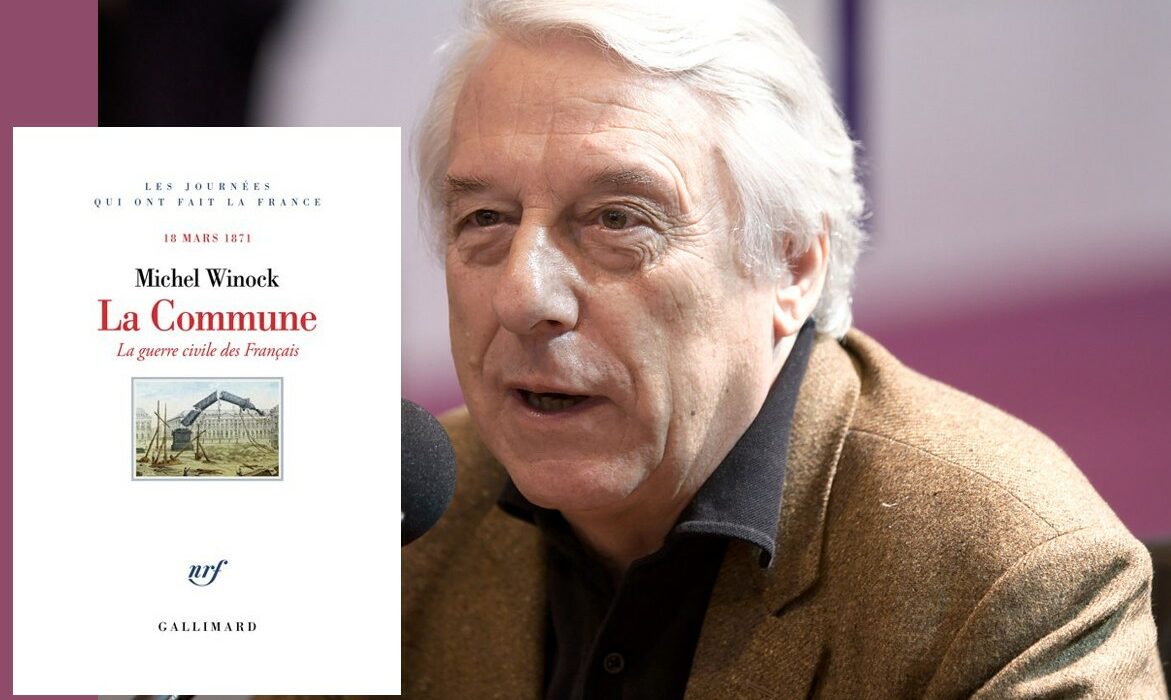Ce constat est en fait largement partagé dans la mesure, en particulier, où notre déficit commercial traduit notre incapacité à produire et donc à fournir les biens et les services que notre pouvoir d’achat nous permet d’acquérir.
Ce déficit commercial remonte en pratique à 2003 et donc à la période où ont été instaurées les 35 heures. Depuis, les critiques de cette situation où la réduction du temps de travail n’a pas permis de faire baisser le chômage mais a fait basculer nos comptes extérieurs dans le rouge se sont multipliées. Par exemple, Emmanuel Macron, alors qu’il était ministre de l’Économie, déclarait en août 2015 à l’université d’été du Medef : « La gauche a pu croire, à un moment, il y a longtemps, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C’était une fausse idée. »
Le problème est que l’on en est resté aux déclarations d’intention. Certes, la réforme des retraites doit contribuer à augmenter la quantité de travail, mais la présentation qui en est faite est surtout centrée sur les problèmes d’équilibre financier du système.
Une rencontre entre l’État et les partenaires sociaux devrait être organisée le plus rapidement possible pour préparer l’augmentation du temps de travail autour des 35 heures, du nombre de jours fériés, de l’âge de départ à la retraite, du « travailler plus pour gagner plus ». Ce sommet pourrait prendre comme référence intellectuelle la formule « produire d’abord, revendiquer ensuite ». Rappelons qu’elle est de Maurice Thorez quand, à la Libération, les communistes étaient associés au pouvoir…
Jean-Marc Daniel, professeur d’économie, pour « L’œil de Réforme »