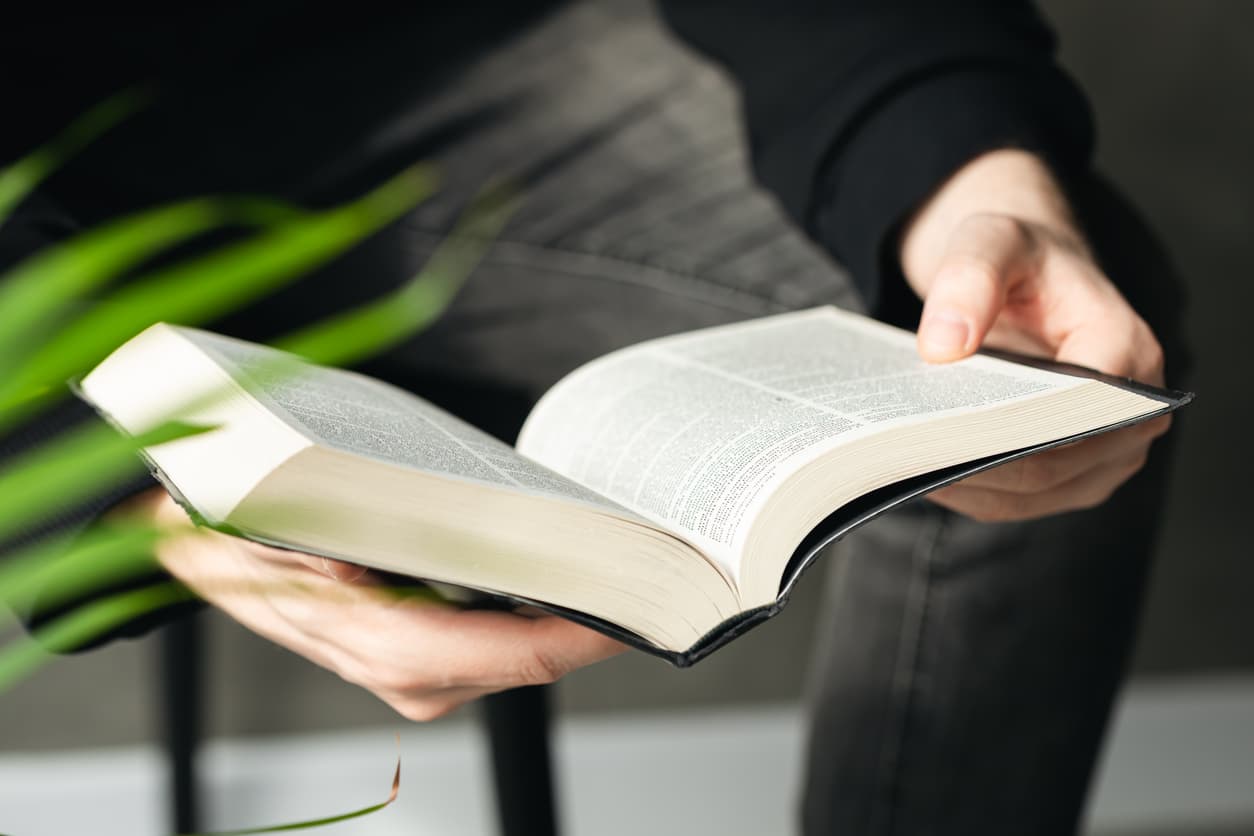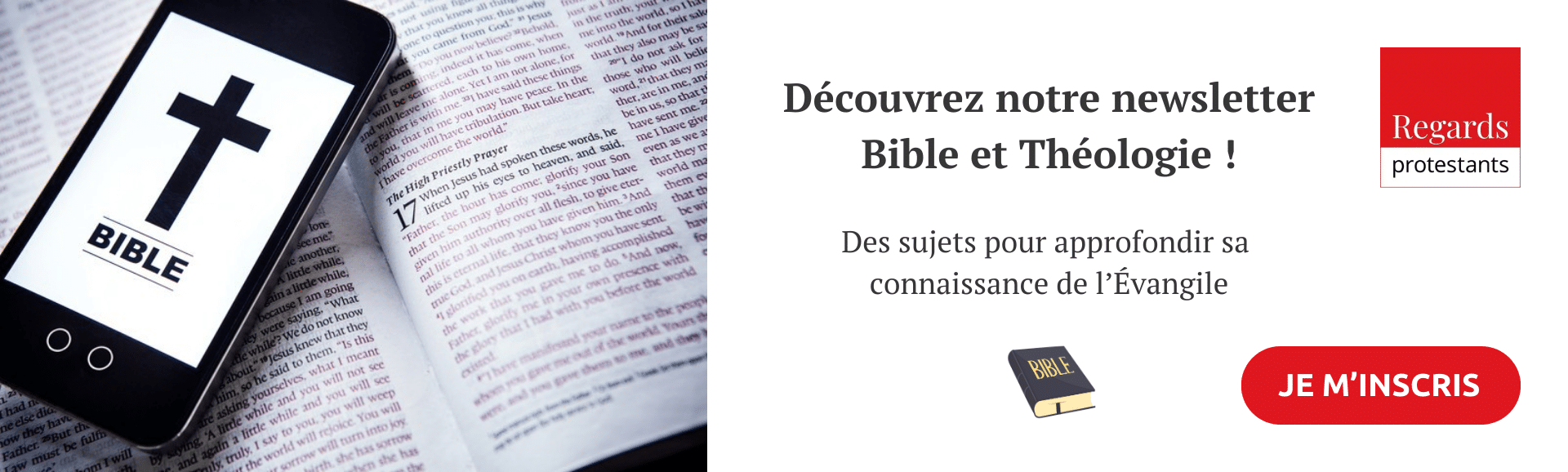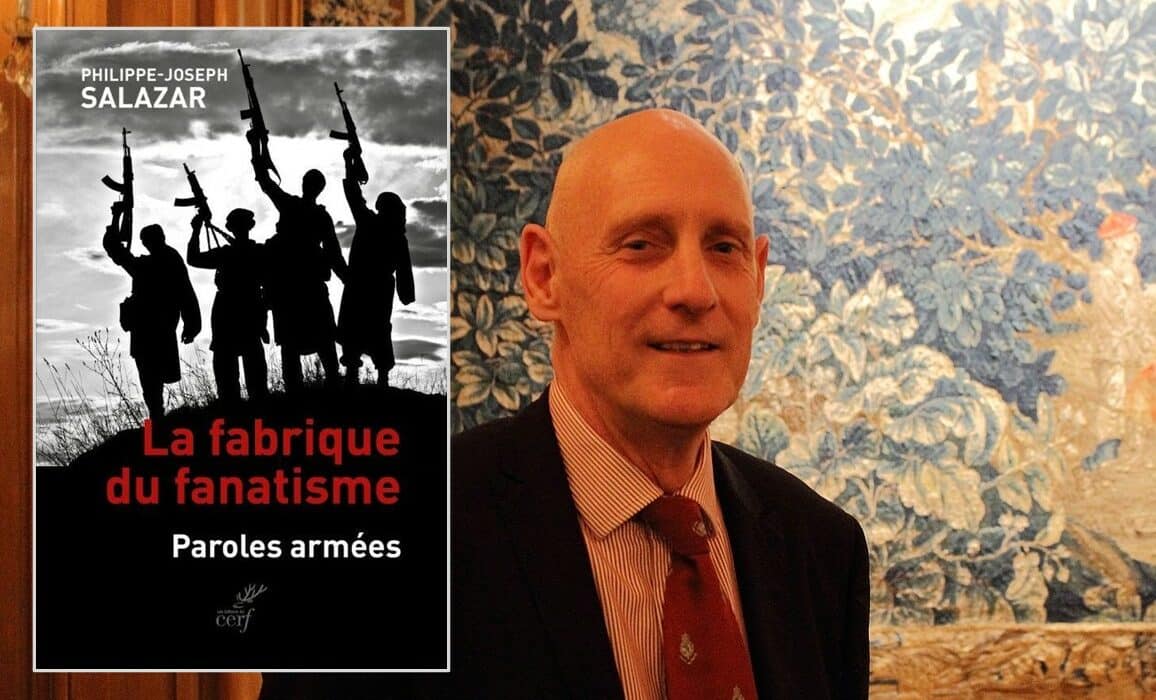La grande fête chrétienne n’est pas Noël, mais Pâques. La naissance de Jésus n’est racontée que dans deux livres bibliques – les évangiles de Matthieu et de Luc – alors que la résurrection se trouve dans les quatre évangiles. Elle est la clef des prédications du livre des Actes des Apôtres, évoquée dans toutes les épîtres pauliniennes, et centrale dans le livre de l’Apocalypse. Sans résurrection, il n’y aurait pas de foi chrétienne : cette affirmation mérite qu’on se pose la question de sa crédibilité.
Il est déraisonnable de croire à la résurrection. Quand on est mort, on est mort et il est difficile d’imaginer une vie au-delà du temps et de l’espace. Le philosophe André Comte-Sponville ajoute un argument de poids : on a tous envie d’une vie qui ne se termine pas à la tombe, mais il faut se méfier de ses sentiments et avoir le courage de la lucidité.
D’un autre côté, une écoute des récits bibliques nous montre que le vendredi de la croix, le mouvement de Jésus est un champ de ruine, un échec radical. Comment, de ce rien, est né le mouvement qui a le plus influencé l’histoire de l’humanité depuis 2000 ans ? Une ruse de l’histoire, ou faut-il accorder une crédibilité au témoignage des apôtres qui disent avoir revu vivant celui qui a été crucifié ? Il n’est pas plus absurde de penser qu’il existe une vie en Dieu au-delà de notre existence que de penser que nous ne sommes que le fruit de simples déplacements moléculaires.
Nous nous trouvons dans la tension entre l’in-croyable de la résurrection et le raisonnable de la résurrection ; notre liberté vient se nicher dans l’interstice entre ces deux affirmations.
Antoine Nouis, directeur de l’hebdomadaire Réforme