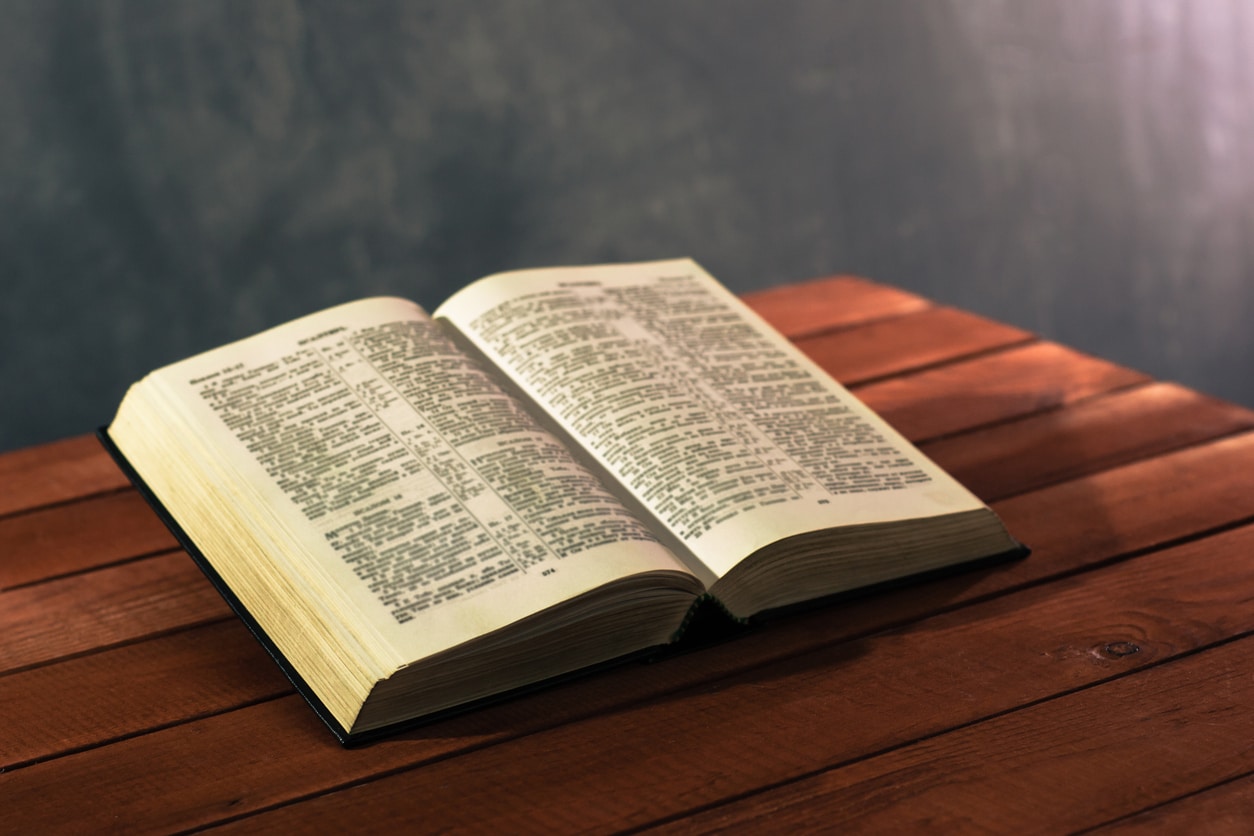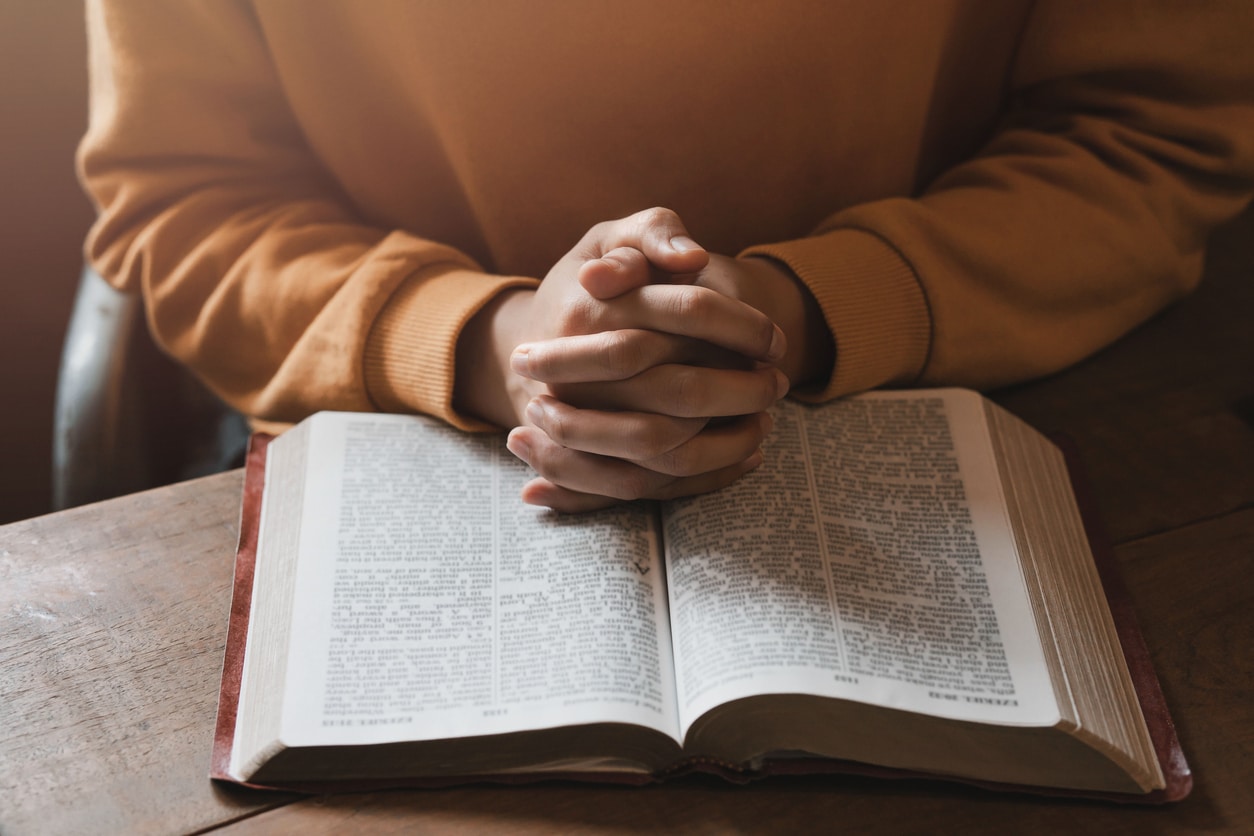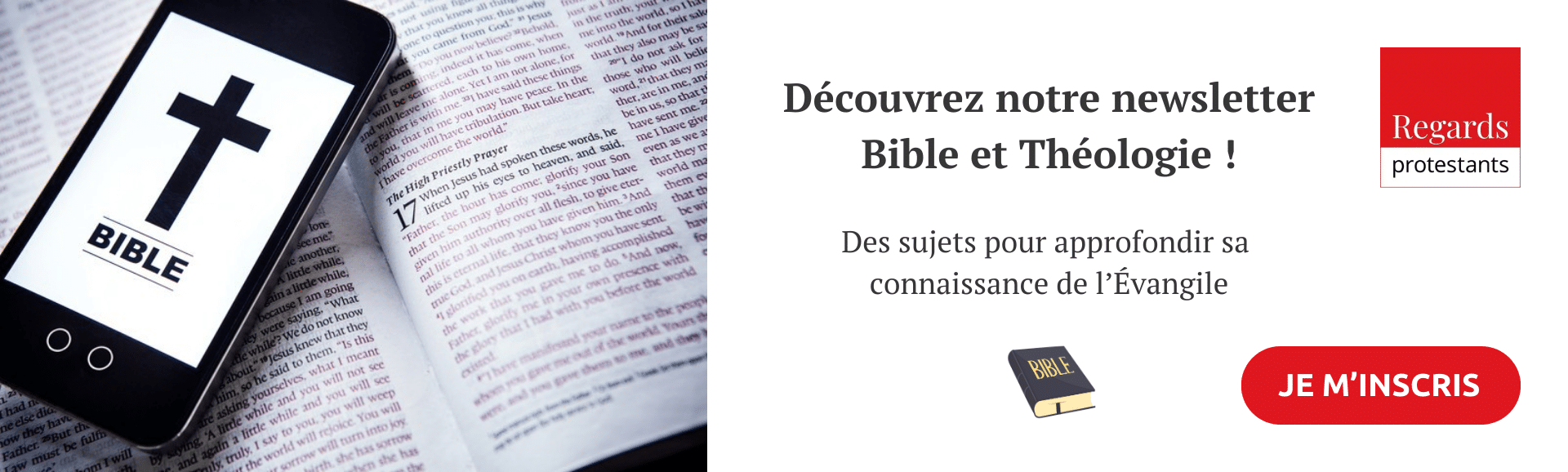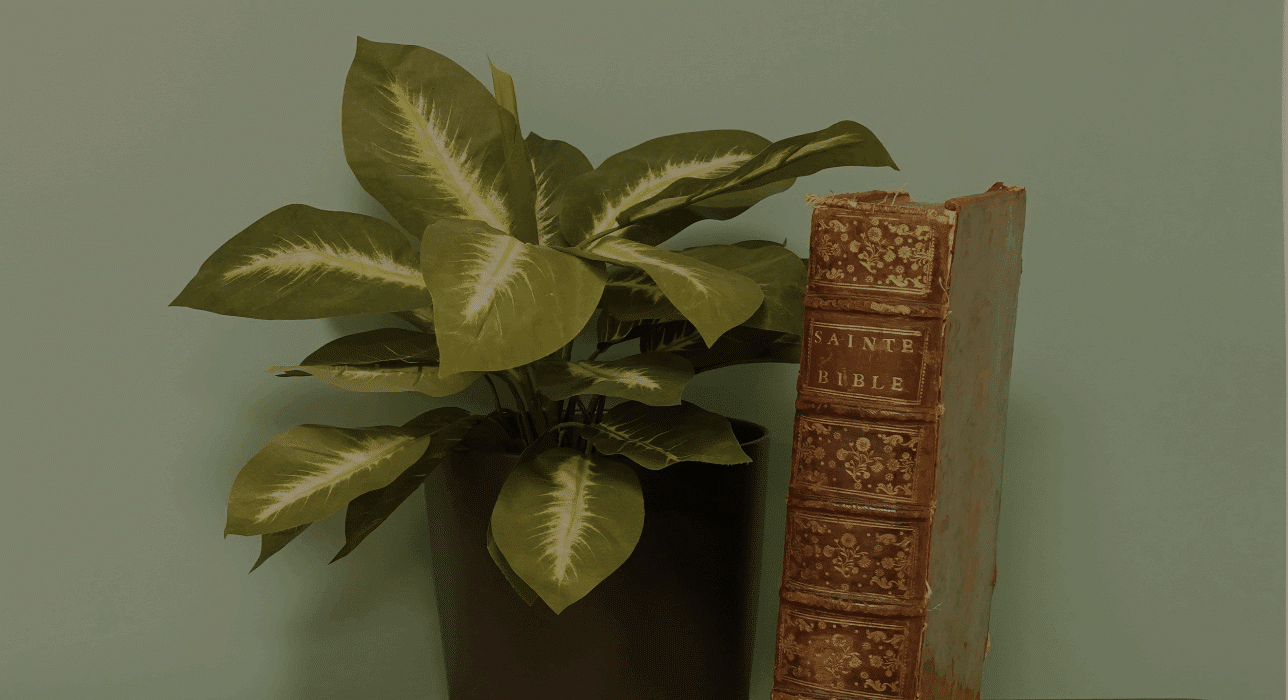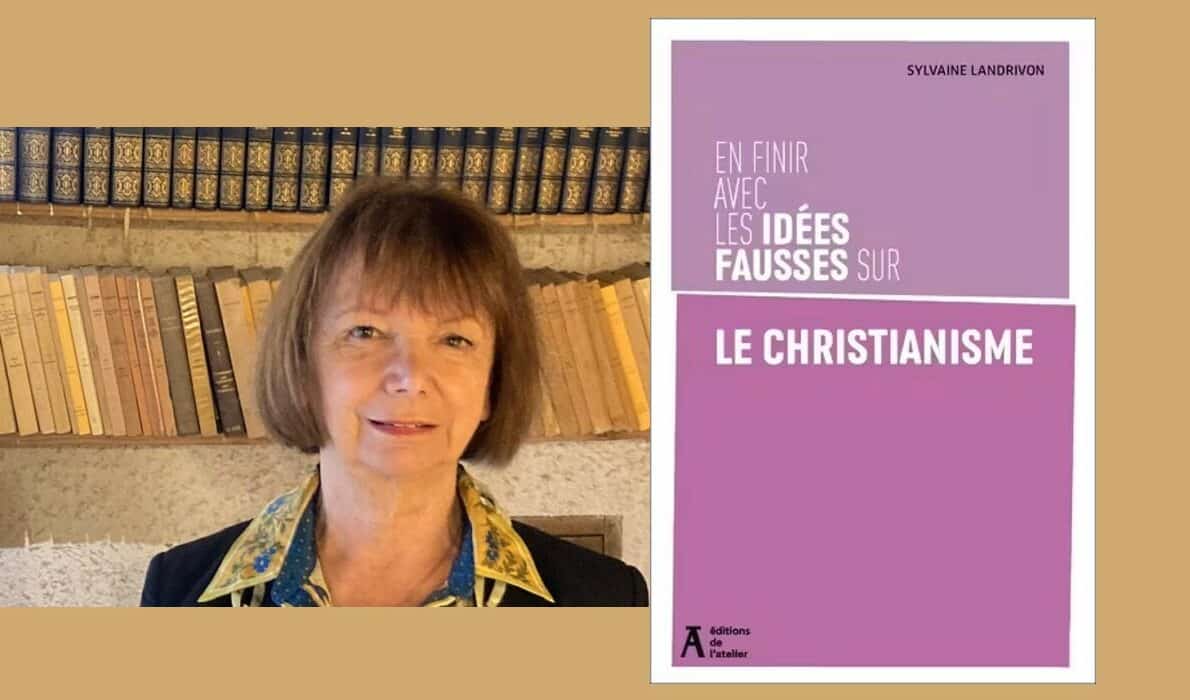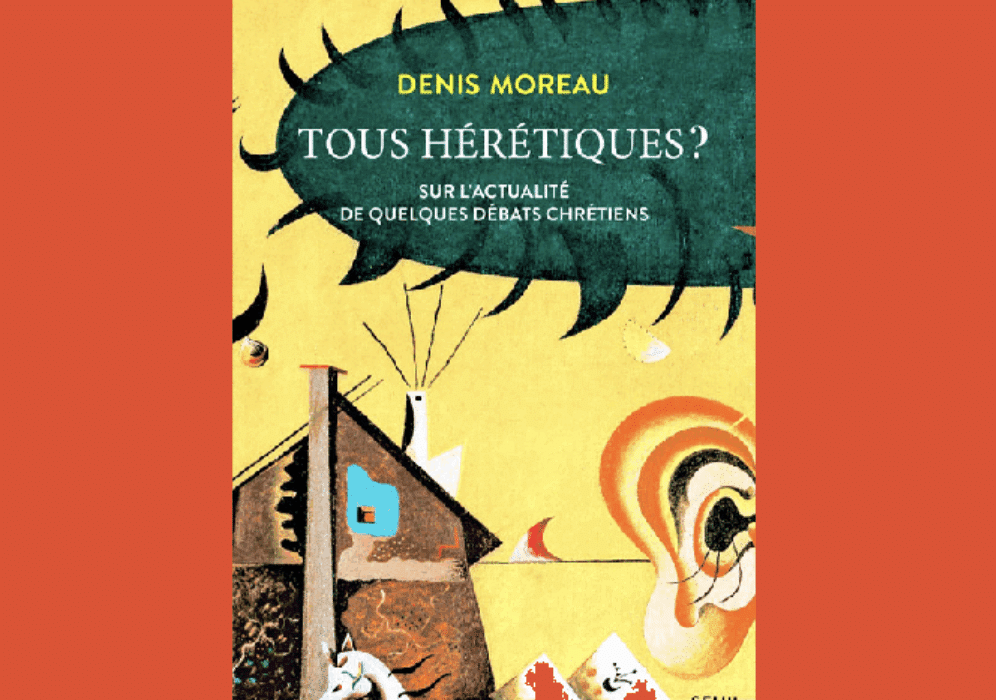Le philosophe Cioran, auteur entre autres d’un De l’inconvénient d’être né, était plutôt du genre tragique et nihiliste, du moins dans ses écrits. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce qu’il écrivait ne prêtait ni à rire, ni à sourire, ni à aimer la vie. Ses écrits pouvaient être considérés comme une incitation au suicide et une justification philosophique et morale de cet acte. Mais Cioran ne s’est pas suicidé. Et en société, il était très gai et riait sans retenue. Un jour, un journaliste voulut tenter de comprendre le pourquoi de cette double attitude et il lui demanda: « Pourquoi riez-vous ? » Ce à quoi Cioran répondit: « Parce que je ne pense pas toujours ».
Cela donne à penser. Quand Cioran pense, ce qu’il pense le conduit à considérer que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Mais quand il rit, il ne pense pas. Il ne peut pas penser. Il est dans un monde autre que celui de la pensée, un monde où il n’est pas tenté de se suicider.
Un choix crucial : le suicide ou le rire
Autre anecdote. Un jour, un des admirateurs de Cioran lui demande: « Est ce qu’il faut que je me suicide? » Et Cioran répond: « Si tu ne peux plus rire, fais-le; mais s’il t’arrive de rire, ne le fais pas ».
On peut interpréter ces propos de Cioran de deux manières différentes.
Ou bien, comme le dit l’Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour penser, auquel cas il serait logique de se suicider. Et un temps pour rire et ne pas penser, et donc sans avoir envie de suicider. Auquel cas ce temps, bien qu’il n’occupe qu’une petite partie de la vie, suffirait pour que l’on accepte de vivre la vie toute entière sans se suicider. Tout simplement parce que l’on ne peut pas se suicider à mi-temps!
Ou bien, autre lecture du propos de Cioran, le fait de rire, quand bien même il ne se manifeste que ponctuellement, est un contrepoint, voire un démenti par rapport à ce que l’on pense. En effet, le rire a vocation à être totalitaire. Si on ne peut pas rire de tout, c’est que l’on n’est pas un vrai rieur. Le fait de rire fait rire de tout, y compris de son désir de se suicider. Il rend risible la “pensée“, voire la sagesse qui induirait qu’il serait logique de se suicider. C’est cette lecture que nous allons privilégier même s’il est tout à fait possible que cela ne soit pas celle de Cioran.
Le rire (du moins la forme de rire à laquelle nous allons nous attacher, à savoir celle du rire comme raillerie, moquerie et dérision, sans le mépris qu’impliquent souvent ces termes) est négateur de tout, il relativise tout, déconstruit tout, y compris la pensée, le désespoir et l’appel du suicide. Penser rend nihiliste (« Tout est vanité »), mais le rire est négateur aussi du nihilisme. Le rire est démystification. Face à tout discours, à toute pensée, à toute morale, à toute religion, il dit: “Laissez-moi rire!“.
Le rire est une énergie anarchiste. Il est ironie, c’est-à-dire étymologiquement “mise en question“ (du grec eirôneia, action d’interroger). Il est un glaive à deux tranchants auquel rien ne résiste. Et, ce qu’il importe de souligner, c’est que, pour opérer son travail de sape, le rire ne s’appuie sur rien, sur aucune valeur, sur aucune vérité. Autrement dit, il ne respecte rien. Il n’est rien d’autre que négateur (nous faisons la différence entre négateur et négation; car la négation implique une affirmation sous-jacente qui contredit ce que l’on nie). Le rire est fou, il est fou rire; il est une folie qui s’attaque à toutes les sagesses, à tous les savoirs et à toutes les croyances, et ainsi à la croyance que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.
Nietzsche écrit dans L’Origine de la Tragédie « Il vous faudrait apprendre à rire, mes jeunes amis, si toutefois vous voulez rester pessimistes. Peut-être bien qu’alors, sachant rire, vous jetiez un jour au diable toutes les consolations métaphysiques, et d’abord la métaphysique ». Le rire déconstruit la métaphysique et, on peut le supposer, l’idée de Dieu.
Mais, quand bien même le rire ne respecte aucune “valeur“ quelle qu’elle soit, on peut donner une place à Dieu dans le fait même de rire. C’est ce que nous allons tenter de montrer.
Le rire, un don de Dieu ?
De fait, c’est là le coeur de notre propos: l’articulation du rire avec l’idée de Dieu. Nous avancerons progressivement, toujours à partir de citations que nous commenterons.
Selon Marcel Pagnol : « Dieu a donné aux hommes le rire pour les consoler d’être intelligents»[1]. Si l’on en croit ce propos, l’intelligence, tout comme le fait de penser, conduit à la mélancolie; et le rire nous console et nous soulage de cette mélancolie. Le rire est une forme de catharsis; il nous purge de l’angoisse du néant et du dérisoire. Il nous en délivre. Le rire est une force de déconstruction. Et de ce fait, il est une délivrance. Il est une démystification salvatrice. Il est une grâce. Oui, « Dieu » nous a donné le rire pour nous délivrer du malheur de l’intelligence et de la conscience. La conscience est malheureuse; il faut l’aptitude à rire pour la supporter.
De fait, les Anciens disaient que la rate suscite le rire pour purifier le sang. Le rire expulse les humeurs “peccantes“ (c’est-à-dire mauvaises) retenues dans la rate ; il libère les endorphines ; il relâche les tensions et combat le stress. Ainsi, il restaure la “bonne humeur“. Le rire est l’antidote de la mélancolie.
Mais ce qui importe pour notre propos, c’est que Marcel Pagnol présente le rire comme un don qui nous est fait par Dieu. Nous voudrions le prendre au mot. Ce propos, même s’il n’est vraisemblablement qu’une simple formule stylistique, me paraît en effet tout à fait significatif. Pouvoir rire est une chance, une aubaine, on pourrait dire une grâce qui nous vient du Ciel.
On peut dire que le rire est une “grâce“ qui nous vient “de Dieu“ parce qu’il a une forme de transcendance par rapport au déroulement de la vie et de la pensée. Il nous tombe dessus sans crier gare, comme s’il venait d’ailleurs. Ce rire, nous ne l’avons ni désiré, ni voulu et, souvent, nous cherchons à le réprimer. Il peut avoir quelque chose d’incongru et de mal à propos. Le rire peut être une catastrophe, un peu comme la foudre qui, en tombant du ciel, met à néant nos efforts pour trouver un sens à notre existence. Il brise le sérieux, voire le tragique du moment que l’on vit. Mais, pour la même raison, on peut le voir comme une forme de miracle salvateur.
Le rire est une “possession“ lorsque ce terme caractérise le fait d’être possédé et habité par une force surnaturelle. On est pris, possédé par le rire. Le rire est une puissance, une emprise qui échappe à la volonté et au pouvoir de l’homme. C’est pourquoi on peut le voir comme l’effet d’une puissance surnaturelle qui nous dépasse. Cette puissance, on peut la voir comme celle d’un démon ou celle de Dieu[2].
Après Cioran, Marcel Pagnol et Nietzsche, on peut aussi citer Samuel Beckett (Oh les beaux jours): « Peut-on mieux magnifier le Tout-puissant qu’en riant avec lui de ses petites plaisanteries, surtout lorsqu’elles sont faibles?». Bien sûr le propos est sarcastique et faussement enjoué. Mais il montre que l’on peut voir le monde comme une petite plaisanterie que Dieu aurait créée “pour rire“. Et la meilleure louange de ce dieu mi-coquin, mi-persifleur, mi-mauvais plaisant serait de s’associer à son rire en voyant le monde comme Il le voit et comme Il l’a fait, c’est-à-dire comme une sorte de mauvaise « plaisanterie »[3].
Ainsi Beckett voit Dieu comme un Rire et, pour nous, rire serait une manière de nous associer à ce rire de Dieu. Et de fait, c’est lorsque l’on voit les choses d’en haut, avec du recul et de l’humour, que l’on est conduit à pouvoir en rire. On les voit sub ridentis Dei specie[4], c’est-à-dire du point de vue d’un dieu rieur.
Lorsque nous rions de l’absurdité des choses, des faiblesses et des prétentions de la condition humaine, nous pouvons voir ce rire comme l’écho en nous du Rire des dieux[5]. Le rire est l’irruption de l’esprit des dieux en nous. Il nous faut rire de tout, y compris de ce qui, logiquement, selon notre point de vue à nous, ne devrait pas nous faire rire.
Ainsi le rire nous fait voir les choses du point de vue de Dieu. Et, de ce fait, il nous conduit à rire de toutes nos prétentions à escalader le ciel, à nous prendre pour des dieux et à sauter plus haut que notre ombre. Il nous fait rire de ce que nous pensons, croyons et inventons. Il nous fait rire aussi des images que nous nous faisons de Dieu.
En effet, l’ennemi que vise le rire, c’est l’idolâtrie sous toutes ses formes. De fait, si l’on étudie la place du rire dans l’histoire des religions[6], on constate que celui-ci naît souvent lorsque l’on découvre une supercherie, et en particulier celle que constituent les idoles qui sont prises pour des dieux, alors qu’elle ne sont que de bois. Le rire de Dieu est un rire critique, ironique et destructeur vis-à-vis des faux dieux et des idoles, et ici nous retrouvons une veine qui est constante aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Et les idoles d’aujourd’hui, ce sont les idéologies de toutes sortes et en particulier les idéologies théologiques et religieuses. Le rire, par son glaive à deux tranchants, crucifie le labeur de l’intelligence, de la morale et de la religion.
Le rire de Dieu
De fait, si nous pouvons voir notre rire comme l’irruption du rire des dieux en nous, cela nous conduit à voir Dieu comme un Rire, un rire à la fois continu et constant qui se déverserait sur le monde, l’embrassant dans sa totalité.
Au-dessus de la comédie humaine, et quand bien même il faudrait, comme Cioran, la voir comme une tragédie, il y a, comme le dit Flaubert (Smarh, 1839): « un rire long, homérique, inextinguible, un rire indestructible comme le temps, un rire cruel comme la mort, un rire large comme l’infini, long comme l’éternité »[7]. Et ce rire est le rire de Dieu ou des dieux. De fait, Flaubert lui donne des caractéristiques divines.
Nietzsche a écrit : « Au dessus de toutes choses s’étend le ciel de la Contingence, le ciel de l’Innocence, le ciel du Hasard , le ciel du Caprice»[8]. Il aurait pu aussi ajouter : “ Au-dessus de toutes choses, il y a le ciel du Rire“.
Bien sûr, cette manière de voir Dieu comme un rire inextinguible peut surprendre. On voit plutôt Dieu comme amour, colère, jugement… Mais on peut aussi Le voir comme une Puissance qui ne juge pas en termes de bien et de mal et qui est elle-même par-delà le bien et le mal[9].
Dieu peut être défini comme un Principe transcendant par rapport au monde, ou, plus précisément, une Judication[10] transcendante, cette Judication ayant pour propre de percevoir le monde dans sa vérité (sa “vérité devant Dieu“). Et cette vérité est celle d’un monde où les valeurs dont l’affuble l’homme (le bien, le mal, le juste, l’injuste) n’ont pas cours. Dieu voit le monde à découvert, à nu, sans qu’il ne soit recouvert et oblitéré par les revêtements de nos lectures et de nos jugements de valeur. De fait, ceux-ci, comme d’ailleurs nos croyances religieuses, ne sont que des créations mentales de l’entendement de l’homme. En revanche, Dieu perçoit les choses dans la vérité de leur absence de sens. Et de ce fait, ce Regard transcendant sur le monde peut être conçu comme un rire qui se moque de toutes les prétentions et affabulations des hommes.
Nietzsche dit d’ailleurs que le rire de Dieu peut être considéré comme une « attaque de la naïveté hyperbolique de l’homme qui le fait se considérer lui-même comme le sens et la mesure de toutes choses »[11]. Et il dit également « Au commencement était le non-sens et le non-sens était de par Dieu. Et Dieu, divinement, était le non-sens[12] ». Il est le Non-sens surplombant toute chose, se riant de toutes les prétentions humaines, religieuses ou autres, à donner et à trouver du sens.
Dieu n’est rien d’autre que le nom donné à ce Rire radicalement athée, ou plutôt antithéiste , iconoclaste et blasphémateur qui fait voler en éclats tous les dieux que nous nous donnons et nous inventons. De fait, il n’y a rien de plus dévastateur que le rire.
Sub specie aeternitatis, tout ce qui se passe dans le monde apparaît dérisoire et ridicule, tout est petit et comique, tout est insignifiant et risible. Tout est absurde.
De fait, comme le dit Kant[13] « Dans tout ce qui excite le rire, il faut qu’il y ait quelque absurdité où l’entendement ne peut trouver par soi-même quelque satisfaction ». Ainsi Kant, bien avant Ionesco, établit clairement une corrélation entre le rire et l’absurde.
Ce rire est comparable à celui d’une personne qui regarderait d’en-haut une partie de football sur un stade où 22 personnes s’essoufflent, s’échinent et se disputent la possession d’un malheureux petit ballon de cuir. Vue d’en haut, cette partie de foot apparaît comme absurde et dénuée de tout sens. Et de ce fait, elle ne peut susciter que le rire.
Ce rire peut aussi être vu comme celui d’un gamin observant d’en haut, par un regard en surplomb, une fourmilière avec tous ses petits insectes affairés chacun dans leur rôle. Tout cela paraît vain, et d’une certaine manière dérisoire et insignifiant. Et de ce fait apte à susciter le rire.
Le rire des dieux s’ébroue dans le Ciel éternel à la vue de nos pantomimes guerrières ou amoureuses, de nos revendications prétentieuses, de nos gesticulations en tout genre, bref de tout ce par quoi nous prétendons nous donner une raison d’être. Oui, tout ce fatras attire la moquerie des dieux et leur rire immense, moqueur et ravageur.
Et, quitte à tenir un discours discourtois vis-à-vis du catéchisme habituel, j’ajouterai qu’il est aussi légitime de supposer que les dieux se rient de nous que d’imaginer qu’ils ont pour nous de la bienveillance, voire de l’amour.
Dieu, bien loin d’être Celui qui donne un sens au monde est bien plutôt Celui qui l’institue comme absurde en démystifiant les pseudo-sens que nous lui conférons. Ainsi Dieu peut être conçu comme un rire qui se moque de nos bavardages, de nos requêtes, de nos prétentions et même de notre nihilisme.
La psychologie des hommes et le rire des dieux
Ajoutons ceci pour montrer l’assise dans le champ de notre psychologie de cette manière de concevoir les dieux ou Dieu. En fait, si nous pensons que les dieux se rient de nous, c’est que, d’une manière ou d’une autre, nous nous sentons ridicules de n’être qu’« un pauvre histrion qui se pavane et qui s’échauffe sur la scène, et puis qu’on n’entend plus »[14]. C’est le sentiment du dérisoire (ce mot a la même racine que rire ) de ce que nous sommes et faisons qui nous conduit à penser qu’au-dessus de nous et de notre monde , il y a des dieux qui rient.
Mais il est aussi possible d’“établir“ le rire des dieux à notre sujet par une autre voie. Le fait de souffrir peut susciter en nous une forme de paranoïa. Il suscite en nous le sentiment que nous sommes poursuivis par un agresseur qui se rit de nous et qui nous inflige des blessures pour rien, ou du moins pour rien que nous puissions comprendre. Ainsi, le Job de la Bible se dit poursuivi par les flèches d’un Dieu incompréhensible, d’un Dieu qui lui inflige des blessures « pour rien » (Job 2,3). Et il en vient ainsi à penser que Dieu rit de ses malheurs. De fait, Job dit clairement que « Lorsqu’un fléau jette soudain la mort, Dieu se gausse et se rit de la détresse des hommes intègres» (Job, 9,23). Et Dieu lui-même lui donne raison puisqu’Il proclame « Moi, je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me moquerai quand la terreur sera sur vous » (Proverbes 1,6).
On retrouve ainsi la fameuse phrase de Shakespeare : « Ce que les mouches sont pour les enfants espiègles, nous le sommes pour les dieux »[15]. Les dieux, pensons-nous, s’amusent en riant à nous faire du mal et à nous arracher nos ailes. De fait, lorsque nous souffrons, il nous faut inventer un coupable responsable de cette souffrance et supposer qu’il se rit de nous.
Le rire de Dieu dans la Bible
Reconnaissons-le, la Bible présente très rarement Dieu comme un rieur.
Il y a cependant une scène qui pourrait aller dans ce sens : c’est celle au cours de laquelle, sous l’instigation du serpent, Adam et Eve mangent le fruit de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal, (Genèse, chapitres 2 et 3). On s’est souvent interrogé sur la raison pour laquelle cet Arbre était tabou et son fruit interdit. De fait, peut-on penser, acquérir la connaissance du bien et du mal n’a a priori rien d’immoral, bien au contraire. Cependant, il est peut-être possible de trouver une explication à cette interdiction.
En effet, après avoir acquis cette connaissance, Adam et Eve, bien loin de devenir comme des dieux comme le leur promettait le Serpent découvrent la honte d’être nus et se cachent. En fait, ce qu’ils découvrent, c’est le mal (ils voient le fait d’être nu comme un mal) et aussi le malheur (la conscience d’être coupables d’avoir désobéi). Et ce alors que, avant qu’ils ne mangent de ce fruit, ils vivaient dans un état d’innocence, ignorant le bien comme le mal. Ainsi, le fait qu’Adam et Eve aient voulu acquérir la connaissance du bien et du mal se retourne contre eux. Au lieu de devenir comme des dieux, ils deviennent malheureux[16].
Et c’est pourquoi Adam et Eve vont susciter ce que l’on peut voir comme un grand rire de Dieu. De fait, après qu’Adam et Eve se furent cachés, la première parole de Dieu à Adam est « Où es-tu? » (Genèse 3,9). On peut tout à fait voir cette parole comme une forme de rire. Il est bien évident que Dieu sait où se trouvent Adam et Eve. Le sens de ce « Où es-tu? » n’est pas là. Ce « Où es-tu? » dit en fait plutôt « Où en es-tu?, Où en es-tu rendu? Où es-tu, gros bêta, toi qui voulais être comme les dieux, toi qui voulait sauter plus haut que ton ombre? Toi qui te caches maintenant sous un bosquet en espérant que Je ne te vois pas? Oui, voilà où te mène ta “connaissance du bien et du mal“[17]. Oui, laisse moi rire! ».
Et la morale de cette histoire, c’est : Dieu se rit de notre prétention à connaître et à juger de ce qui est bien et de ce qui est mal.
Mais venons-en à la suite des récits et des propos de l’Ancien Testament. Certes, la Bible Hébraïque ne dit pas souvent que Dieu rit. Mais il est clair que pour elle, Il est bien Celui qui se rit et se gausse de ceux qui sont animés par la volonté de puissance et se confient en leurs faux dieux.
Isaac, cette figure emblématique d’Israël, a pour nom « Dieu rit » (Gen. 21, 3-6), ce qui rappelle que Dieu a ri lors de sa naissance. Il a ri de ce qu’Abraham et Sarah, déjà très âgés, avaient ri, en se croyant fort de leur sagesse et de leur science, lorsqu’il leur a été annoncé qu’ils auraient un fils. Dieu se rit même du rire des hommes, lorsque celui-ci est une forme de suffisance, de prétention à la connaissance, au savoir et au bon sens.
La Bible évoque également le rire de Dieu dans le livre de Job (Job 9, 23 où Job s’écrie « Dieu se rit de l’épreuve des innocents ») et aussi dans les Psaumes: « Celui qui siège dans les cieux rit » (Ps 2,4), « Le Seigneur se rit du méchant » (Ps. 37,13); « Et toi, Eternel, tu te ris d’eux « (Ps. 59,9). Et rappelons aussi le terrible verset de Proverbes 1,26 « Moi, (dit l’Eternel), je rirai quand vous serez dans le malheur… ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que le rire de Dieu est un rire de dérision et de moquerie.
Il faut aussi mentionner les propos de Job sur Dieu (Job 12, 19-25), qui Le présente comme un anarchiste qui ridiculise et tourne en dérision la prétendue sagesse des vieillards, des nobles et des prêtres. C’est sans doute le texte le plus corrosif et anarchiste de la Bible.
« Dieu renverse les autorités le plus établies,
Il ôte la parole à ceux qui ont le plus d’assurance
Il enlève le discernement aux vieillards,
Il verse le mépris sur les nobles
… Il enlève l’intelligence aux chefs des peuples,
Il les fait errer dans des déserts sans chemin
et tâtonner dans les ténèbres, sans lumière,
Il les fait errer comme des gens ivres »
Autre point. Les prophètes de Yahvé qui sont ses porte paroles insultent et ridiculisent les Baals et autres divinités auxquelles les Israelites se prostituent. Ils se moquent des idoles qu’ils vénèrent (1 Rois 19,27; Osée 2,5-13; Is 2,8 etc.). Ce sont des « mensonges qui séduisent » (Amos 2, 4), des « vanités » (Jer.2,5), des « non- dieux » (Jer. 2, 11; 5,7). Les prophètes de Yahvé raillent l’impuissance des idoles (Es.2,20; Jer. 10,2). Et pour le dire autrement, ils en rient.
De fait, le Dieu de l’Ancien Testament pourfend et tourne en ridicule toutes les idoles « faites de main d’homme » dont l’homme s’éprend. Il ne se connait et ne se révèle qu’en tant que Principe de la dénégation des faux dieux. On peut entendre par là l’ensemble des soi-disant valeurs et des soi-disant vérités que l’homme se fabrique par ce qu’il croit être son intelligence et sa “connaissance du bien et du mal“.
Mais, qui plus est, Dieu est peut-être aussi Celui de ce que nous voyons comme le bien ou le mal, et aussi comme le bonheur ou le malheur.
Nous en venons ainsi au livre de Job.
Le Dieu de Job : un safari photo dantesque et croquignolet
De fait, le texte biblique que l’on peut, assurément, le plus assimiler à un éclat de rire de Dieu, c’est le discours que Dieu adresse à Job et qui est rapporté aux chapitres 38-41 du livre de Job.
Rappelons le contexte. Job était un homme “bien“, juste et pieux, et tout à coup la foudre tombe sur son bétail et ses serviteurs, et ils sont anéantis. Puis une tornade s’abat sur sa maison et tous ses enfants sont tués. De plus, un méchant virus lui tombe dessus et il devient malade. Et Job ne s’explique pas ce qui lui arrive ni pourquoi cela arrive à un homme juste et pieux comme lui. C’est cela qui le révolte.
Job accepte qu’il y ait des malheurs si on peut leur trouver un sens, mais il n’accepte pas qu’il y en ait sans raison, c’est-à-dire sans que l’on puisse trouver la moindre explication ou justification, sans qu’on puisse les considérer comme une juste punition ou comme un avertissement pédagogique . Job n’accepte pas l’absurde, c’est-à-dire ce qui est sans raison, ce qui est “pour rien“[18].
C’est pourquoi il s’en prend à Dieu et le somme de lui donner la raison de ses malheurs successifs. Dieu finit par lui répondre, mais Il ne lui apporte ni explication, ni consolation. Il lui montre le monde tel qu’il est en vérité, c’est-à-dire un monde où les notions de bien et de mal, de juste et d’injuste n’ont pas cours.
En un mot, Dieu montre à Job un monde absurde. Il lui présente d’abord le monde cosmique, c’est-à-dire un monde sans aucun sens, un monde où les avalanches, les tempêtes et les tuiles tombent sans raison et frappent au hasard. Puis Il convie Job à une sorte de “safari photo“; il lui montre que les animaux sauvages ont des mœurs qui échappent à notre logique et à notre morale et qu’ils n’ont en aucune manière la connaissance du bien et du mal. Et enfin, Dieu fait l’éloge de deux monstres, une espèce d’hippopotame (appelé Béhémoth) et une sorte de crocodile-dragon (Léviathan) qui, dans les mythologies de l’époque, représentent la puissance du Chaos, du Tohu-bohu, on pourrait dire du Hasard et de l’Absurde.
Oui, voilà la réponse pour le moins déconcertante que Dieu apporte aux justes plaintes et aux questions bien légitimes que pose Job. Dieu se rit de Job qui prétend que les choses, les êtres et les événements doivent avoir un sens.
De fait, nous l’avons dit, le bien et le mal, le juste et l’injuste sont des notions qui ont été inventées et acquises par l’homme, et ce contre la volonté de Dieu (cf. Gen 2-3). Elles déforment fallacieusement la lecture que l’homme fait des choses, des êtres et de son destin. Elles suscitent dans ce que l’on pourrait appeler “une erreur de perspective“ dans la manière dont l’homme voit le monde. En revanche, le regard de Dieu, lui, ignore le bien et le mal. Il voit le monde tel qu’il est, dans sa réalité et sa vérité nue.
Job, en se prévalant de sa “connaissance du bien et du mal“ prétendait pourvoir juger des faits du monde en termes de bien et mal. Et Dieu lui répond en lui montrant un monde où il n’y a ni bien ni mal, ni justice ni injustice. En un mot, il lui montre un monde absurde.
Il lui montre un monde où tout est “pour rien “, sans raison, on pourrait dire aussi “pour rire“, ou “pour de rire“ pour reprendre la locution enfantine. En effet, la présentation que Dieu fait des animaux sauvages et des deux monstres est tout simplement drôle, cocasse, désopilante. Dieu leur attribue des caractéristiques qui ne peuvent que susciter le rire.
Qu’on en juge:
« Qui a mis l’onagre en liberté,
et qui a dénoué les liens de l’âne sauvage ?
J’ai fait de la steppe son habitation,
de la terre salée sa demeure.
Il se rit du tumulte de la ville,
Il n’entend pas les cris d’un charretier » (Job 39, 5-7)
« L’aile des autruches se déploie joyeusement;
On dirait l’aile, le plumage de la cigogne.
Mais quand l’autruche abandonne ses œufs à la terre,
Et les laisse chauffer dans la poussière,
Elle oublie qu’un pied peut les écraser,
qu’un animal de la campagne peut les fouler.
Elle est dure envers ses petits, comme s’ils n’étaient pas à elle;
Elle n’a pas peur d’avoir de la peine pour rien.
Car Dieu l’a privée de sagesse,
Il ne lui a pas donné l’intelligence en partage » (Job 39 13-17)
« Voici l’hippopotame que j’ai formé comme toi!
Il mange de l’herbe comme le bœuf.
Le voici! Sa force est dans ses reins,
et sa vigueur dans les muscles de son ventre.
Il raidit sa queue comme un cèdre;
les nerfs de ses cuisses sont entrelacés
ses os sont comme des tubes de bronze,
son ossature comme des barres de fer.
Il est le couronnement des œuvres de Dieu » (Job 40, 15-19)
« Prendras-tu le crocodile à l’hameçon?
Lieras-tu sa langue avec une corde? « (Job 40,25)
« Je ne me tairai pas à propos de ses membres,
de la force et de la beauté de son organisme » (Job 41,4)
« Ses éternuements font briller de la lumière;
ses yeux sont comme les paupières de l’aurore.
Des torches jaillissent de sa gueule,
des étincelles de feu s’en échappent.
Une fumée sort de ses naseaux,
comme un chaudron qui bout,
d’une chaudière ardente.
Son haleine allume les charbons,
une flamme sort de sa gueule.
Dans son cou réside la puissance,
et l’effroi bondit au-devant de lui » (Job 41, 10-14)
Oui, on peut tout à fait voir ce “safari-photo“ dantesque et croquignolet comme un éclat de rire de Dieu. Dieu, qui est censé être le créateur ou du moins le seigneur de cette curieuse ménagerie, décrit ou plutôt caricature ces animaux. Il en fait des créatures cocasses, burlesques et pour tout dire plus absurdes les uns que les autres. Incontestablement, ces animaux sont dignes d’un Grand Guignol.
Le discours de Dieu à Job est une parfaite illustration du propos de Nietzsche : « Au-dessus de toutes choses, il y a le ciel de la Contingence, le ciel de l’Innocence, le ciel du Hasard, le ciel du Caprice ». Et il connote aussi avec notre « Au-dessus de toutes choses, il y a le ciel du Rire ».
Dans un éclat de rire, Dieu révèle à Job un monde sans foi ni loi, sans dieu moral, sans dieu-explication, autrement dit sans dieu créé par l‘homme dans ses catégories mentales.
Il lui présente un monde avant qu’il ne puisse être lu et interprété selon la “connaissance du bien et du mal“. De fait, il n’est nullement question de l’homme dans ce discours. Il lui montre le monde tel qu’il existait avant l’apparition de l’homme et de sa prétention à juger en termes de bien et de mal.
Dieu se présente comme Celui qui donne leur force et leur puissance aussi bien aux astres qu’aux gazelles, aux avalanches qu’aux chevaux sauvages, aux tempêtes qu’au Léviathan qui éternue des étincelles de feu. Il donne force à un monde cocasse et hilarant justement parce qu’il est absurde et dépourvu de sens.
Ainsi, sans trop forcer les choses, on peut voir ce discours et aussi le monde qu’il présente comme un éclat de rire de Dieu.
Nous en venons ainsi au terme de notre enquête sur le rire de Dieu dans la Bible. Nous ne pensons pas utile pour notre propos d’aborder la question du rire de Jésus. Nous nous contenterons à ce sujet de renvoyer aux deux notes 2 et 22 de cet article.
La création, un éclat de rire
Je ne doute pas que cette manière de présenter Dieu comme un Rire puisse déconcerter les lecteurs qui ont eu la patience de me lire jusqu’ici. Elle est certes isolée dans le corpus biblique. Mais il n’en reste pas moins que bien des textes de l’Antiquité font état du rire des dieux. Ainsi par exemple, aussi bien dans l’Iliade(I, 599) que dans l’Odyssée (V II, 327), Homère parle du rire des dieux. De fait, les mythes grecs évoquent souvent le « rire inextinguible » des dieux, et en particulier de Zeus.
Mais ce qui importe surtout pour notre propos, c’est qu’un papyrus alchimique du IIIème siècle, le Papyrus de Leude[19], va plus loin et attribue la création du monde au rire de Dieu. Je le cite : « Dieu ayant ri, naquirent les sept dieux qui gouvernent le monde…Lorsqu’il eut éclaté de rire, la lumière parut. Il éclata de rire une seconde fois, tout était eaux. Au troisième éclat de rire apparut Hermès… Au quatrième, la génération. Au cinquième, le destin. Au sixième, le temps. Puis avant le septième rire, Dieu prend une grande respiration, mais il a tellement ri qu’il en pleure et des larmes naît l’air »[20].
Et Georges Minois[21], avec beaucoup d’humour, commente ainsi ce texte : « Dieu, l’Unique, quel que soit son nom, est pris —on ne sait pourquoi— d’une crise de rire comme s’il avait soudain conscience de l’absurdité de son existence… Chacune de ses sept quintes fait surgir du néant une nouvelle absurdité, aussi absurde que Dieu lui-même: de la lumière, de l’eau, de la matière, de l’esprit. Et à l’issue de ce big bang comique et cosmique, Dieu et l’univers se retrouvent dans un face à face éternel, se demandant l’un à l’autre ce qu’ils font là: le rieur et son éclat de rire ». Voilà en quelques lignes limpides ce que je voudrais dire dans cet article.
On peut bien sûr s’étonner que ce mythe puisse comparer l’acte créateur de l’univers à un éclat de rire. Mais, à y réfléchir, cela peut se justifier. De fait, à lui seul, le mot “éclat“ évoque une explosion, une sorte de big bang. L’éclat, c’est une énergie sans support matériel qui se déverse en mille “éclats“. Eclat a d’abord le statut d’un verbe, d’un acte, puis en passant au pluriel, l ’éclat se fait éclats. Ainsi les nébuleuses, les étoiles, les êtres et les choses de ce monde peuvent être vus comme des éclats de l’Eclat primordial.
Mais, dira t-on, voir la création du monde comme un éclat, soit! Mais pourquoi “un éclat de rire“, ce terme impliquant, semble-t-il, une dérision quelque peu malveillante? Je voudrais hasarder une réponse. Même à l’intérieur du Christianisme, il y a toujours eu un débat sur la nature et les caractéristiques de Dieu en tant que créateur de l’univers. Le fait qu’il y ait en ce monde du mal et de la souffrance ont incité certains courants hérétiques du Christianisme primitif à déprécier, voire condamner le Dieu créateur et à voir le Sauveur, c’est-à-dire le Christ comme le seul Dieu. Ils ont vu le monde comme une « mauvaise plaisanterie » (pour reprendre le mot de Samuel Beckett) créé non pas par le Dieu de Genèse 1, mais par un démiurge quelque peu malfaisant[22]. Et dès lors, on peut imaginer que ce démiurge ait créé le monde dans un éclat de rire maléfique.
Mais je voudrais aussi proposer une autre lecture du mythe du Papyrus de Leude, plus conforme au propos de cet article.
Dire que Dieu a créé le monde par un éclat de rire, c’est une manière de dire que rien ne doit être pris au sérieux ou au tragique et que tout, en ce bas monde, est, peu ou prou, “pour de rire“. Ce serait là une manière de dire, comme l’Ecclésiaste, “ tout est vanité“, mais sur un registre moins désabusé et plus vivifiant.
Dire que Dieu a créé le monde par son rire, c’est dire que le rire, l’humour, le “tout est vanité“ sont la loi de toute chose, de tout évènement, heureux comme malheureux. Le rire (et on peut le diviniser par une majuscule) est l’âme, la source, la constante, le “dénominateur commun“ et le logos de la vie comme de la mort, de la sagesse comme de la folie, de ce que nous voyons comme le bien, la vertu et le bonheur comme de ce que nous voyons comme le mal, le vice et le malheur. Tout peut être vu comme un “ris“ (pour reprendre un vieux mot français), autrement dit comme une forme et une manifestation d’un Rire premier et créateur. Tout, sub ridentis Dei specie , c’est-à-dire du point de vue d’un Dieu rieur, peut être vu comme risible.
Pour le dire autrement, il nous faut vivre “sous le rire de Dieu“, autrement dit avec humilité, en faisant taire notre prétention à être comme des dieux, en nous méfiant de nos jugements en termes de bien ou mal et, en un mot, en ne prenant rien au tragique.
Dieu ne supprime pas l’absurde, Il le transfigure en gratuité
Dans le monde, tout est “pour rien“ ou, si l’on préfère, tout est “pour de rire“. Dieu invite les hommes à joyeusement accepter l’insignifiance des choses et du cours de leur vie. Il nous invite à vivre pour rien, à aimer la vie pour rien et à aimer aimer pour rien.
Dieu ne supprime pas l’absurde, Il le transfigure en gratuité.
Le cours de la vie est aussi dépourvu de sens que les bonds de l’antilope, aussi capricieux que le vol des libellules, aussi cruel que la lionne des steppes. Mais il est également un feu d’artifice de gratuité, d’appétits et de plaisirs « pour rien ».
Le monde est un jeu gratuit, inconséquent et amoral, entre le vivre et le mourir, le fleurir et le flétrir, la chance et la malchance, le destin et l’imprévu. Et ce monde est entre les mains d’un Dieu que nous ne voyons pas et qui pourtant l’anime de toutes parts.
La vie est faite pour être vécue comme elle nous est donnée, c’est-à-dire pour rien. Le cours de la vie est un jeu sans punition ni récompense, sans justice ni injustice, sans raison d’être ni explication. Le savoir et l’accepter ne supprime les épreuves, mais nous donne une forme de détachement et aussi de générosité et de candeur. Le goût de vivre est sans pourquoi, et le goût de rire également. Il est signe de résurrection.
Et pour conclure, deux Hymnes à la Joie
Un dernier mot, un peu comme un contrepoint au propos développé dans cet article. Certes, le rire surgit face à l’absurde et au dérisoire. Mais il ne faut pas oublier qu’il connote aussi avec la joie. C’est pourquoi on peut penser que, si Dieu a créé le monde par un éclat de rire, c’est aussi parce qu’II l’a créé pour la joie, et même par la Joie.
Dieu peut être vu comme un Rire créateur, c’est-à-dire, en l’occurence comme une Joie créatrice[23].
C’est d’ailleurs ce qu’exprime ce magnifique poème de F. Schiller, « La Joie est le moteur puissant de l’éternelle nature. Elle tourne les rouages dans la grande horloge du monde. Elle fait sortir les fleurs et leurs gènes, briller le soleil au firmament, rouler dans l’espace des sphères qu’aucun astronaute ne connaît »[24].
Et, à sa manière, ce texte du livre d’Esaïe (Esaïe 65, 17-19) présente aussi la Création comme un hymne pour la joie de Dieu est des hommes.
L’Eternel dit: « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre;
On ne se rappellera plus les événements du début; ils ne remonteront plus à la pensée.
Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l’allégresse,
A cause de ce que je crée;
Car je crée Jérusalem pour l’allégresse et son peuple pour la joie.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie ».
Et j’ajoute: “Ainsi soit-il“ [25]!
Bibliographie entre autres
Alain Houziaux, Job ou le problème du mal, Un éloge de l’absurde, Cerf 2020.
Alain Houziaux, Le mythe d’Adam et Eve. Les tabous, la jouissance et la honte, Editions du Cerf, 2013
Alain Houziaux, Ces péchés capitaux… si capiteux, Lethielleux-Groupe, DDB 2011
Alain Houziaux, Ces questions qui inquiètent la foi, DDB, 2008
Alain Houziaux (dir.) Y a t-il un salut pour les salauds? Et 14 autres questions banales mais difficiles, Les Empêcheurs de penser en rond – Editions du Seuil, 2007
[1] Dialogue du film Le Schpountz, 1937, repris dans Marcel Pagnol, Notes sur le rire, Editions du Fallois 1990.
[2] De fait, si l’on en croit les moraliste et les théologiens, il y a deux sortes de rire: celui qui est suscité par le “Diable“ et celui qui est suscité par l’Esprit de Dieu. Le premier (le sarcasme, voire la méchanceté) serait l’une des formes du péché originel. Il serait le propre de l’homme, comme le dit Aristote, c’est-à-dire de l’homme qui, à la différence des animaux, est foncièrement pécheur. En revanche le second (le sourire, la joie, la bienveillance) serait l’une des formes de la grâce. Et ces deux formes de rire seraient incompatibles. Comme le dit un adage des Pères de l’Eglise, « Celui qui rit avec Satan ne peut se réjouir avec le Christ ».
Et c’est pourquoi la question de savoir si Jésus a ri a été si âprement débattue au Moyen Age (cf. Umberto Eco, Le Nom de la rose, Folio-Grasset, 2023, p.147, 194-198). Les textes du Nouveau Testament ne mentionnent jamais que Jésus ait ri. Et ceci a suscité bien des spéculations. Certains théologiens ont affirmé que, puisque Jésus était indemne du péché originel, il ne pouvait avoir ri. En revanche, d’autres, les Franciscains en particulier, affirmaient que, puisque Jésus était pleinement homme, cela impliquait que, comme tous les hommes, il pouvait avoir ri. Ainsi, on le voit, la question “Jésus a-t-il ri?“ recoupe celle de la nature de Jésus Christ: Jusqu’où était-il pleinement homme?
[3] De fait, dans les débuts du Christianisme, les gnostiques et les manichéens considéraient que c’était une Puissance mauvaise qui avait créé le monde sensible et que c’était pour cela qu’il était habité par le mal. Nous y reviendrons cf. note 23
[4] Nous usons bien sûr de cette expression pseudo-savante cum grano salis
[5] Je dis ici “les dieux“ et plus loin je dirai simplement “Dieu ». Ce changement d’appellation n’a guère d’importance pour notre propos. Dieu devient un sujet personnel à partir du moment où on le considère comme tel.
[6]Salomon Reinach, Cultures, mythes et religions, p. 146-147 Bouquins éditeur 1996
[7] Cité par Georges Minois, Histoire du rire et de la dérision, Fayard 2000 p. 488-489. Ce livre nous a donné plusieurs de nos citations.
[8] Nietzsche, en frontispice à Avant l’Aurore, 1881, in Oeuvres complètes, volume 7
[9] Dans la plupart des religions, y compris dans le Judaïsme ancien, Dieu n’est ni bon, ni mauvais. Il est la puissance créatrice de tout ce qui est, du bien comme du mal; cf. Esaïe, 45,7: Dieu dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, Je réalise la paix et Je crée le malheur. Moi, l’Eternel, Je fais toutes ces choses ».
[10] Dieu est ce que l’on pourrait appeler une Judication transcendante. Cette Judication est une lumière projetée sur le monde et dans laquelle la vérité du monde apparaît. Elle est un regard sur le monde qui procède d’un Oeil à l’infini.
[11] Nietzsche, La volonté de puissance, Tel, Gallimard
[12] Nietzsche, Humain, trop humain, 2ème partie n°22, Pluriel, Hachette Littératures.
[13] Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, par. 54
[14] W. Shakespeare, Macbeth Acte V, scène 5.
[15] W. Shakespeare, Le roi Lear, Acte IV, scène 1.
[16] Cela mérite une petite explication. Dans un premier temps, la“connaissance du bien et du mal“est le privilège de Dieu, c’est pour cela que l’arbre de la connaissance est tabou et interdit. Dieu connaît l’ensemble de ce qui existe, c’est-à-dire le bien-et-le-mal, ces deux termes rendant compte d’une totalité indissociable, celle de l’univers où le bien et le mal sont confondus et indissociables. Mais, en s’emparant du fruit de l’arbre de la connaissance, Adam et Eve détruisent ce fruit en le mangeant ; de ce fait, ils acquièrent une connaissance qui, à la différence de celle de Dieu, fait la différence entre le bien et le mal. Ils perçoivent fallacieusement le réel comme“bon“ ou “mauvais“. Et c’est ce qui fait leur malheur.
[17] On comprend ainsi pourquoi l’acquisition de cette connaissance a été vue comme un péché, autrement dit, pour rester fidèle à l’étymologie du mot hébreu hatta’t, comme une manière de “rater la cible“ de la vérité des choses. C’est pourquoi on peut la voir comme un péché épistémologique.
[18]cf. Alain Houziaux, Job et le problème du mal, Cerf 2020.
[19] Selon Wikipedia, le Papyrus de Leyde (ou Leude) est un texte alchimique écrit au IIIème siècle, probablement en Haute Egypte, à l’époque romaine. Il a été édité en 2002 par R. Halleux aux Belles Lettres.
[20] Salomon Reinach, Cultures, mythes et religions, Bouquins éditeur 1996, p.147 et précédemment Ernest Leroux éditeur 191 Et, ajoute S. Reinach, l’auteur qui fait état de ce mythe, « Cette conception n’est pas isolée dans l’Antiquité. Proclus cite les vers d’un poète qu’il qualifie de théologien, c’est-à-dire de pythagoricien ou d’orphique, attribuant la naissance des dieux au rire de la divinité souveraine et la naissance des hommes à ses larmes ».
[21] Georges Minois, Histoire du rire et de la dérision , Fayard 2001, p.15
[22] Ce qui est intéressant pour notre propos, c’est que, dans certains textes gnostiques, cette critique vis-à-vis du Créateur (le Dieu de la Bible Hébraïque et spécialement de Genèse 1) se fait sous la forme d’un rire moqueur. De fait, le Sauveur, le seul vrai Dieu, tourne en dérision le Dieu créateur de la Bible et ceux qui croient en Lui.
Dans une correspondance qu’il m’a adressée, Jean-Daniel Dubois, l’un des plus grands spécialistes du gnosticisme, écrit: « Pour les textes gnostiques qui parlent du rire du Sauveur, il s’agit de deux textes gnostiques basilidiens, le Deuxième Traité du Grand Seth (Nag Hammadi codex VII, 2) et l’Apocalypse de Pierre (Nag Hammadi codex VII, 3). Le thème de la dérision du Sauveur est développé longuement dans le Grand Seth : p. 53, 32: « Mais Moi, j’ai ri joyeusement ayant sondé sa vanité ». Il s’agit d’une critique du Sauveur face au Dieu créateur de la Genèse qui a dit « C’est moi, Dieu et il n’y en a pas d’autre en dehors de Moi » (p. 53, 30-31; et 64, 17-27) et face à ses anges qui ont vu Adam en se moquant de sa petitesse (p. 54, 1-4). Le Sauveur se réjouit dans les hauteurs et se moque de l’ignorance de ceux qui croient au Dieu de la Genèse (p. 56, 14-19) ».
Autrement dit, le Sauveur se rit de celui que nous avons présenté comme un Dieu rieur. A rieur, rieur à demi.
Dans le même sens, le gnosticisme ne peut accepter l’idée que le Sauveur (le Christ) ait pu être souillé par le monde mauvais et ait pu subir la souffrance et la mort de la crucifixion. Il considère que, en fait, ce n’est pas Jésus, mais Simon de Cyrène, celui qui a aidé Jésus à porter sa croix, qui a été crucifié.
Jean-Daniel Dubois écrit, dans la même correspondance: « Dans l’Apocalypse de Pierre, le Sauveur explique à Pierre que celui qui se tient au-dessus de la croix, réjoui et rieur, c’est le Sauveur véritable qui se moque de ceux qui croient en un Sauveur crucifié (et donc non ressuscité). Cette polémique développe une pointe anti-paulinienne explicite (cf. 1 Cor 2, 2) ».
Ainsi, même si dans les textes de la Bible canonique, il n’est jamais dit que Jésus ait ri, le Christ Sauveur-Dieu, lui, selon les textes gnostiques, a bien ri, que ce soit d’un sourire moqueur ou d’une moquerie explicite.
[23] On peut aussi voir Dieu comme un Amour créateur. cf. Dante « L’Amour qui met en mouvement le Soleil et les autres étoiles » (Dante, La Divine comédie, Le Paradis, strophe XXXIII.
[24] Cette Ode à la joie, datant de 1785, est reprise dans le dernier mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven, et de ce fait dans l’Hymne européen.
[25] Cette supplique étant faite en référence avec les derniers événements de la Bande de Gaza qui, on peut le supposer, pourraient faire perdre Sa joie et Son allégresse au Dieu d’Israël.