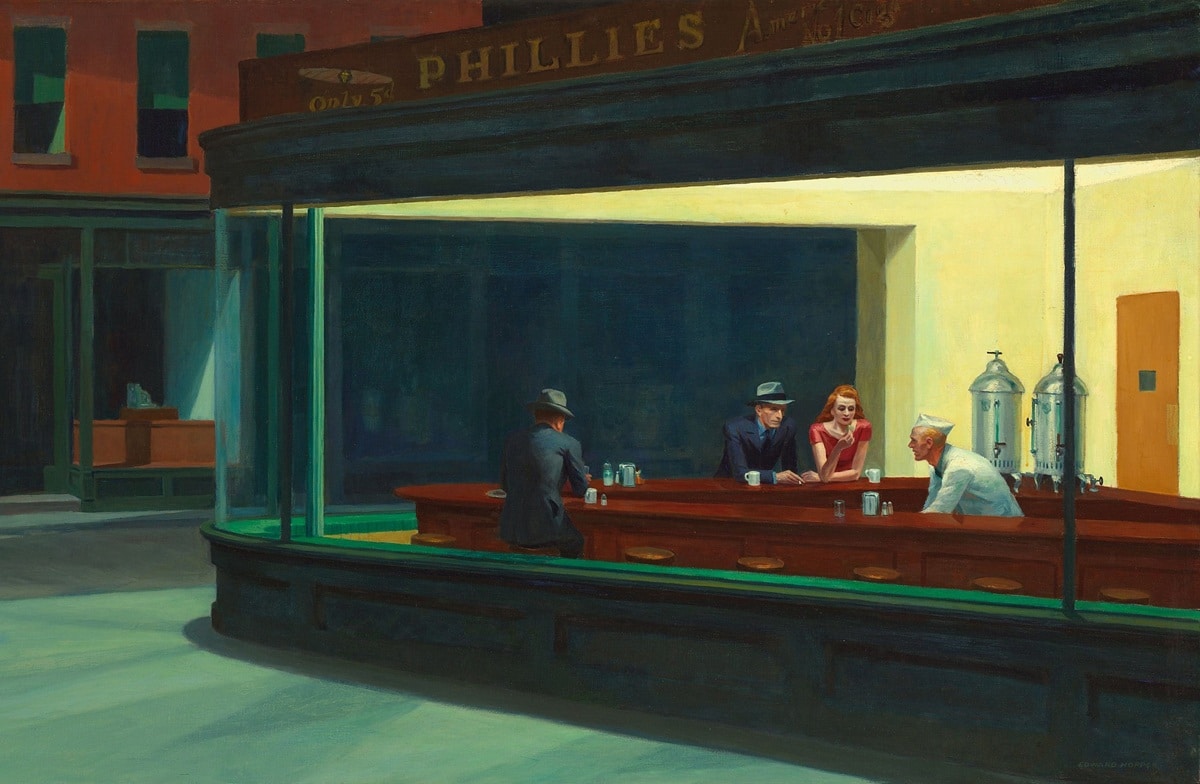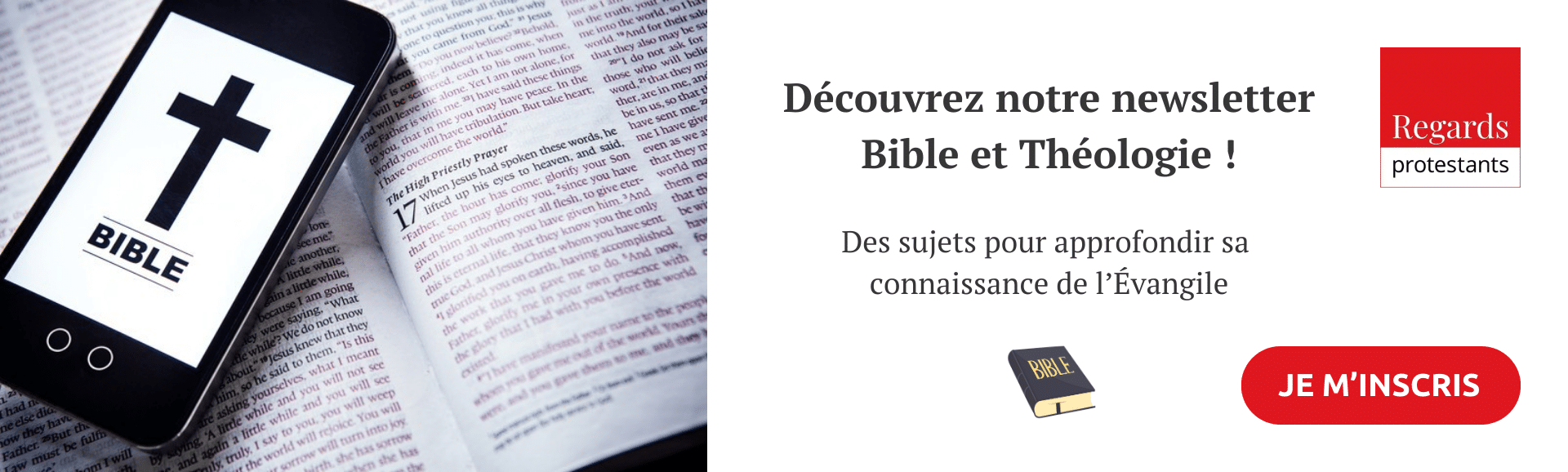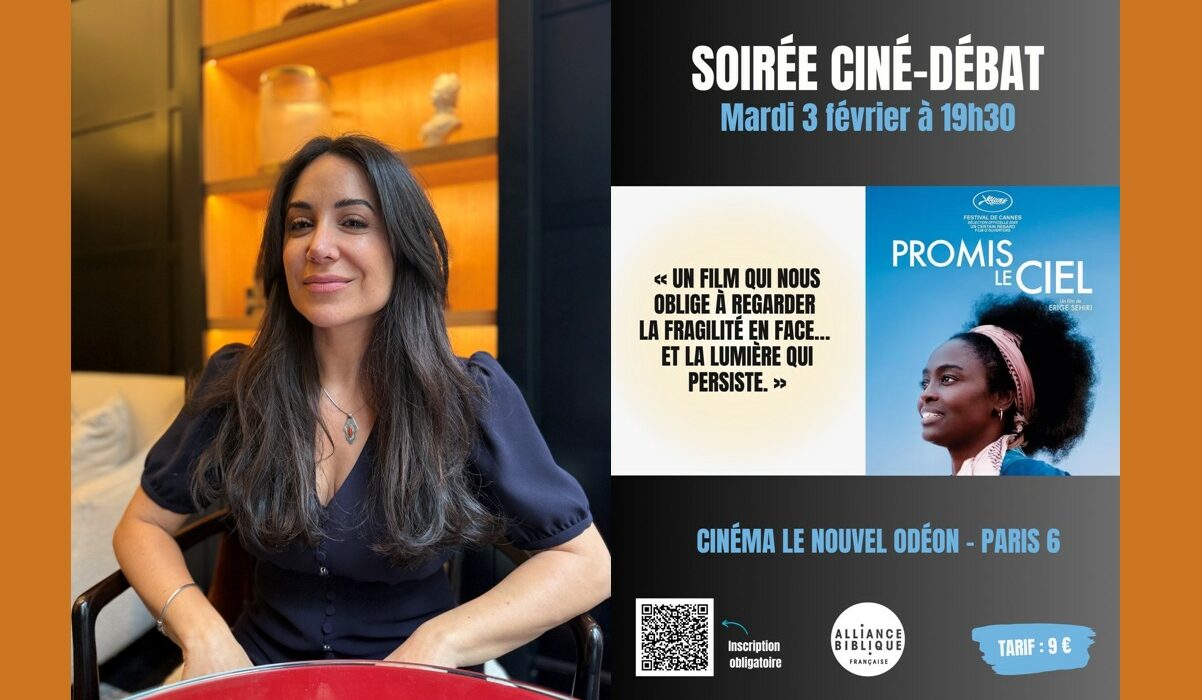Comme chaque année, je suis parti marcher, une douzaine de jours, en lisant de manière tranquille et cursive un livre de la Bible : en l’occurrence la fin du livre d’Esaïe, que j’avais laissé inachevé lors d’une marche précédente. Or, il arrive que cette lecture méditative rejoigne, de manière inattendue, les thèmes que charrie l’actualité. Au détour du chapitre 57, je suis, ainsi, tombé sur cette description assez surprenante : « les méchants sont comme une mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la boue et la vase » (Es 57.20).
C’est cet impossible qui m’a soudain frappé. Lorsque l’on a cédé à la logique de la violence, de l’oppression et du mépris de l’autre, il arrive un moment où il est tout simplement impossible de faire marche arrière. Une telle attitude peut, au départ, relever d’un calcul tactique, où l’on espère obtenir tel résultat, tel avantage. Mais, au bout d’un moment, un engrenage irréversible se met en place, un choix en entraîne un autre et, même si les victoires s’accumulent, les portes se ferment les unes après les autres. Il devient, progressivement, impossible de faire marche arrière. Seules la chute et la défaite peuvent interrompre la course folle de celui qui a perdu les manettes de sa propre violence.
Pour l’instant les stratégies autoritaires et brutales tiennent la corde
On a tendance à oublier, aujourd’hui, la fin brutale des autocrates, car l’actualité ne nous en a pas donné d’exemple tout récent. Dans la conjoncture actuelle ceux qui abusent du rapport de force sont gagnants. Cela dit, on peut remarquer, d’ores et déjà, que rien ne parvient à les calmer et qu’ils sont, bel et bien, prisonniers des stratégies autoritaires qu’ils ont inaugurées. Ils n’ont pas vraiment de plan B, sinon de continuer à s’enfoncer dans la guerre avec les mensonges, les erreurs de perspectives, les aveuglements, qu’un tel choix provoque. Ils agitent, assurément, la boue et la vase et semblent hermétiques au moindre échange raisonné. « Il n’y a pas de paix pour le méchant », continue le texte d’Esaïe. C’est une menace, sans doute. C’est un constat, assurément : celui qui a tourné le dos à la paix n’a aucun moyen de la retrouver. L’oppression engendre sa propre poursuite.
Un éclairage sur ce que peut être l’attitude des chrétiens au milieu d’une brutalité omniprésente
Face au déchaînement actuel de la brutalité tous azimuts, il y a, bien sûr, plusieurs niveaux d’intervention possible. Les états se tiennent sur la corde raide, entre la pression et la diplomatie. Mais, à vrai dire, même en interne, les états ont du mal à gérer les simples conflits sociaux. De nombreux observateurs étrangers soulignent, par exemple, que la France a augmenté, ces dernières années, son penchant répressif face à des manifestations diverses. Pour l’heure, les Églises françaises multiplient les prises de position pour appeler à une attitude plus apaisée et pour dénoncer les exactions et les guerres prétendues justes. À vrai dire, il est clair que, pour certains, ces prises de position ne sont même plus du tout audibles.
À côté, il reste une autre voie, certainement pas plus efficace que celles que nous venons d’évoquer, mais autre : celle de développer, justement, une pratique de paix, de respect et d’écoute qui permet de continuer à voir clair, de ne pas se laisser entraîner par les sirènes de la violence, de ne pas perdre pied comme une mer agitée incapable de se calmer.
Celui qui recherche la paix est volontiers considéré comme naïf. En fait, il reste souvent plus lucide que celui qui a sombré dans l’ivresse de l’affrontement brut.
En fait, la rhétorique du livre d’Esaïe, dans ses différentes sections, est assez constante. Elle nous décrit, d’un côté, un monde fracturé, traversé par l’injustice. C’est ainsi que le chapitre 67 commence : « le juste périt, et nul n’y prête attention » (Es 67.1). Au milieu de cette situation confuse, et par contraste, Dieu provoque la chute des tyrans, annonce le salut à ceux qui lui font confiance. Mais l’histoire continue, avec son fracas et ses tensions. Et, d’époque en époque, Dieu doit à nouveau intervenir.
Ce n’est sans doute pas un discours résolument optimiste, mais c’est une boussole, une grille de lecture que je trouve éclairante. En tout cas, ces contrastes m’ont accompagné pendant ma récente marche et j’y ai puisé une force et une sérénité paradoxale, alors que tant de mers continuent à s’agiter de manière inexorable.