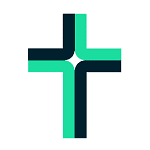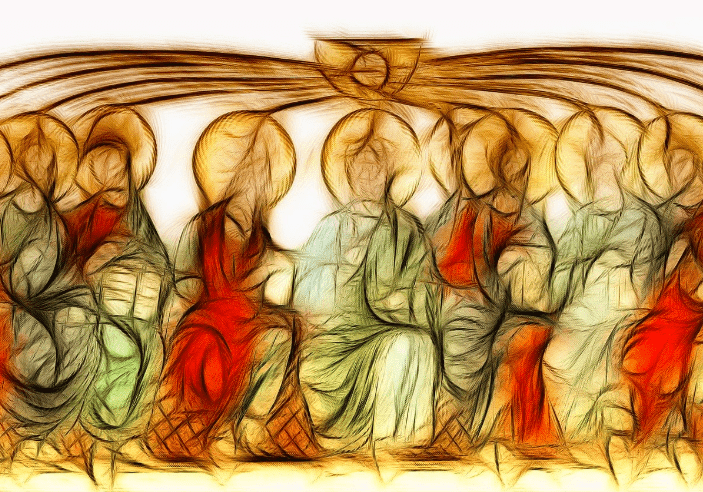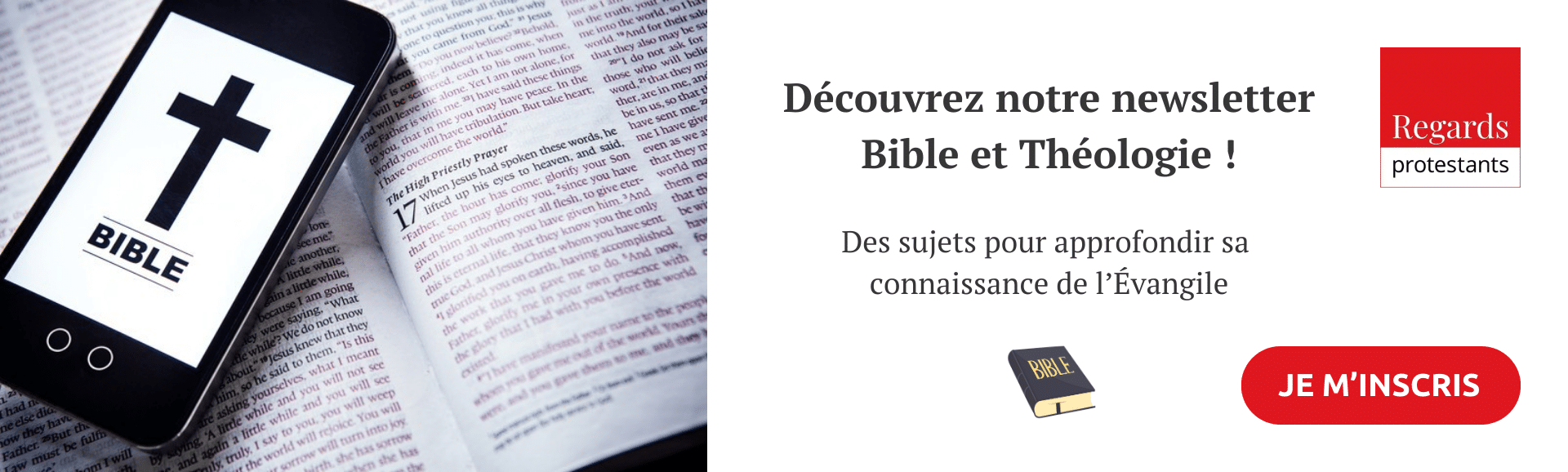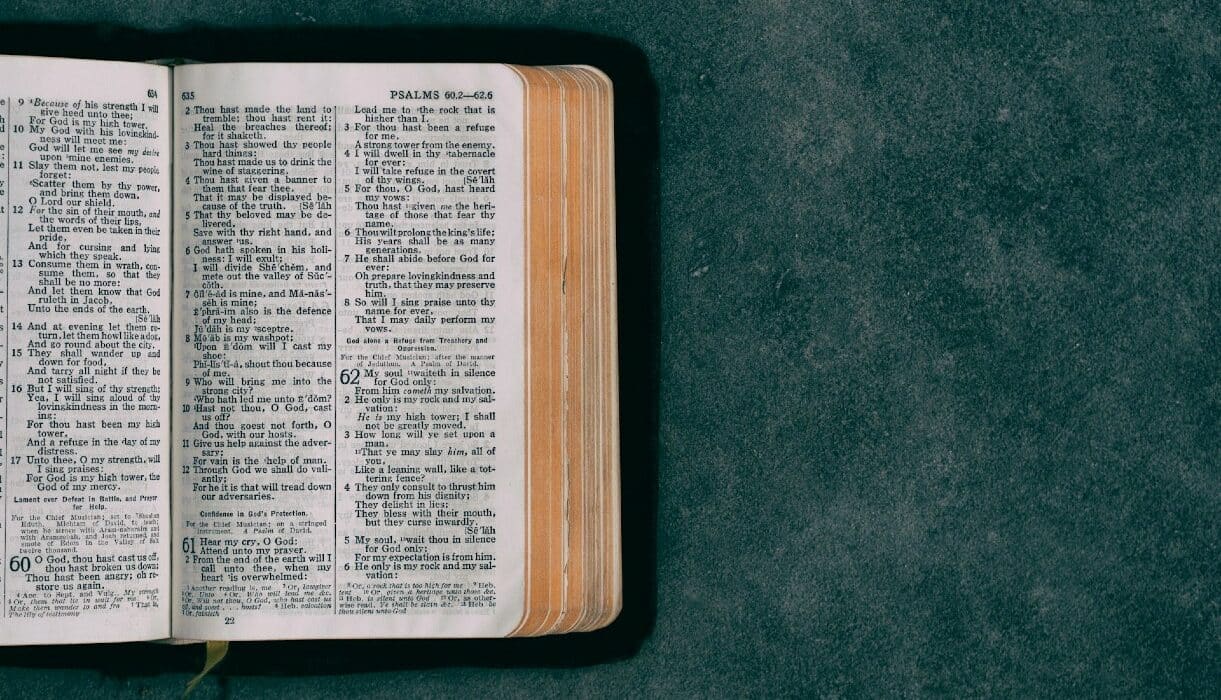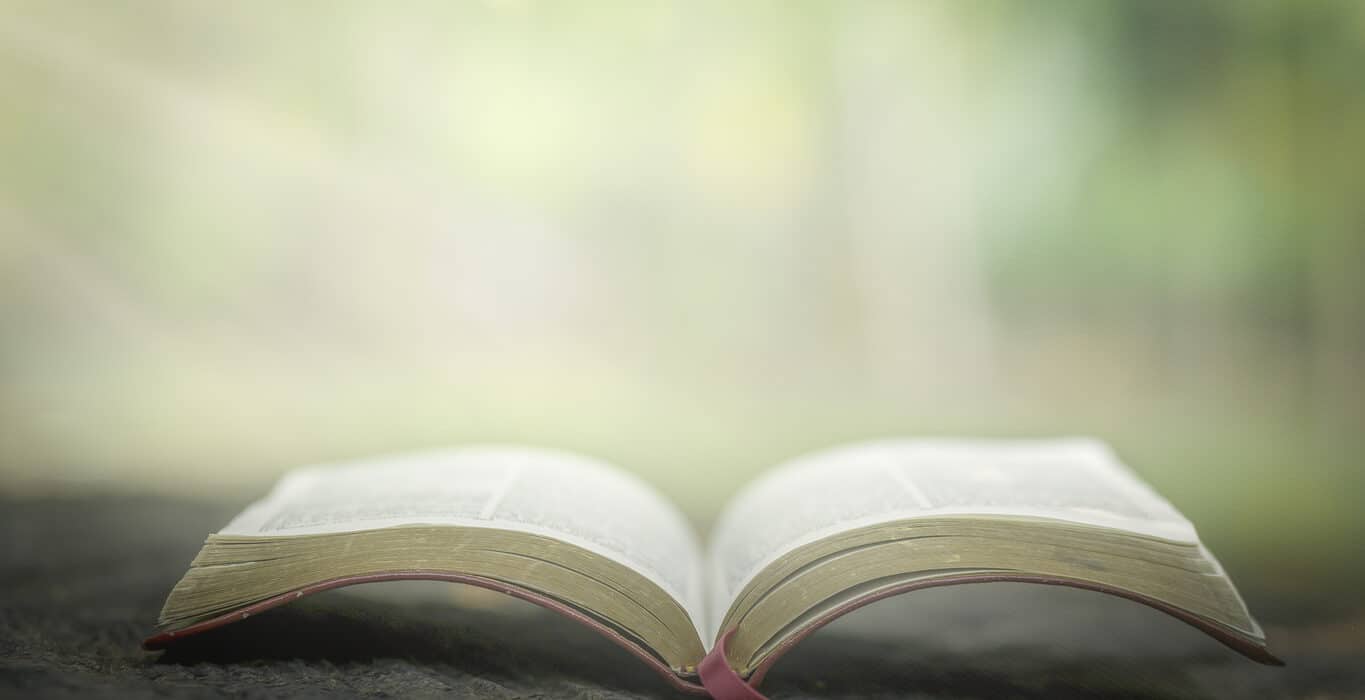Des débats qui annoncent des évolutions
En France, jusqu’à présent, l’euthanasie et le suicide assisté sont interdits par la loi. Mais les choses sont en train de changer. D’une part, le Conseil Consultatif National d’Éthique, dans son avis n°139 rendu en septembre 2022, s’est montré favorable à une aide active à mourir, alors que jusqu’à présent il s’y était toujours montré opposé. D’autre part, la consultation citoyenne qui a eu lieu à l’hiver 2022-2023 a conclu, pour une très large majorité des participants, à une dépénalisation de l’aide active à mourir. Et il se peut, dès lors, qu’un projet de loi vienne prochainement sur la table, pour précisément dépénaliser l’euthanasie ou le suicide assisté.
Or un des arguments que l’on entend souvent dans le débat sur la fin de vie, chez ceux qui veulent autoriser l’euthanasie, c’est l’argument de la compassion : compassion envers la personne dépendante en fin de vie qui souffre terriblement, qui est seule, et du coup désir, par « compassion », d’abréger ses souffrances. Il me semble qu’il y a là un dévoiement de ce qu’est réellement la compassion, une parodie de l’amour tel que nous l’enseigne l’Évangile. En effet, l’amour auquel nous appelle l’Évangile n’est pas la compassion au sens où l’entendent les pro-euthanasie, mais un amour qui est lié à la vérité et à la justice, un amour exigeant qui, bien loin de nous amener à aider des personnes à mourir, va, au contraire, les accompagner et les entourer le mieux et le plus possible jusqu’à leur fin naturelle.
La situation actuelle
Ce qui est en train de se passer est d’autant plus paradoxal que nous avons la chance, en France, d’avoir une loi globalement bonne et sage. Cette loi, dite « Léonetti » en 2005 puis révisée en loi « Claeys-Leonetti » en 2016, répond en effet globalement bien aux situations de fin de vie, elle se met résolument du côté du patient, du soulagement de ses souffrances et du respect de sa volonté. En particulier, elle prévoit la possibilité de directives anticipées de la part du patient qui s’imposent au médecin (sauf exceptions). Ces directives peuvent par exemple exprimer le refus de tout acharnement thérapeutique (dit « obstination déraisonnable » aujourd’hui). Le patient peut aussi choisir d’arrêter tout traitement ou soins vitaux (comme l’alimentation et l’hydratation artificielles). La loi prévoit aussi, quand le pronostic vital du patient est engagé à court terme et que ses souffrances sont réfractaires à tout traitement, la possibilité d’une sédation profonde terminale (une sorte d’anesthésie générale). Elle prévoit enfin le développement des […]