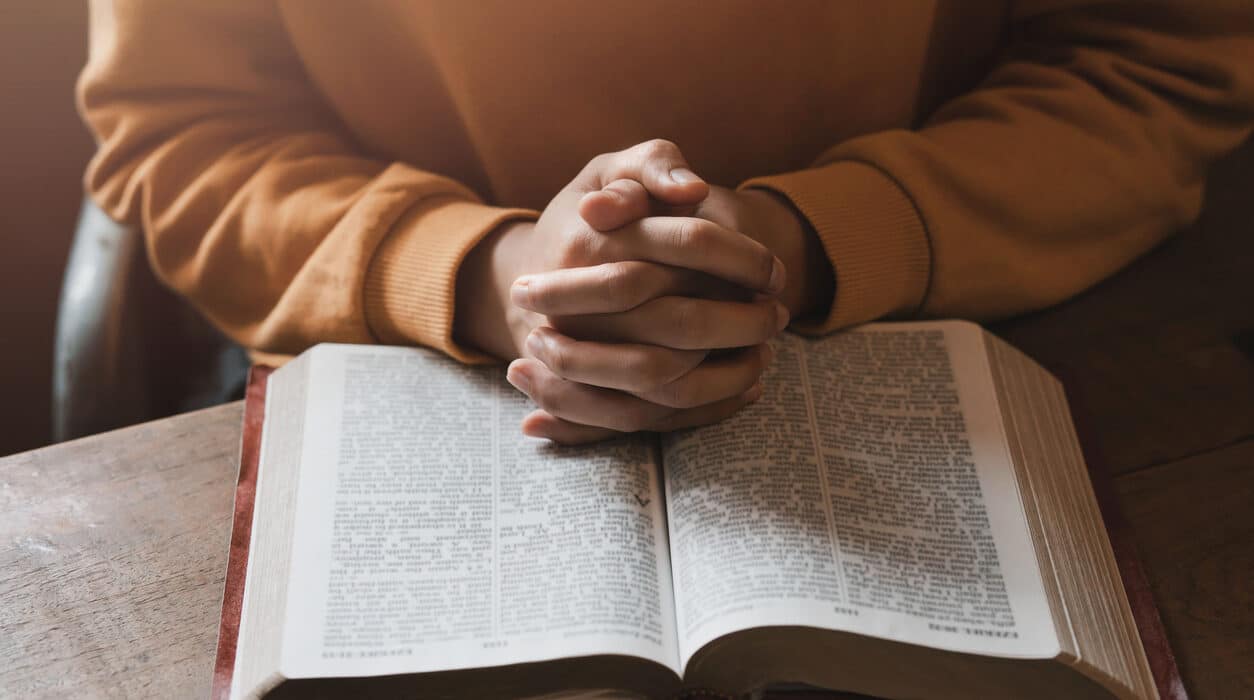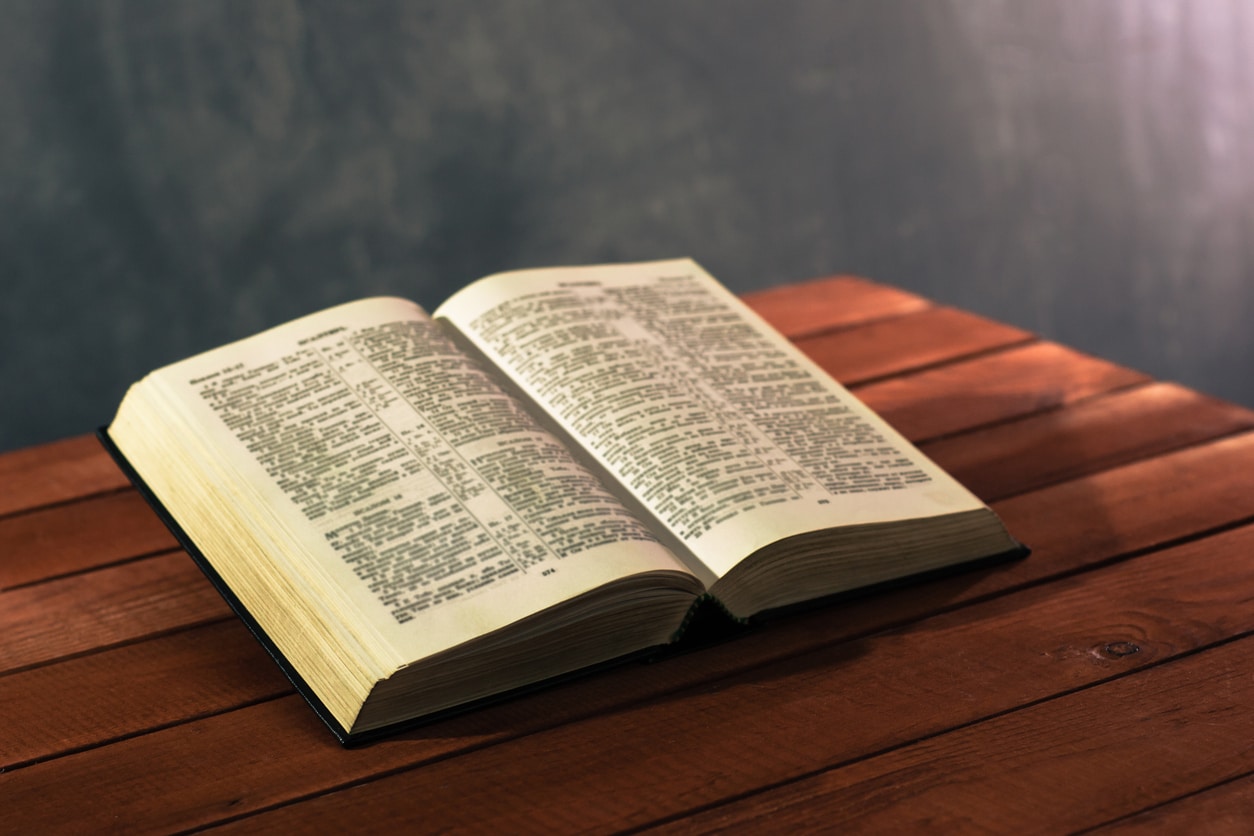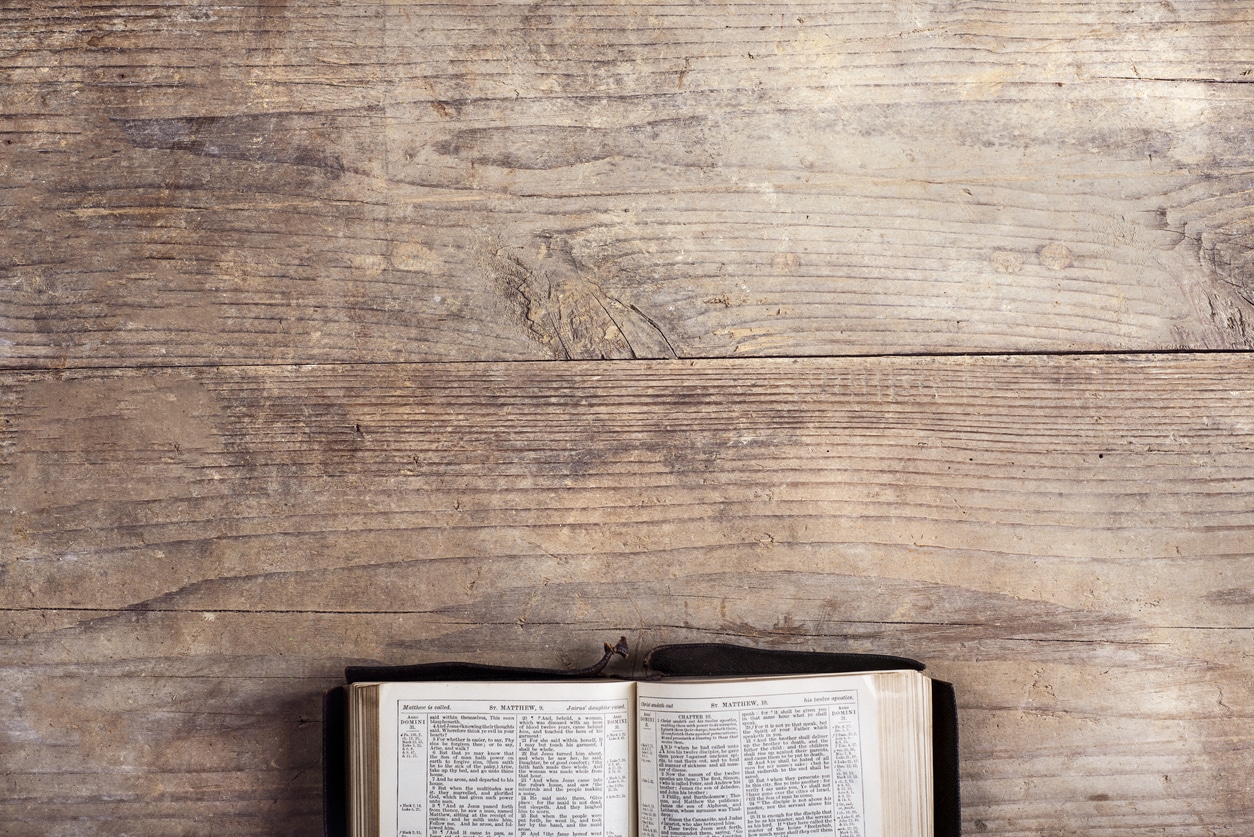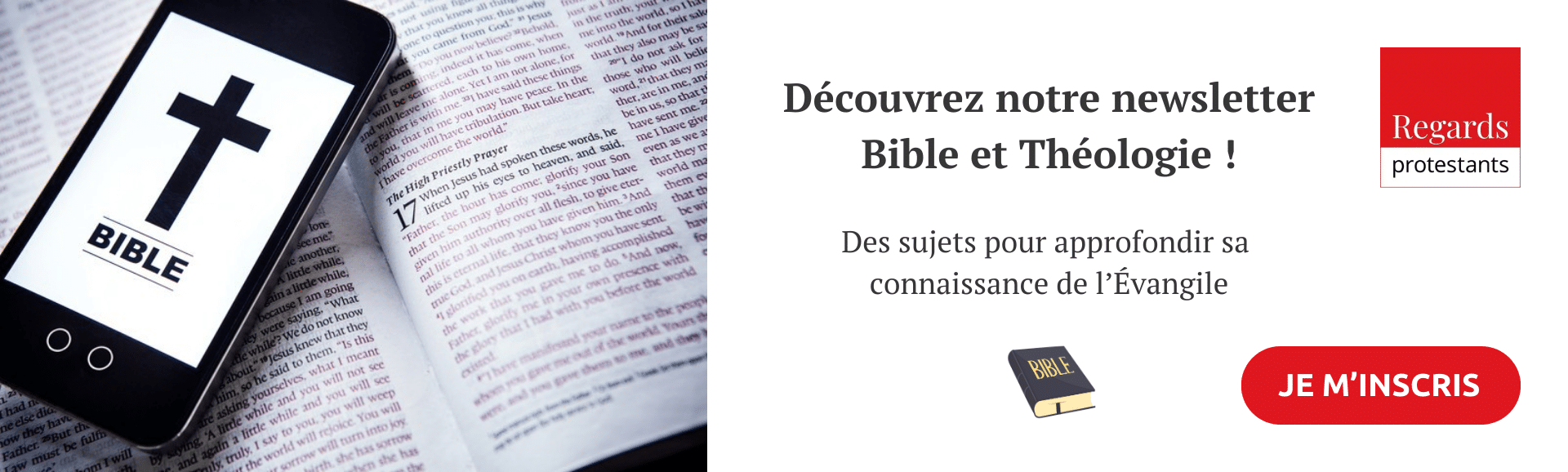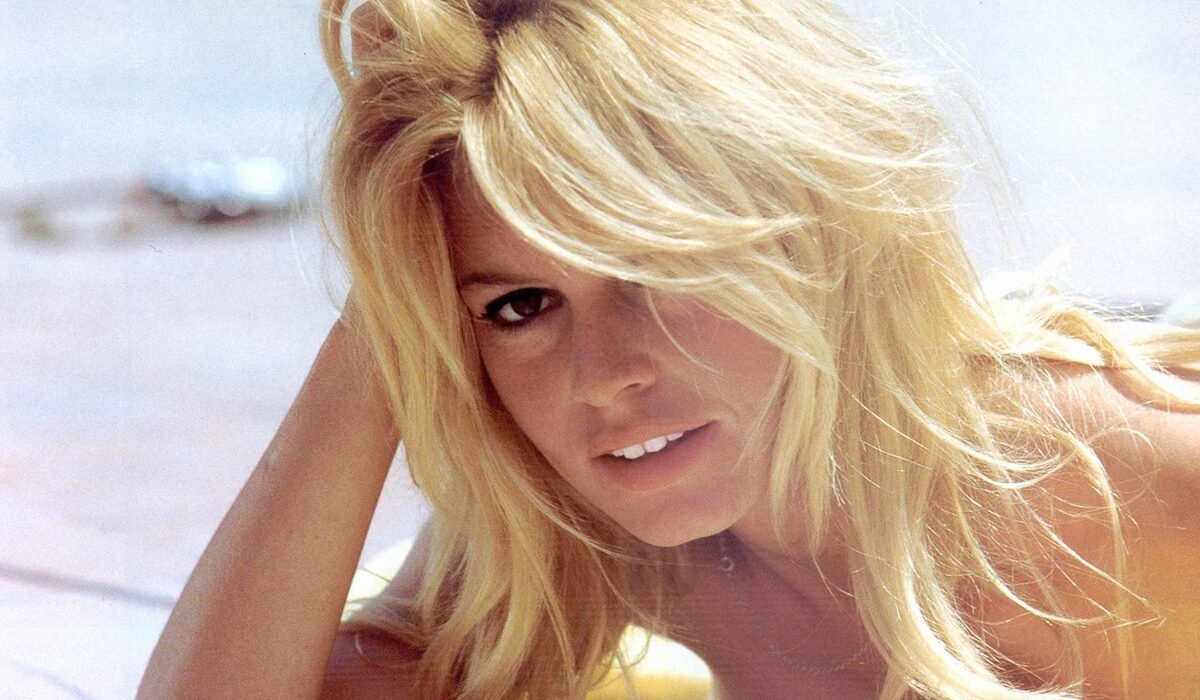Une première question pour introduire notre sujet : se déclarer chrétien, qu’est ce que cela signifie[1]?
Donnons d’abord quelques exemples pour saisir dans quel contexte on peut on en venir à cette déclaration, on pourrait dire aussi à ce coming out.
On a baigné dans la religion chrétienne depuis son enfance, on a été enfant de chœur, on a suivi le caté. Puis il se produit un déclic : on se déclare chrétien, on reprend à son compte, de son propre chef, ce qui jusque là avait été vécu sur un mode passif, sans que l’on ne soit vraiment conscient de ce que l’on récitait et faisait
Autre exemple. On a vécu une enfance et une jeunesse complètement athée. Puis, un soir, à 16 ans, on éprouve un sentiment d’infini, de vertige devant la voûte étoilé. On a le sentiment qu’il y a quelque chose de divin en ce monde. Et, pour donner suite à cette expérience “mystique“, on se rend le lendemain à une messe ou à un culte protestant. On y découvre un discours à cent lieues de ce qu’on a vécu la veille. Et pourtant, peu après, on demande à pouvoir communier et on se déclare chrétien. Et au culte, on confesse le Credo de la foi chrétienne.
Autre exemple. On a été emprisonné à la suite d’un délit que l’on a commis. On a peur de “replonger“ dès que l’on sortira de prison. On est tiraillé par le désir de changer de vie, de “se sauver“ de l’emprise de sa vie passée. L’aumônier de la prison vous remet un Nouveau Testament. On le lit tous les soirs sans y comprendre grand’chose. Et pourtant, dès la visite suivante de l’aumônier, on se déclare chrétien, pour faire un saut en avant, pour tenter de changer de vie.
Dernier exemple. On a lu Pascal et Victor Hugo. On a écouté des Passions de Bach. Cela suscite en vous une sorte d’inquiétude métaphysique, un ensemble de questions sans réponse, le sentiment qu’il y a une vérité ultime sans qu’on puisse la connaître. Et, un beau jour, sans doute parce que l’on est à la fois travaillé, insatisfait et frustré par cette quête, on prend une décision, on se déclare chrétien et on demande le baptême.
Se déclarer chrétien, une décision et une posture
Comment expliquer ce passage d’une religiosité imprécise à la décision d’“entrer en Christianisme“, c’est-à-dire dans une religion instituée ayant ses articles de foi, ses rituels, ses sacrements ? Comment expliquer ce “saut“ ?
Disons le clairement, sur cette question nous réfléchissons plus avec les outils de la psychologie et de la sociologie qu’avec ceux de la théologie.
En fait, contrairement à ce que l’on pourrait supposer, “se déclarer chrétien“, “se constituer chrétien“ “se faire chrétien“, ce n’est pas d’abord l’expression d’une foi personnelle dans les différents articles de foi du catéchisme chrétien (ceux du Credo, par exemple). Se déclarer chrétien, c’est plutôt un acte, une décision, une manière d’adopter une posture nouvelle. Ce qui motive ce changement, ce n’est pas le contenu du catéchisme chrétien, c’est plutôt le désir de marquer un nouveau choix de vie, une volonté de s’engager, voire de s’enrôler. de fait, se déclarer chrétien, c’est d’abord adapter une pratique beaucoup plus qu’ une foi. On va à la messe, on fait sa prière en récitant par exemple le Notre Père, on fait suivre l’instruction religieuse à ses enfants etc. Et ceci est vrai pour les nouveaux convertis comme pour les chrétiens de naissance.
Dans le fait de se déclarer chrétien, il peut y avoir des motivations spirituelles, mais aussi des motifs plus profanes : un désir de conformisme (faire comme les autres), ou au contraire d’anticonformisme (se singulariser par rapport à ses parents par exemple), une certaine forme d’idéalisme et un désir d’avoir une vie “hors du sens commun“[2] pour échapper à la médiocrité de la vie, voire à la tentation du suicide
Il faut donc prendre conscience de l’écart entre les éléments d’ordre psychologique qui nous incitent à embrasser une religion et la nature de l’acte que nous effectuons en confessant les articles de foi du catéchisme chrétien.
Qu’est ce que la “foi chrétienne“ ? Un étayage dans un idiome culturel
Il faut différencier le “ce qui pousse à croire“ (la fides qua) du contenu de la foi professée (la fides quae). La fides qua, c’est le besoin de croire, c’est aussi le sens du mystère, l’étonnement devant les énigmes, ou encore la “désirance“[3] ou d’autres formes de la religion naturelle. On pourrait supposer que cette spiritualité diffuse constitue l’“essence“ de la foi chrétienne. Mais, en fait, il n’en est rien. Le fait de professer la foi chrétienne n’est pas une manière d’exprimer une croyance personnelle. Elle est une fides quae, c’est-à-dire une adhésion (on pourrait dire aussi un assentiment ou même une soumission volontaire[4]) à un catéchisme et à des articles de foi qui sont portés par une collectivité et institués par une tradition culturelle, cultuelle et institutionnelle.
Si le chrétien entre dans le jeu des confessions ecclésiales, c’est pour donner une identité, c’est-à-dire une identification, un langage et un statut à ce que, faute de mieux, on pourrait appeler sa religiosité. Celle-ci ne peut ni se formuler ni même subsister indépendamment d’un étayage dans l’idiome d’une religion sociale.
De façon plus générale, le Moi personnel ne se constitue que par “étayage“ sur des codes sociaux et il ne subsiste que par ces supports d’étayage. Comme le dit le philosophe Clément Rosset, notre identité nous est « allouée »[5] ; elle est structurée, voire créée par la société. L’habit fait le moine, il lui impute et lui alloue l’identité de moine. La confession du Credo fait le chrétien. Elle lui alloue son identité de chrétien[6].
On peut reprendre ceci en utilisant la distinction que fait Erving Goffman[7] entre l’ « acteur » et le « personnage ». L’acteur joue un rôle ou plus précisément entre dans le jeu d’un rôle (le rôle de garçon de café, celui de chrétien) et il en fait ainsi son « personnage » . On est tenté de supposer que l’acteur a un Moi intime et personnel qui est recouvert par le personnage qui est « joué » ; et on s’interroge alors sur la duplicité de l’acteur : Jusqu’à quel point croit-il à ce qu’il dit et à ce qu’il fait ? Mais en fait le problème n’est pas là. Ce qui est le propre du Moi intime, c’est de se constituer en personnage. Le Moi intime n’est que l’ « acteur » du Moi social, le mot « acteur » ne caractérisant plus alors un acteur de théâtre (c’est-à-dire un hypocrite au sens étymologique) mais le processus qui promeut la formation du Moi social dans des modèles sociaux ; et ce Moi social devient le seul Moi propre.
S’il en est ainsi, comment peut-on caractériser « la foi chrétienne », on pourrait dire aussi la « religion chrétienne » ?
La foi chrétienne ne relève ni du « croire que » (croire que Dieu est le créateur du monde, que Jésus est né d’une vierge, etc.) ni même du « croire en » (croire en la Providence, en Dieu, en ce que prêche Jésus-Christ)… Elle relève du « croire à » (dans le sens de : croire à ce que dit De Gaulle, croire aux théories de Darwin, etc.). Elle consiste à s’en remettre à ce qu’enseignent l’Eglise, la culture et la tradition chrétiennes. On peut aussi dire qu’elle est un « croire ce que » (croire ce que l’on a appris à l’école ou à l’Église)[8]. Le fidèle croit l’Église[9] lorsqu’elle enseigne que « Jésus-Christ est le Fils de Dieu » etc. et il est bien clair que s’il avait vécu au sein d’une autre culture et d’un autre idiome, les choses se seraient passé autrement.
Le fidèle “donne procuration“ à l’Eglise et aux articles du Credo pour qu’ils disent et définissent la bonne manière de confesser la foi ; il leur « donne pouvoir »[10].
Même si le Symbole des Apôtres et celui de Nicée Constantinople commencent par Credo (« je crois »), ils ont très vite été présentés, dès le Concile de Calcédoine (451 ap. J.C.), comme un enseignement de l’Eglise que les fidèles ont, non pas à « croire » mais à « confesser ». Confiteri…docemus : nous enseignons ce qu’il faut confesser[11]. « Confesser », ce n’est pas la même chose que croire ; certes les fidèles peuvent en venir à croire ce que professe l’enseignement de l’Église, mais cette croyance relève de la confiance en ce qui est enseigné (tout comme un élève a confiance en ce que l’École lui enseigne). La foi chrétienne est seulement un « assentiment »[12] à l’enseignement de l’Église qui s’exprime dans l’idiome culturel du Christianisme.
En effet, en conformité avec l’approche de Wittgenstein[13] et Lindbeck[14], nous voulons voir le Christianisme comme un idiome et une culture[15]. C’est dans cet idiome que l’on peut qualifier comme un “jeu de langage“ que s’expriment l’enseignement de l’Eglise et les confessions de foi des fidèles.
Entrer dans le jeu du Christianisme
Ainsi, confesser la foi chrétienne, c’est accomplir un acte, ou plutôt un geste. Plus précisément, c’est “entrer dans le jeu“ d’un langage et d’un ensemble d’affirmations et de comportements conventionnels. Ainsi nous définissons le “confesser“ et même le “croire“ comme l’acte d’“entrer dans le jeu d’“ un donné culturel et idiomatique, en l’occurrence celui du Christianisme et de ses articles de foi.
Et en donnant cette définition, nous jouons sur les différents sens du mot “jeu“.
• Le mot “jeu“ a d’abord le sens de “système“ (un peu comme on dit un jeu de cartes, un jeu de règles). Ainsi, en entrant dans le jeu d’une partie de football, le footballeur entre dans un “monde“ (un écosystème) spécifique et il en adopte les règles, les traditions et les codes. De même, entrer dans le jeu du Christianisme, c’est quitter le monde profane et la manière usuelle de voir les choses et d’en rendre compte pour entrer dans un “monde“, ou plus exactement dans un “jeu de langage“ (celui de la théologie et de la foi chrétienne) qui rend compte des choses de la vie sur un mode spécifique (par exemple les lois morales sont instituées par Dieu, les fautes des hommes leur sont pardonnées par Dieu etc.).
Celui qui entre dans le jeu du Christianisme entre dans une religion spécifique caractérisée par son jeu (par son système) de conventions, de présupposés, de rituels, d’énoncés dogmatiques et d’articles de foi[16]. Il entre dans le jeu d’un jeu de coutumes langagières, conceptuelles, rituelles qui le précèdent. et ont cours depuis longtemps avant lui. Pour lui, le Christianisme est toujours un donné préalable qui existe indépendamment de lui ; et il entre dans ce « déjà là ».
• Mais le mot “jeu“ connote aussi avec le verbe jouer, dans le sens de “jouer un rôle“: jouer dans un pièce de théâtre, jouer dans un jeu (celui des gendarmes et des voleurs par exemple) …
Le fidèle entre dans le jeu du Christianisme en y jouant son rôle de chrétien. Entrer dans le jeu du Christianisme, c’est entrer à l’intérieur d’un jeu (un écosystème) que l’on peut voir comme une fiction[17], on pourrait dire un “opéra“ où Dieu intervient comme un deus ex machina, où le Christ est un être surnaturel, où les morts ressuscitent etc. Lorsqu’il participe à l’office, le fidèle devient partie prenante de cet “opéra“; il confesse le Credo de cet opéra, il récite le Notre Père, il demande à recevoir le “Corps du Christ “… Bref le chrétien “joue son rôle de chrétien“,il se conforme, tout comme un acteur de théâtre, au “livret“ des rituels et des croyances du Christianisme.
Et on peut se demander si, tout comme un acteur de théâtre, le fidèle voit ce qu’il fait et confesse comme un “jeu fictionnel“[18], c’est-à-dire comme une “hypocrisie“ (au sens étymologique du terme).
Les chrétiens répondront bien évidemment : « Que nenni ! Je crois ce que je fais et ce que je dis ».
De fait, quand un acteur “entre vraiment dans le jeu“ d’une pièce de théâtre, il est porté et subjugué par son rôle ; il est habité par son rôle. Et, de la même manière, peut-on supposer, en entrant dans le jeu du Christianisme, le fidèle “internalise“ et “intègre“ son discours; il se l’approprie. Il se laisse façonner et “matricier“ dans et par la matrice de l’enseignement du Christianisme.Certes, il adopte un comportement culturel dicté par une tradition, mais, ce faisant, il n’est pas plus “hypocrite“ que ne l’est un Français qui dit préférer les chansons françaises à la musique chinoise. Il est spontanément “inculturé“ dans l’idiome culturel de sa “tribu“.
On peut le dire autrement. Certes, ce que professe le chrétien peut être considéré comme une fiction et une illusion. Mais s’il entre dans le jeu de cette illusion, cette illusion cesse pour lui d’en être une.
Comme le dit Pierre Bourdieu[19], “entrer dans le jeu de“, c’est entrer en « illusio »[20] (à ne pas confondre avec l’illusion). L’illusio, un peu comme l’habitus, est « une structure intériorisée qui se traduit par une action non réfléchie qui conforte inconsciemment un positionnement dans l’espace social »[21].
Mais, bien sûr, on peut quand même se demander jusqu’où le fidèle entre vraiment dans ce qu’il confesse, jusqu’où il internalise vraiment les articles de la foi chrétienne. Et, il faut le reconnaître, il est clair que pour chacun des fidèles, la place du curseur entre “faire comme si“ et “faire pour de vrai » est différente.
• Pour poursuivre notre réflexion sur ce point, il faut ajouter que “entrer dans le jeu du Christianisme“, c’est entrer dans un monde fictionnel mais aussi onirique.
Le Christianisme est un récit
Adam et Eve, Moïse, Jésus et Dieu lui-même sont les héros de ce récit et le Christianisme narre leurs actions et leurs hauts faits sur un mode que l’on pourrait qualifier de romanesque. Et c’est justement pour cela que ces récits détiennent une force d’incantation.
De fait, les articles de foi constituent pour le fidèle un matériel et un support grâce auquel il peut laisser libre cours à son goût du merveilleux. En entrant dans ce jeu onirique, le fidèle en fait une composante de sa vie psychique. La Vierge devient une mère à qui l’on confie ses chagrins ; le Christ devient un prédicateur qui fait rêver d’une vie nouvelle; Dieu devient un grand Manitou qu’on appelle au secours.
De même, quand une petite fille joue à la poupée, elle entre dans ce jeu et dès lors, ce n’est plus un jeu, c’est-à-dire un faire semblant ; elle est dans le fantasying pour parler comme Winnicott[22], et ce fantasying est une composante authentique de sa vie propre. Elle est dans son monde et, dans son monde, la poupée est une princesse.
Certes le processus de l’internalisation du Christianisme dans la vie du fidèle peut être plus ou moins profond. Certes, tout comme l’enfant qui joue à la poupée ou l’internaute qui surfe sur Second Life, le chrétien peut être plus ou moins pris par son jeu, mais quoi qu’il en soit, tant qu’il est dans son jeu, il perd le sentiment de faire semblant. Si l’on veut parler d’illusion, l’illusion dont il s’agit est en fait une auto-illusion. L’illusio peut conduire à une forme d’auto-illusion.
Le fidèle est pris par la « force d’attraction » du jeu[23]. Au cours de la liturgie, il se laisse prendre, porter et entraîner par une forme de rêve éveillé et d’état mystique. Le “croire“, autrement dit, la “foi“, n’est qu’une forme légère de cette auto-hypnose[24].
Ce qui favorise cette auto-hypnose, c’est le fait que le langage de la liturgie a une fonction poétique. Ce qui compte dans le discours que l’on tient, c’est la musique et le pouvoir évocateur des images. Et de fait, le Credo a d’abord été un hymne, tout comme La Marseillaise ou L’Internationale. On le confesse comme on chante un cantique de Noël qui évoque les émotions de l’enfance.
Selon Sperber et Wilson, tout langage suscite des inférences, on pourrait dire des « effets »[25]. Et ceci nous paraît particulièrement pertinent pour le langage liturgique et théologique. Les mots de ce langage ont une résonance; ils sont poétiques dans le sens où ils sont créateurs d’images, d’harmoniques, d’évocations en lien avec notre culture et notre histoire personnelle. En fait, le chrétien réinvente le Christianisme, il en fait “son“ christianisme. Pour lui, les mots « Jésus-Christ est le Seigneur » peuvent évoquer une sorte d’icône, celle, par exemple, du Christ en majesté de l’église de Vézelay. Mais il peut aussi voir ce Jésus-Christ comme l’incarnation de tous les exclus, les sacrifiés; ou faire de lui le premier des objecteurs de conscience ou des révolutionnaires…
La foi chrétienne, une illusion volontaire
Mais nous voulons ajouter un autre point. Si, en confessant le Credo, le fidèle en vient à le croire, c’est aussi parce qu’il est porté par le désir, voire la volonté de croire.
Freud écrit « Nous appelons illusion une croyance quand, dans la motivation de celle-ci, la réalisation d’un désir est prévalante »[26], et nous ajoutons que, pour nous, le premier de ces désirs est celui de croire, c’est-à-dire d’entrer dans le jeu de ce que Freud appelle des illusions.
Il y a un désir d’être happé, subjugué, fasciné et même aliéné[27] par le jeu que l’on joue. Il y a de fait un amour des fictions en tant que telles parce qu’elles nous font éprouver, pour de vrai, des émotions plus fortes et plus vraies que les situations réelles. Autrement dit, il y a un désir, voire une forme de volonté, d’ “entrer en illusion“.
On peut tout simplement voir là l’une des expressions du « principe de plaisir » qu’évoque Freud. En effet, tout comme il y a du plaisir à entrer dans le jeu de contes ou d’“histoires“, il y a du plaisir à entrer dans le jeu d’illusions et à croire à ces illusions. De fait, le besoin de croire est certainement l’une des formes du principe de plaisir.
Nous irons jusqu’à dire qu’entrer dans le jeu du Christianisme, c’est entrer volontairement dans le jeu d’une illusion.
La foi chrétienne peut ainsi être caractérisée comme une illusion volontaire, même si cette expression a quelque chose de déconcertant et même si elle peut paraître un oxymore. Le chrétien sait “quelque part » que la foi chrétienne est une illusion, mais il veut cette illusion ; et il la veut parce qu’il y a en lui une prédisposition à croire des illusions, un amour des illusions, un plaisir d’être en illusion, et pour le dire en un mot, une volonté d’entrer en illusion.
Le Credo : Y croit-on ?
Ainsi, à propos de la question « Le chrétien croit-il ce qu’il confesse ? », il ne faut pas se laisser enfermer dans l’alternative : il y croit ou il fait semblant. De fait, dans la manière d’entrer dans le jeu du Christianisme, il y a tout un jeu. Le chrétien entre, mais aussi n’entre pas dans le “scénario“ du christianisme . Cette forme d’ambivalence est d’ailleurs un fait général. Le chaman qui opère des guérisons a cependant conscience que ses gestes et exorcismes sont aussi de l’ordre du spectacle et du jeu de rôle[28]. De même, les Indiens Hopi croient aux esprits, mais, quelque part, ils savent aussi que l’objet de cette croyance n’existe pas ; les analyses de Pascal Boyer[29] vont dans ce sens. De même, la petite fille qui croit “pour de vrai“ au Père Noël pourra cependant dire « L’an prochain, je ne croirai plus au Père Noël ». Ainsi l’auto-illusion, ou si l’on préfère la croyance, n’est jamais totale.
Comment expliquer ce paradoxe ? Il tient à la force des récits et à l’emprise qu’ils ont sur nous et ce quand bien même nous savons que ce sont de simples fictions. Prenons un exemple. Il est arrivé à tout le monde de pleurer en regardant un mélodrame au cinéma. Le spectateur est tout à fait pris par le jeu du spectacle ; il y a quelque chose qui, en lui, résonne profondément avec ce scénario. Et pourtant, pendant qu’il pleure, il sait tout à fait que ce qu’il voit n’est pas “pour de vrai“. De même, on peut “croire“ au récit biblique et aux articles de foi du Christianisme c’est-à-dire être conquis par eux à en pleurer ou à en revivre, et néanmoins savoir qu’ils relèvent de la fiction.
De fait, même s’il confesse le Credo avec une totale sincérité, le fidèle n’en continue pas moins à vivre dans le réel comme si de rien n’était, c’est-à-dire comme si Dieu n’existait pas. Il confesse le Credo comme si Dieu existait et il vit comme s’il n’existait pas. Il confesse que Dieu est un Sauveur sur lequel on peut compter en toutes circonstances ; mais si le clocher de l’église menace de s’effondrer au cours de l’office, il sortira en toute hâte. Et, même s’il confesse qu’il y a après la mort une vie éternelle, il n’est pas particulièrement pressé de rejoindre ce paradis.
Ainsi, le fidèle entre dans le jeu du Christianisme et de ses articles de foi, mais dans certaines limites. Le moi n’est pas monolithique ; il est composé de strates différentes. C’est ce que Marx appelle la division du sujet et Freud le clivage du Moi. Pour le fidèle, il y a la vérité chrétienne et il y a aussi la vérité réelle[30]. Pour Freud, il y a clivage du Moi lorsqu’on maintient en même temps deux attitudes contradictoires, et qui s’ignorent, à l’égard de la réalité. L’une des deux dénie la réalité (le fidèle confesse un Dieu tout puissant sur qui on peut compter), et l’autre en tient compte (il quitte l’église en courant).
Au fond, commencer le Credo par « je crois » n’a aucune pertinence sur le plan psychologique et induit un faux problème, celui de savoir si l’on y « croit » vraiment et si l’on considère que ces énoncés disent ou non des vérités. En fait on aime les énoncés du Credo et on aime les aimer. Le premier commandement du « Sommaire de la Loi » enseigné par Jésus s’exprime de manière juste en disant « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout cœur de toute ton âme et de toute ta pensée ». Le sentiment religieux ne relève ni de la connaissance ni de la quête de la vérité mais bien plutôt d’une forme de jouissance et d’amour pour les « vérités » de la foi. Dire « je crois », c’est simplement entrer dans le jeu et la jouissance d’un récit qui nous enchante.
En fait, nous aimons les fictions. La petite fille aime croire au Père-Noël comme elle aime les contes de fées ; le comédien aime jouer Rodrigue ; et de même le fidèle aime confesser le Credo. Il y a même une addiction aux illusions comme il y a une addiction au théâtre et aux romans. Ce n’est nullement un hasard que le premier geste d’Adam et Eve a été de cueillir et de manger un fruit hallucinogène qui leur procurait le sentiment, l’impression et l’illusion d’être « comme les dieux ». Ce n’est pas non plus un hasard que l’expérience de la Pentecôte a été vue comme une forme d’ivresse (cf. « ils sont plein de vin doux », Actes 2,13). Le goût des ivresses sacrées est à la base de toutes les religions et de toutes les pratiques religieuses.
[1] Cet article reprend les thèmes du chapitre IV de mon ouvrage Christianisme et besoin de dogmatisme , une analyse critique, préface de Sophie de Mijolla-Mellor,Berg International 2015
[2] «L’entrée dans un univers scolastique », dans l’école du Christianisme par exemple, « suppose une mise en suspend des présupposés du sens commun et une adhésion para-doxale à un ensemble plus ou moins nouveau de présupposés et, corrélativement, la découverte d’enjeux et d’urgences inconnus et incompris de l’expérience ordinaire » Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil 1997, p. 22.
[3] On désigne ainsi un désir sans objet défini et précis. C’est un élan “à vide“, pourrait-on dire.
[4] cf. Etienne de la Boëtie, Discours sur la servitude volontaire, Folio Plus philosophie, 2008.
[5] Clément Rosset, Loin de moi, étude sur l’identité, Ed. de Minuit, 1999, p. 80.
[6] Comme l’écrit la Professeur de psychanalyse Sophie de Mijolla-Mellor dans sa Préface à notre ouvrage op.cit. p. 9, « Professer sa foi… exprime certes une conviction, mais celle-ci est d’abord une adhésion qui fonde une identité et non un contenu de croyance ».
[7] Er. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne , Tome 1, La Présentation de soi, Minuit 1973, 238-239.
[8] Notons que le fait de « croire sur parole » n’est en rien spécifique du champ du religieux. L’élève de l’enseignement primaire apprend à croire sur parole son maître lorsqu’il lui dit que la terre est ronde (il n’a que rarement la possibilité de faire le tour de la terre, ce qui seul pourrait lui en fournir la démonstration) cf. Freud, L’avenir d’une illusion, PUF Quadrige 1995, p.26.
[9] A cet égard, il est significatif que le Symbole des Apôtres dise non pas « Je crois en la Sainte Eglise », mais « Je crois la Sainte Eglise ».
[10] De fait, si l’on en croit Benveniste, la toute première signification de « croire » était bien là. Croire, c’est placer sa confiance en, c’est faire confiance à (un piton d’escalade, une carte Michelin, un gourou, un enseignement ecclésial ou autre). « Croire » (la forme première de ce verbe étant creire, qui a donné créance), c’est « accorder sa créance à ». Le fidèle fait confiance à l’Eglise et à ce qu’elle enseigne. Il lui donne sa créance comme on donne une lettre de créance à un diplomate pour lui donner pouvoir et procuration. Le fidèle donne procuration à l’Eglise et à la Bible pour dire la vérité.
[11] Cf. Walter Kasper, Dogme et Évangile, Cerf, 2010, page 45 citant l’article 301 du Denzinger (recueil des définitions et des déclarations du Magistère catholique).
[12]En effet l’Église elle-même, et en particulier l’Église catholique, caractérise la foi chrétienne comme un assentiment à des articles de foi institués par le Magistère et par la Tradition. La Profession de foi proposée aux fidèles par la Congrégation de la doctrine de la foi sous le pontificat de Jean-Paul II se formule ainsi : « … avec une soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence, j’adhère à l’enseignement proposé tant par le Pontife romain que par le Collège des évêques lorsqu’ils exercent le Magistère authentique… ».Cf. A. Arjakowski, Qu’est ce que l’orthodoxie ? Folio Gallimard 2013, p. 199.
[13] L. Wittgenstein, Investigations philosophiques, Gallimard 1961. Cette oeuvre est intitulée Recherches philosophiques dans la dernière édition Gallimard 2005.
[14] G. Lindbeck La nature des doctrines religieuses et théologiques à l’âge du post-libéralismme; introduction de Marc Boss, Paris, Van Dieren éditeur, 2002.
[15] Le Christianisme est un idiome culturel parmi d’autres (il y a aussi l’idiome du Droit, celui de la philosophie etc.)
[16] «L’entrée dans un univers scolastique », dans l’école du Christianisme par exemple « suppose une mise en suspend des présupposés du sens commun et une adhésion para-doxale à un ensemble plus ou moins nouveau de présupposés et, corrélativement, la découverte d’enjeux et d’urgences inconnus et incompris de l’expérience ordinaire » Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil 1997, p. 22.
[17] Une fiction peut avoir une vérité; cf. notre précédent article: Les articles de foi du Christianisme ont-ils une vérité?
[18] Huizinga, Homo ludens, traduction française, Paris 1951, p. 34-35. « On peut, en bref, définir le jeu comme une situation ressentie comme fictive et située en dehors de la vie courante ». Les italiques sont de Huizinga.
[19] Pierre Bourdieu, Raisons Pratiques, Seuil 1994 et Méditations pascaliennes, Seuil 1997.
[20] D’ailleurs, si on se réfère à son étymologie, “illusion“ peut signifier “entrée dans un jeu“. En effet, le mot “illusion“ est dérivé du latin illusum, supin de illudere ,“se jouer de “ et a donc la même racine que “ludere“, jouer, entrer dans un jeu.
[21] Paul Costey, L’illusio chez Pierre Bourdieu , dans la Revue Tracés, revue de Sciences Humaines, août 2005 p. 13-27.
[22] D. W. Winnicott, Jeu et réalité, Folio, Essais, 1071, et en particulier la préface de J.-B. Pontalis, p. 10.
[23] cf. J.- B. Pontalis, La force d’attraction, Essais, Seuil, 1990.
[24] Cette auto-hypnose conduit à une diminution de la conscience et de la vigilance sur soi. De fait, dans le phénomène de l’hypnose et de l’auto-hypnose, les circuits neurologiques qui permettent d’assurer le contrôle de soi et la lucidité sont déconnectés au profit de ceux qui suscitent le fantasying et l’imagination.
[25] D. Sperber et D.Wilson, La Pertinence : communication et cognition, Minuit, 1989.
[26] Freud, L’Avenir d’une illusion, PUF 1971, p.45.
[27] L’expression est de Sophie de Mijolla, dans sa Préface à notre ouvrage, op. cit. p.10 et 11
[28] cf. Roger Caillois, L’homme et le sacré, Gallimard Idées p.204. « l’émotion religieuse la plus intense peut s’accompagner d’une représentation que l’on sait factice, d’un spectacle que l’on joue sciemment, mais qui n’est pourtant aucunement une tromperie ou un divertissement ».
[29] Pascal Boyer, Et l’homme créa les dieux, Folio Essais, Gallimard 2001, p. 349.
[30] Il faut d’ailleurs constater que l’Eglise elle-même légitime ce clivage ; bien plus elle en fait l’un des éléments de son enseignement dogmatique. Elle institue elle-même une forme de dualité sans confusion des deux vérités distinctes, celle relevant de la dogmatique et celle relevant d’une approche profane et laïque du réel. Elle refuse tout « concordisme » entre la vérité du dogmatique et la vérité scientifique du réel.