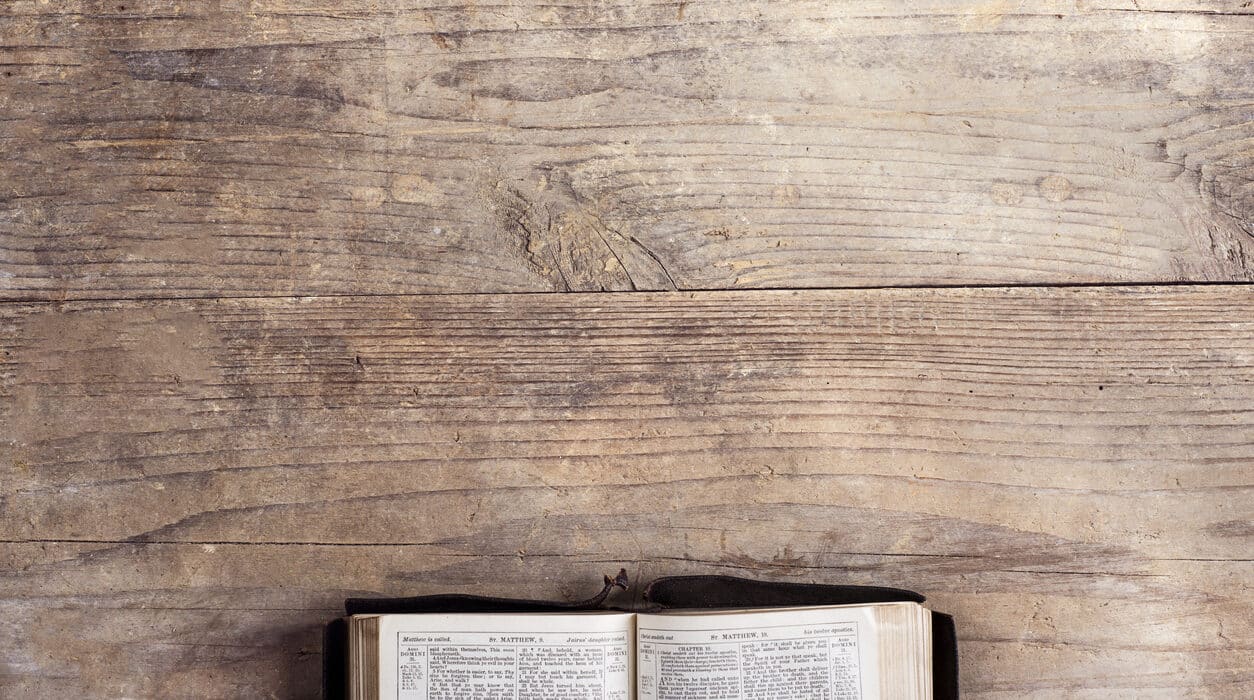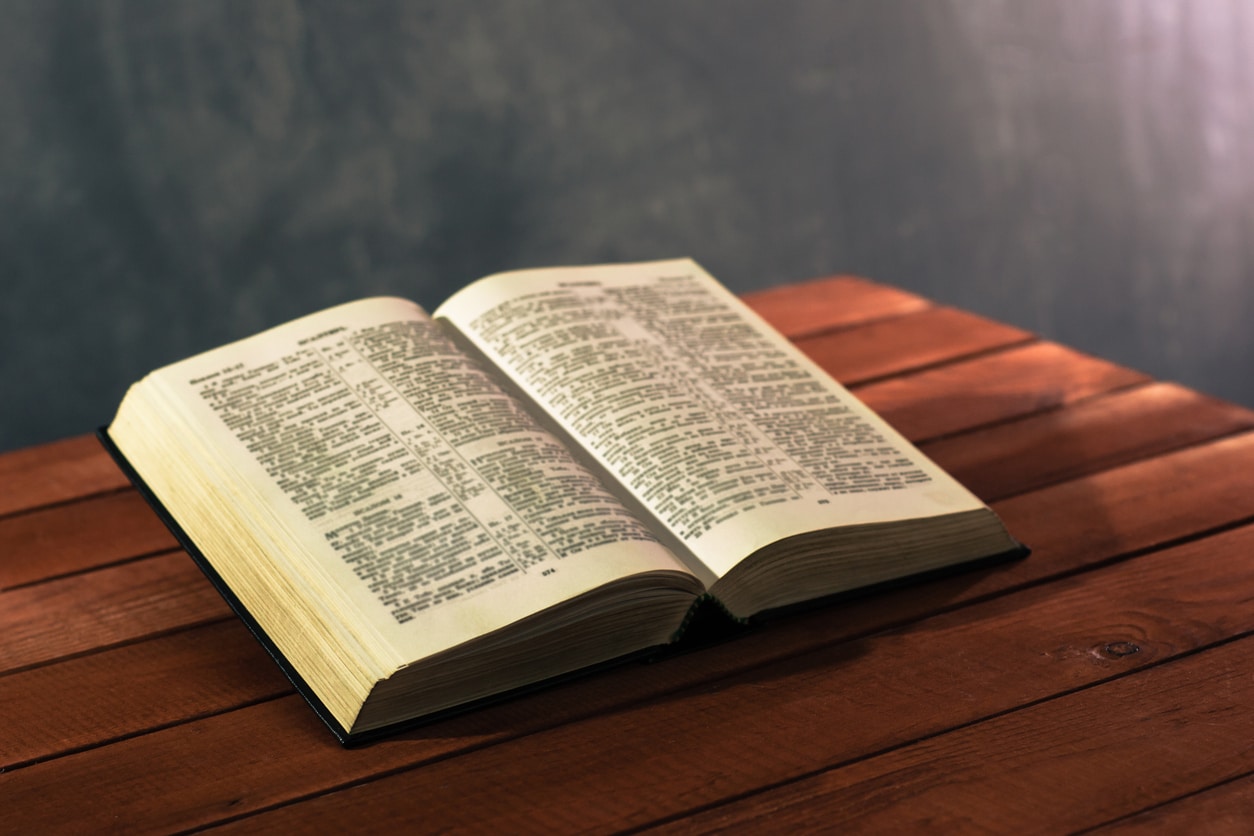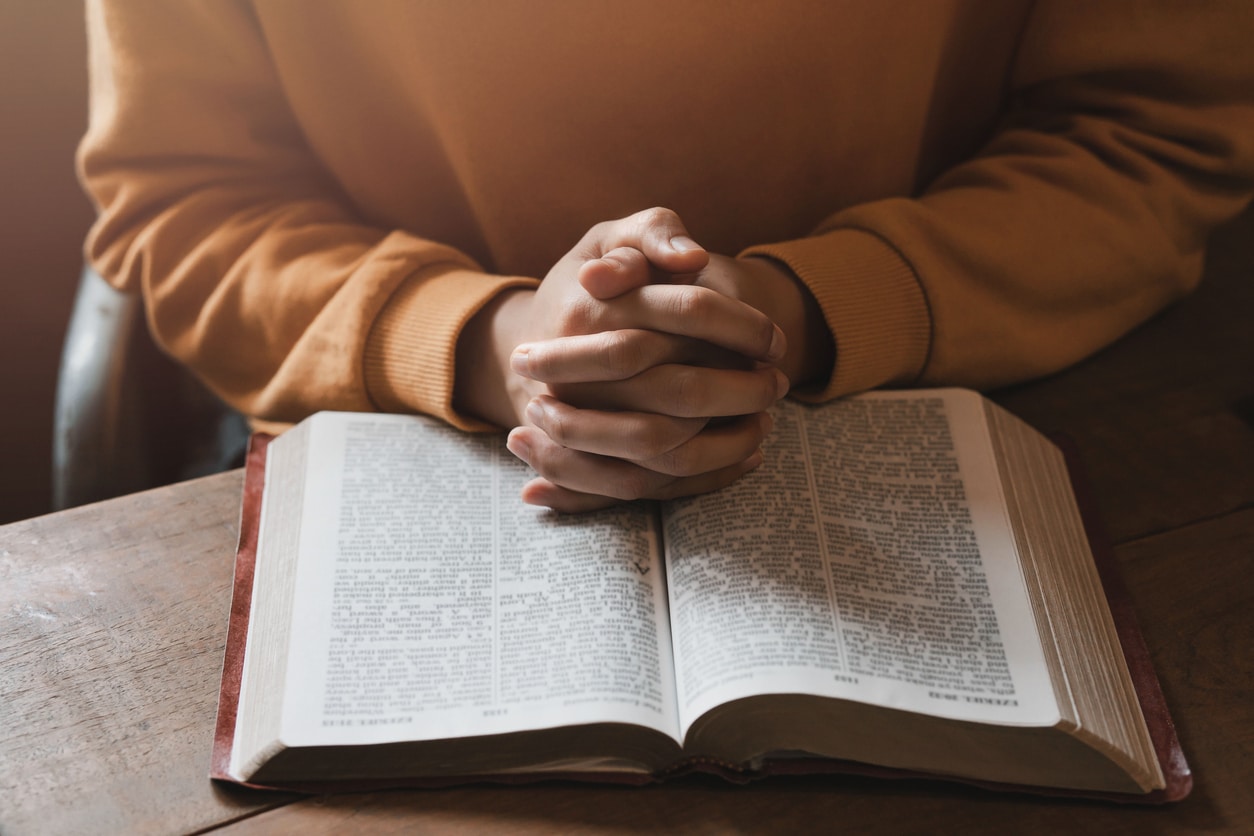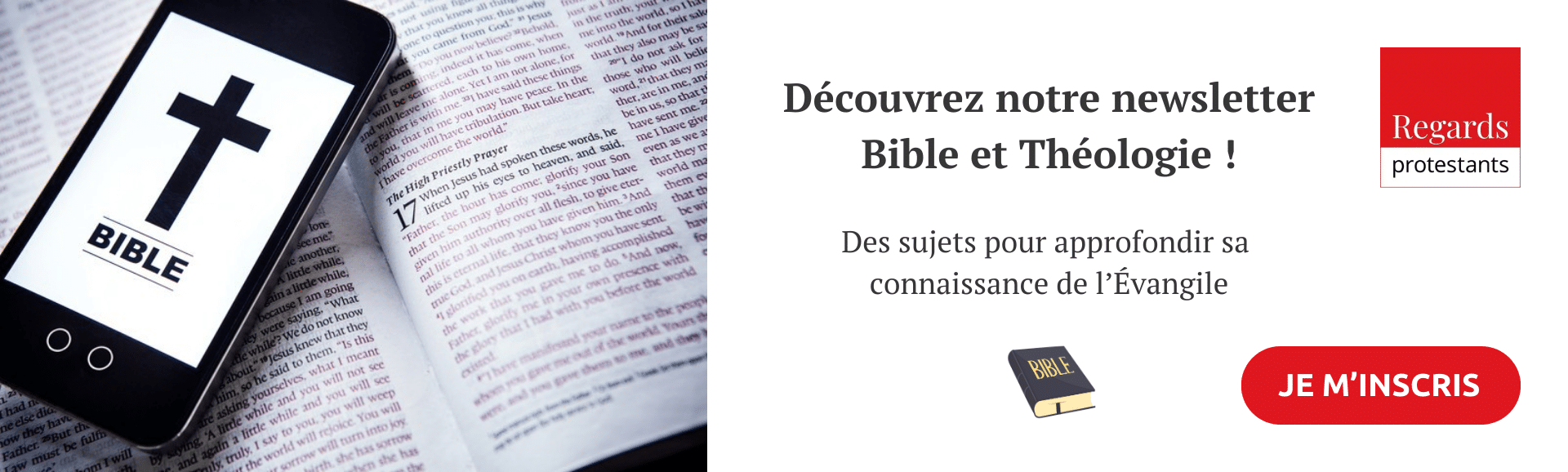Il y a une question qui m’a toujours intrigué. Pourquoi, alors qu’on n’a en soi-même qu’un sens du divin tout à fait imprécis et évanescent, en vient-on à croire à des articles de foi (par exemple « Jésus-Christ est né d’une femme restée vierge », « Le troisième jour après sa mort, il est revenu à la vie », « Jésus est le Fils de Dieu », etc.) tout à fait spécifiques, péremptoires et souvent déconcertants?[1]
D’où la question : Quelle vérité peut-on reconnaître à ces énoncés ?
On peut proposer trois réponses.
• Pour la dogmatique traditionnelle et orthodoxe, qu’elle soit celle du catholicisme, de l’orthodoxie ou du protestantisme, les énoncés religieux du Christianisme sont considérés comme des propositions rendant compte d’une “réalité“ certes surnaturelle, mais néanmoins objective et « ontologique ». Dieu est vraiment et effectivement le créateur de l’univers, Jésus est effectivement ressuscité d’entre les morts, il est vraiment et effectivement l’incarnation de Dieu etc.
• Pour d’autres, en particulier pour les libéraux protestants, il faut considérer ces énoncés comme l’expression symbolique de l’expérience religieuse de ceux qui les confessent. Nous avons en nous-même une religiosité, c’est-à-dire un sentiment religieux naturel et même instinctif, et les articles de foi enseignés par les Eglises en sont l’expression symbolique. Cette religiosité naturelle, c’est, par exemple, le sentiment de l’infini devant la voûte du ciel étoilé, c’est aussi l’expérience du divin, du sacré et du tabou, mais elle peut aussi procéder du sentiment de culpabilité, du besoin d’être secouru, du besoin d’un père idéalisé, d’une angoisse devant la mort etc.
Ce qui incite à critiquer cette manière de voir, c’est le fait que les énoncés du catéchisme et les confessions de foi traditionnelles semblent très éloignés de cette religiosité première.
• Nous défendrons donc une thèse différente[2]. Les énoncés du catéchisme chrétien font partie de notre culture, celle dans laquelle nous avons été éduqués. Le plus souvent nous les adoptons spontanément. Nous les intégrons dans notre manière de penser, de nous exprimer, de nous comporter. Et ce au même titre que d’autres composantes de cette culture, par exemple, la manière de se nourrir, la langue que l’on emploie, les conventions de politesse dont on use, les valeurs républicaines (liberté, égalité fraternité) que l’on nous a inculquées etc.
Les énoncés des confession de foi, ceux du Credo par exemple, constituent un héritage qui se transmet de génération en génération. Pour le fidèle qui les confesse, ces énoncés sont un « déjà là » préconstitué et préétabli depuis des générations.
Ainsi la religion, et en particulier la religion chrétienne, doit être considérée comme l’une des formes, parmi d’autres, de la culture, celle-ci étant définie comme un ensemble de valeurs, de conventions, de manières de penser, de pratiques qui se transmettent et par lesquelles les hommes d’un groupe social donné communiquent et développent des attitudes psychologiques et sociales spécifiques.
C’est donc cette thèse que nous voulons présenter et développer.
Il n’y a pas de foi personnelle
Il est impossible de savoir ce qu’un chrétien « croirait » spontanément, c’est-à-dire indépendamment des croyances culturelles du milieu dans lequel il vit. Sa religiosité propre, naturelle, spontanée a été recouverte par la culture dans laquelle il est immergé. S’il était né ailleurs, s’il avait reçu une éducation différente, il ne serait sans doute pas devenu chrétien. Ainsi, si nous pensons que « Dieu est amour », et à plus forte raison que « Jésus-Christ est le Fils de Dieu », c’est parce que l’Église, nos parents et la culture chrétienne nous l’ont enseigné. En fait, de façon plus générale, “ croire“, c’est toujours adhérer, ou du moins se référer, à des croyances collectives qui avaient déjà cours avant nous et qui appartiennent à la culture du milieu dans lequel nous vivons.
La foi chrétienne n’est pas une croyance individuelle ; c’est une croyance à la fois collective, sociologique et institutionnalisée.
Parmi les croyances collectives, il faut en effet faire la différence entre celles qui se développent d’elles-mêmes et celles qui sont institutionnalisées[3]. Les rumeurs, par exemple, naissent et se développent d’elles-mêmes à l’intérieur d’un groupe social. En revanche, les croyances institutionnalisées se forment sous l’emprise d’un enseignement dispensé par des institutions, par un magistère, une tradition, on pourrait dire aussi une coutume. Le chrétien n’a pas de croyance propre, il n’a pas de foi personnelle. Croire est, pour lui, un acte d’adhésion, d’assentiment, voire d’allégeance qui s’effectue par rapport à un objet extérieur : la religion chrétienne.
On peut comparer la foi du chrétien à un bernard l’hermite. Pour vivre, il faut qu’elle se loge et se moule dans une coquille qu’il n’a nullement formée lui-même. La foi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas d’abord une foi en Dieu ou en Jésus-Christ; elle est d’abord une foi en ce qu’enseigne la culture chrétienne et en particulier l’Eglise. Quand on confesse que « Jésus-Christ est le Fils de Dieu », on croit ce que transmet et professe cette culture.
Combien vaut un billet de banque de 100 euros ?
Si les énoncés de la foi chrétienne (par exemple “Dieu est amour“, “Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts“, “ nos péchés nous sont pardonnés“ etc.) relèvent seulement de la culture chrétienne, de sa tradition et de l’enseignement de l’Eglise, on peut légitimement se poser cette question: expriment-ils une quelconque vérité? Et nous répondrons: Oui, à condition de caractériser ce que l’on appelle « vérité“.
Expliquons-nous.
Les énoncés de la foi chrétienne portent sur des fictions, c’est-à-dire sur des créations langagières n’ayant aucun support ontologique; et néanmoins ces fictions peuvent être considérées comme des vérités.
Explicitons ce paradoxe d’abord par des exemples ne relevant pas de la religion.
Une Institution peut créer et instituer des « fictions » (« fiction » vient du latin impérial fictio, action de façonner) qui sont instituées comme des vérités et des faits. Ainsi, par exemple, le fait que, selon la Déclaration de Droits de l’homme, “les hommes naissent libres et égaux en droit“ est une fiction. Cette égalité entre les hommes est en fait une “création langagière“ qui s’est formulée sous la forme d’une Déclaration. De fait, il serait en effet bien malaisé de vouloir prouver que cet énoncé correspond à une réalité « ontologique ». Et pourtant, aujourd’hui, en France à tout le moins, cette fiction est instituée comme une vérité. Elle devient une vérité par le simple fait qu’elle a été instituée comme telle par la Déclaration des Droits de l’Homme. La vérité de cet énoncé est une vérité culturelle et idiomatique.
Autres exemples. On peut considérer comme une fiction le fait qu’un billet de banque (c’est-à-dire une simple coupure de papier) ait une valeur de cent euro. Et néanmoins, cette fiction est une vérité parce qu’elle a été instituée comme telle par une autorité (en l’occurence la Banque de France) qui est reconnue au sein d’un milieu culturel et sociologique donné. De fait, cette “ coupure“ peut être échangée contre une veste de cette valeur.
De même, Emmanuel Macron est devenu Président de la République par le simple fait qu’il a été institué comme tel, en l’occurence par le Conseil Constitutionnel sanctionnant le résultat d’une élection démocratique.
La valeur d’un billet de banque et le fait que Emmanuel Macron soit Président de la République constituent des « vérités-faits » qui ne tiennent que parce qu’ils ont été institués comme tels. Ces vérités-faits ne se réfèrent à aucun réel ontologique. La valeur ontologique d’un billet de banque est de quelques centimes. Quant à la réalité ontologique d’Emmanuel Macron, elle n’est rien d’autre que celle d’un simple homme de chair et de sang.
De façon plus générale, l’ensemble de la société fonctionne grâce à des faits fictionnels institués comme des vérités. Par exemple, le fait que tel lopin de terre appartienne à Monsieur X est un fait fictionnel institué comme une vérité. Il n’a aucune vérité ontologique; de fait, ce terrain, en lui-même, n’a rien de particulier. Le fait qu’il soit la propriété de Monsieur X est une fiction instituée comme une vérité, cette vérité étant créée et attestée par un acte de propriété notarié auquel il est usuel de faire foi au sein d’une société donnée.
On pourrait multiplier les exemples: le mariage, l’adoption, les frontières d’une nation, les noms des communes, les limites des eaux territoriales d’un pays constituent des fictions et des “créations langagières“ instituées comme des vérités. Ce sont des vérités conventionnelles et des “vérités-faits “ consacrés par l’usage et le plus souvent institués par des autorités reconnues (le Code Civil, le Cadastre, un Tribunal, une Loi etc.). Ou, pour le dire autrement, ce sont des vérités qui deviennent des “faits acquis“.
Pour reprendre l’expression de Bruno Latour[4], on peut qualifier les vérités-faits institués de faits-fétiches et de « faitiches ». Un billet de banque, un acte notarié, une décision de justice constituent des faitiches. Tout comme les fétiches des religions archaïques, ils sont fabriqués par les hommes, ils sont de nature fictionnelle et néanmoins, ils ont un pouvoir et une autorité intrinsèques, ils ont une vérité performative et pratique.
Les énoncés de la foi chrétienne sont à la fois des fictions et des vérités
Tout ceci peut s’appliquer, mutadis mutandis, aux énoncés dogmatiques du Christianisme. Jésus est institué « Fils de Dieu » tout comme Emmanuel Macron est institué « Président de la République ». La Bible est instituée « Parole de Dieu » tout comme une coupure de papier est instituée « billet de 100 euro ». Les pécheurs sont institués « pardonnés par la grâce de Dieu » tout comme les hommes sont institués « libres et égaux en droit ». Ainsi, on peut voir les divers articles du Credo (“le monde a été créé par Dieu“, “Jésus-Christ est le rédempteur“, “il est ressuscité“, etc.) comme autant de fictions instituées comme des vérités et des faits par l’Eglise, la tradition et la culture chrétienne. Il n’est pas plus extravagant de dire qu’un simple homme, Jésus de Nazareth, est le Fils de Dieu que de dire qu’un simple morceau de papier vaut 100€.
Mais bien évidemment, notre lecteur va s’écrier : Holà ! il faut quand même faire la différence ! Le fait que Emmanuel Macron soit Président de la République est un fait réel et une vérité objective . Mais il n’en est pas de même pour le fait que Jésus-Christ soit le Rédempteur de l’humanité, même si l’Église l’a baptisé et institué comme tel. Il ne faut pas tout confondre, dira t’on !
Et on aura bien raison de s’exclamer. Il faut pourtant reconnaître que le processus de fabrication de ces vérités est le même. Ce qui diffère, du moins aujourd’hui, c’est que ces vérités ont des audiences différentes. En principe du moins, tous les Français reconnaissent Emmanuel Macron comme Président de la République. En revanche, les fidèles qui intègrent dans leur psychisme des vérités chrétiennes sont de moins en moins nombreux, et l’autorité de l’Eglise est elle-même de moins en moins reconnue.
Les vérités sont aussi des coutumes et des habitudes
On ne saurait trop insister sur l’importance de la coutume dans le champ du religieux, mais aussi, de façon plus générale, dans celui de tout ce qui est traditionnel d’admettre dans une société donnée.
On hérite d’une tradition qui présente Jésus-Christ comme ressuscité hors de sa tombe de la même manière que l’on hérite de la tradition d’un Saint Louis, sage et pieux, rendant la justice sous un chêne. La première tradition est transmise par la Bible, l’Eglise et la tradition chrétienne, la seconde par le Petit Lavisse et l’Ecole publique. Les deux énoncés sur Jésus-Christ et Saint Louis relèvent d’un même type de vérité. Ils sont vrais si on fait confiance à la tradition et à l’Institution qui nous les a enseignés.
La vérité des énoncés du catéchisme chrétien n’est pas afférente à une croyance, mais bien plutôt à une habitude. Par la force de la coutume et de la tradition, nous nous accommodons même de ce qui est le plus extravagant ; une coupure de papier vaut 100 euro, le prêtre transforme une hostie en « corps du Christ »; à sa mort, la Vierge est montée au ciel etc. Comme le dit Jean de la Fontaine dans la fable Le Chameau et les Bâtons flottants, « L’accoutumance ainsi nous rend tout familier : ce qui nous paraissait terrible et singulier s’apprivoise avec notre vue quand ce vient à la continue »[5] .
Et il me semble que l’Eglise, à tout le moins l’Eglise catholique, reconnaît, du moins implicitement que les vérités qu’elle enseigne sont des fictions et des créations langagières sans vérité historique et ontologique. En effet, les dogmes affirmant l’immaculée conception et l’assomption de la Vierge constituent des vérités dogmatiques instituées seulement en 1854 et 1950. Ces vérités sont manifestement des fictions. De fait, si elles faisaient état de faits biographiques et historiques relatifs à la Marie de l’histoire, elles auraient été reconnues bien avant, dès le premier siècle de notre ère. L’Eglise catholique n’aurait pas laissé mijoter ses fidèles pendant dix-neuf siècles dans l’ignorance, voire dans l’erreur. Ces fictions ont été instituées comme des vérités au nom du respect de la tradition (ces croyances mariologiques avaient cours dans le peuple chrétien depuis de nombreux siècles) et aussi pour des motifs théologiques[6].
Et il me semble que l’on peut également dire que les énoncés “Dieu a créé le ciel et la terre“, “Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts“ ne se réfèrent pas à des faits historiques.
Démystifier la notion de foi
Ainsi, la vérité des énoncés de la foi chrétienne serait du même type que celle conférée à des billets de banque ou à la Déclaration des Droits de l’Homme.
Certes, cela peut paraître tout à fait illégitime. On pense généralement que la vérité des énoncés du Christianisme ne l’est que dans et par la “foi“. Certaines créations fictionnelles et langagières (celles du Droit, de la Justice et des décrets émanant des Institutions civiles) n’auraient pas besoin d’être « crues » pour être reconnues comme vraies; en revanche celles des articles de foi du Christianisme seraient uniquement une affaire de “ foi “.
Mais il faut immédiatement souligner que cette “foi“, bien loin d’être de nature exclusivement religieuse, est, elle aussi, nécessaire pour accréditer la vérité et assurer l’efficacité des billets de banque et, de façon plus générale, de tous les textes institutionnels (Bruno Latour dirait les faitiches) tels que les titres de propriété, de citoyenneté, de mariage etc.
En effet, toute vérité instituée quelle qu’elle soit ne vaut vérité que par la confiance qu’on lui accorde ; elle n’a de crédit et d’efficacité que si on lui fait foi. On peut certes dire que cette confiance relève d’un « acte de foi », mais, en fait, il vaut mieux dire qu’il relève de l’habitude. En fait, la vérité du fait qu’un billet de 100 euro vaut 100 euro doit être considérée comme une “vérité coutumière“[7].
Nous entrons spontanément dans le jeu de ces « faitiches » socioculturels, non pas par une démarche de foi explicite, mais tout simplement par habitude et parce que c’est l’usage. Bourdieu[8] parle d’un phénomène d’illusio (étymologiquement, “entrée dans le jeu de“); nous entrons spontanément et par l’effet de l’habitude dans le “jeu“ des vérités d’usage ; et cette habitude est en fait un « assujettissement spontané » pour reprendre en la déformant l’expression de La Boétie.
La foi, une affaire d’habitude
De fait, Wittgenstein, dans son ouvrage De la certitude[9] dit que nos certitudes ne sont pas de nature intellectuelle, mais ressemblent plutôt à des attitudes ou façons d’agir qui sont de l’ordre du réflexe naturel, d’une saisie immédiate non réfléchie[10]. La Scholastique dirait que la vérité de ces dires socio-culturels, qu’ils soient ou non de nature religieuse, leur est conférée par une fides implicita.
Il faut donc démystifier la notion de foi. Le Christianisme en a abusivement fait le socle unique du crédit accordé par les fidèles à ses énoncés et à la « vérité » qui leur est conférée. En fait, « L’essence de la croyance réside dans l’instauration d’une habitude »[11].
Le Credo peut être vu comme un ensemble des dictons culturels et traditionnels ou encore de « slogans[12] ». Pas plus qu’un cri, les slogans n’ont de vérité descriptive ; en revanche, ils ont une force pragmatique (ils soudent et mobilisent une communauté).
On peut également voir le Credo comme un hymne, l’hymne du Christianisme, au même titre que la Marseillaise est l’hymne national de la France. Pas plus que les paroles de la Marseillaise, les articles que décline le Credo ne doivent être considérés comme l’expression de croyances, et encore moins comme le descriptif de faits historiques. Le fait de confesser le Credo doit être considéré comme une posture, la posture de se manifester comme chrétien.
Quoi qu’il en soit, les articles de foi du Credo et du catéchisme de l’Eglise ont seulement ce que l’on pourrait appeler une valeur d’usage. Ils restent vrais tant que c’est l’usage de les considérer comme vrais.
Certes, de la même manière que l’on peut mettre en cause bien des conventions culturelles, on peut en venir à douter de ce que transmet le Christianisme, mais c’est toujours après coup. Comme le dit Wittgenstein, « L’enfant apprend en croyant l’adulte. Le doute vient après la croyance. J’ai appris une masse de choses, je les ai admises par confiance en l’autorité d’êtres humains, puis au cours de mon expérience personnelle, nombre d’entre elles se sont trouvées confirmées ou infirmées »[13].
Tant qu’ils ne sont pas remis en cause, les énoncés dogmatiques, traditionnels et culturels relèvent de ce que Bourdieu appelle un habitus. Ils sont admis par un groupe social par une forme de croyance collective. Ils font l’objet d’une acceptation tacite partagée[14].
Ce dont on fait l’expérience devient une vérité
Les énoncés catéchétiques du Christianisme ont donc une vérité que nous qualifions de coutumière. Mais on peut aussi leur reconnaître une vérité parce qu’ils induisent dans la vie de ceux qui les professent des effets tout à fait réels et objectifs. Ils induisent ce que Wittgenstein et Lindbeck appellent des « formes de vie » spécifiques; ils ont des effets réels et pratiques dans les comportements collectifs et individuels . Et c’est à ce titre qu’on peut leur reconnaître une vérité.
Albert Camus disait que les mythes (le mythe de Prométhée ou de Sisyphe, par exemple) deviennent vrais lorsque nous les incarnons. De la même manière, les énoncés du Christianisme peuvent être considérés comme vrais lorsque l’on fait l’expérience de leur vérité. Leur vérité leur vient de ce qu’il est nécessaire de la leur reconnaître pour rendre compte de l’expérience que l’on en a.
On peut donner des exemples.
L’énoncé “ Dieu est amour“ devient une vérité lorsqu’il suscite chez le fidèle une forme de vie cohérente avec ce qu’il énonce, c’est-à-dire lorsqu’il se sent aimé, pardonné, compris. Le fait qu’il fasse l’expérience que “Dieu est amour“ confère une vérité à cet énoncé.
Autre exemple. Certains mystiques, Marthe Robin par exemple, peuvent se nourrir seulement d’hosties consacrées reçues comme Corps du Christ et Pain de vie. Et pour beaucoup de chrétiens, l’eucharistie est une forme de viatique qui leur apporte effectivement secours, soutien, consolation. C’est pourquoi il n’est nullement abusif de dire que, du moins dans le milieu chrétien, c’est une vérité que le Christ est une puissance de vie.
Autre exemple. L’interdiction de manger du porc a été instituée dans le Judaïsme et l’Islam et on peut considérer qu’elle n’a aucun fondement objectif. Elle produit néanmoins des effets dans le champ de l’expérience effective ; un homme de culture juive ou musulmane qui découvre qu’il a mangé du porc à son insu devient souvent physiquement malade[15]. Ainsi, on peut dire que dans le monde juif et dans le monde musulman, le fait que le porc soit un animal impur, tabou et néfaste est bien une vérité. On infère le fait que c’est une vérité à partir de l’expérience que l’on en a faite.
Convenons-en, on est en droit de discuter de cette manière de concevoir la vérité. Elle consiste à dire : c’est vrai parce que j’en fais l’expérience et parce que c’est intégré en moi en tant que tel. Mais, à y réfléchir, y a-t-il d’autres formes de vérité que celle-là[16] ? On pourrait être tenté de dire qu’il n’y a de vérités que subjectives. Mais, dans un milieu culturel donné, elles n’en prennent pas moins un caractère objectif.
Ainsi à la question « Les énoncés dogmatiques du Christianisme ont-ils une vérité ? », nous osons répondre « oui ». La vérité des doctrines est dans le fait qu’elles ont une valeur active et qu’elles produisent des faits tout à fait effectifs et réels. C’est d’ailleurs là la conception de la vérité de William James[17], de Pierce[18] et, plus généralement, de la philosophie pragmatiste. La vérité, c’est ce qui marche et aussi ce qui fait marcher (ce qui fait avancer ) quand bien même ce serait en nous trompant et en nous « faisant marcher » ( dans le sens de l’expression populaire « Je te fais marcher »). Le fait qu’une simple coupure de papier vaille 100 euros est une vérité parce que c’est vrai qu’on peut l’échanger contre une veste. C’est vrai parce que “ça marche“, ou plutôt “tant que ça marche“[19]. Le fait que Jésus-Christ est le Seigneur est une vérité parce que c’est vrai qu’il exerce effectivement une emprise (une seigneurie) sur le comportement, la mentalité et les convictions de bien des chrétiens. C’est une vérité parce que “ça marche“, ou plutôt “tant que ça marche“.
Conclusion
A la question: Peut-on reconnaître une vérité aux articles de foi du Christianisme, nous avons répondu Oui. Ils ont une vérité instituée, une vérité coutumière et une vérité pragmatique.
Mais la question de la vérité des énoncés de la foi peut aussi être abordée d’une autre manière, plus anthropologique et même psychologique. De fait, quitte à paraître impertinent, on peut se demander: Croit-on vraiment ce que l’on confesse ? Conférons-nous une réelle vérité aux articles de foi que nous confessons ? Pourquoi en venons-nous à confesser des articles de foi si surprenants, voire si incroyables. Il nous faudra revenir sur ces questions.
[1] Cet article est le résumé du chapitre III du notre livre Christianisme et besoin de dogmatisme, une analyse critique, Préface de Sophie de Mijolla-mellor L’Age d’Homme 2015
[2] C’est celle que propose George Lindbeck dans La nature des doctrines, religion et théologie à l’âge du post-libéralisme, Paris, Van Dieren 2002.
[3] Nous reprenons ici l’expression de Paul Sanchez in Les croyances collectives, Que sais-je ? PUF 2009, p.22-23.
[4] Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches, Les empêcheurs de penser en rond- La Découverte, 2009.
[5] La Fontaine, Fables, Le Figaro et Éditions Garnier, 2009, p. 164.
[6] C’est parce que Marie avait porté et engendré le Christ, Fils de Dieu, qu’elle ne pouvait ni avoir été infectée par le péché originel, ni disparaître dans la décrépitude de la mort.
[7] De façon plus générale, les mots et les énoncés linguistiques quels qu’ils soient n’ont de vérité que par la force de l’habitude et par la foi, le plus souvent implicite, qu’on leur accorde. En effet, tout comme un billet de banque, les mots n’ont qu’une valeur « fiduciaire », conventionnelle et fondée sur la confiance (« fiduciaire » vient du latin fiducia, confiance). Ainsi rien ne peut prouver ni même expliquer que le mot « cheval » corresponde à un cheval réel. Il ne s’agit là que d’une convention ayant valeur de code qui ne joue que si l’on a confiance en ce code qui nous fait « échanger » un mot contre une chose. Le mot « cheval » pourrait désigner tout autre chose qu’un animal-cheval. D’ailleurs, lorsque je dis à mon fils « Tu es un gros cochon », ce mot ne désigne pas un animal-cochon ! La correspondance et la corrélation entre le signifiant et le signifié ne s’établit que sur un mode fiduciaire ; elle relève d’une habitude et d’une convention sociale. C’est par habitude que, dans un contexte donné, je crois et je sais que le mot « cheval » correspond à un cheval-animal. Les mots sont comme du papier-monnaie. Ils ne correspondent à quelque chose de réel et de vrai que si nous le croyons par l’effet de la coutume.
[8] Pierre Bourdieu, Choses dites, Minuit 1987, p.185-202.
[9] L. Wittgenstein, De la certitude, Gallimard NRF 2006.
[10] Cf. Danièle Moyal-Sharrock, dans sa préface à L. Wittgenstein, op. cit. p. 7-13.
[11] John Murphy, Pragmatism : from Peirce to Davidson, cité par Jean-Pierre Cometti, Qu’est ce que le pragmatisme ?, Folio Essais 2010, p. 64.
[12] Slogan : mot écossais de racine gaélique désignant le gairm (cri) d’un sluagh (clan).
[13] Wittgenstein, op. cit. Par. 160 et 161.
[14] John R. Searle, L’intentionalité, Essai de philosophie des états mentaux, Minuit 1985, p. 183.
[15] Et il devient malade quand bien même il est totalement athée et ne considère nullement le porc comme un animal impur. Ce qui montre bien que c’est l’Islam en tant que culture et non en tant que conviction religieuse qui produit les effets.
[16] Si je dis “En vérité cette fleur est rose“, n’est-ce pas parce que pour mon cerveau et ma manière de voir, elle est rose? Et pourtant je pourrais affirmer que, objectivement et même ontologiquement, cette fleur est rose.
[17] W. James, L’idée de vérité, Félix Alcan, 1913 et La volonté de croire, 1916 et 2005, réédition par Les Empêcheurs de penser en rond.
[18] C.S. Pierce, Œuvres philosophiques I (2002) II (2003) III (2006).
[19] Donnons un exemple : un faux billet de banque est vrai tant qu’il rend possible des transactions, mais un vrai billet est faux si, du fait, par exemple, de dévaluations incontrôlables, on cesse de lui faire confiance. Autrement dit, la conception pragmatique de la vérité est conforme à l’adage de Jésus-Christ : « Il faut juger l’arbre à ses fruits » (Mat. 7,16).