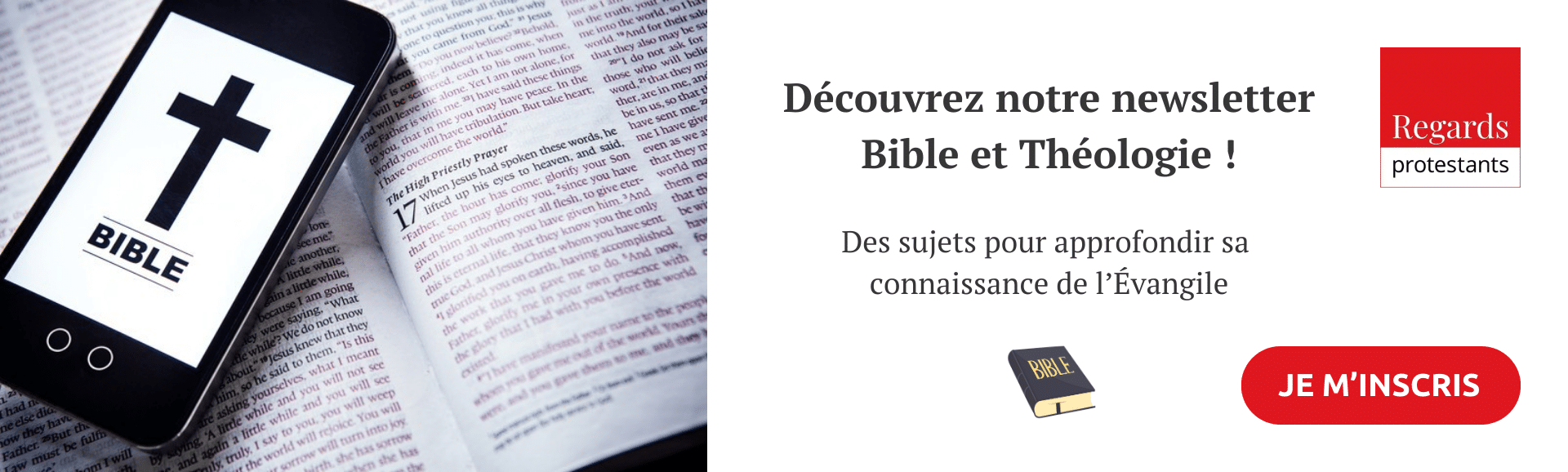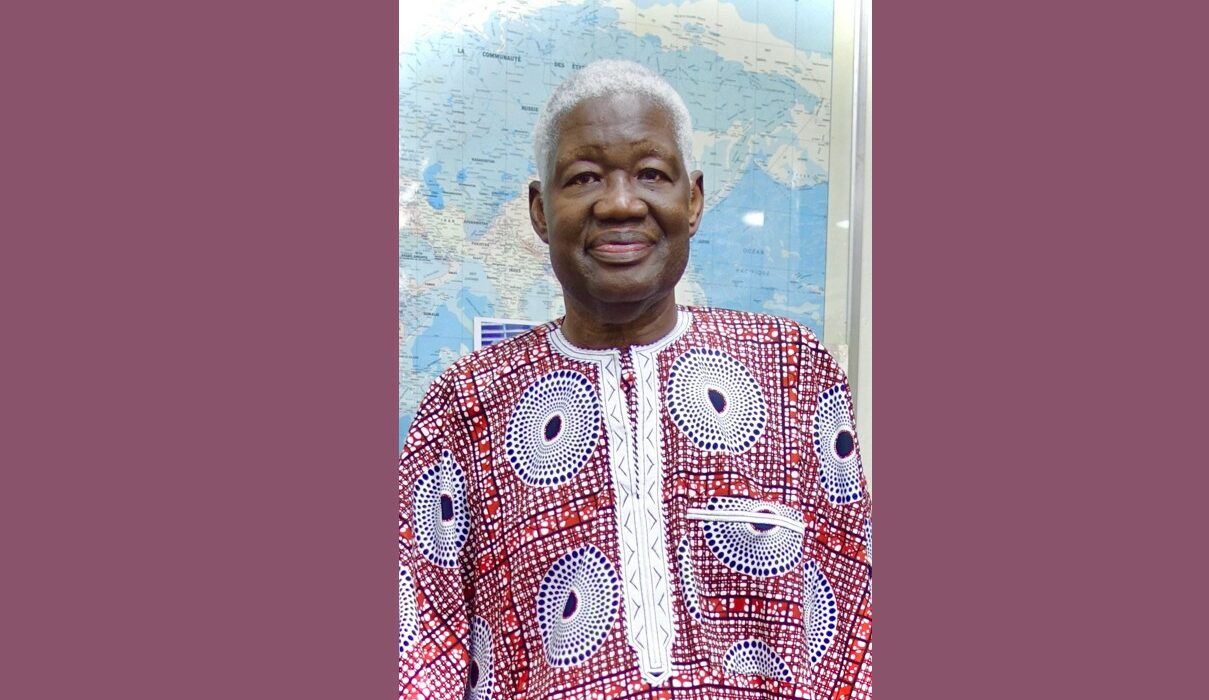Je voudrais partager quelques réflexions sur un concept dont on entend de plus en plus parler, d’une discipline qui, dans certains lieux de formation théologique, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, fait même l’objet de chaires clairement identifiées : la théologie interculturelle. Disons-le d’emblée, pour moi, cette discipline est encore loin d’être claire, en particulier dans sa relation avec la missiologie, j’aurais l’occasion d’y revenir dans ma conclusion. Essayons toutefois de déblayer un peu le terrain et d’examiner ce que l’on peut comprendre par théologie interculturelle.
Pourquoi l’apparition de cette discipline maintenant ?
On voit bien apparaître dans le terme théologie interculturelle, le mot culture avec également la notion d’interaction entre des cultures pensées au pluriel.
Ce premier point est important parce qu’il nous permet de nous démarquer d’un modèle de théologie que l’on connaissait déjà, celui par exemple, au 20e siècle avec Paul Tillich, d’une théologie de la culture. Tillich, qui lui-même évoluait entre deux cultures, allemande et américaine, et avait mis en avant la notion de frontières ou confins, tentait bien de penser le religieux dans la culture, mais on pourrait lui reprocher de rester dans un schéma du siècle précédent, considérant cette dernière, la culture, donc, comme une entité un peu abstraite et bourgeoise.
Par opposition à une conception totale de la culture qu’il faudrait penser théologiquement, le préfixe inter de théologie interculturelle laisse supposer un processus dialectique ou relationnel entre des cultures, une théologie aux prises avec la question des interrelations ou des interactions, ce qui pose concrètement […]