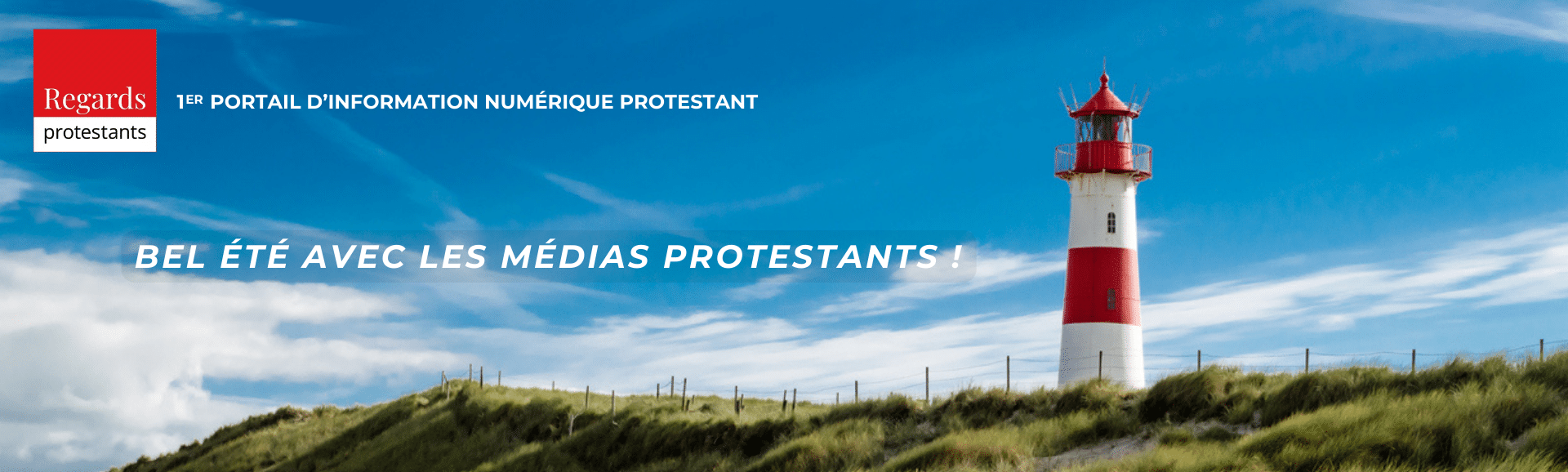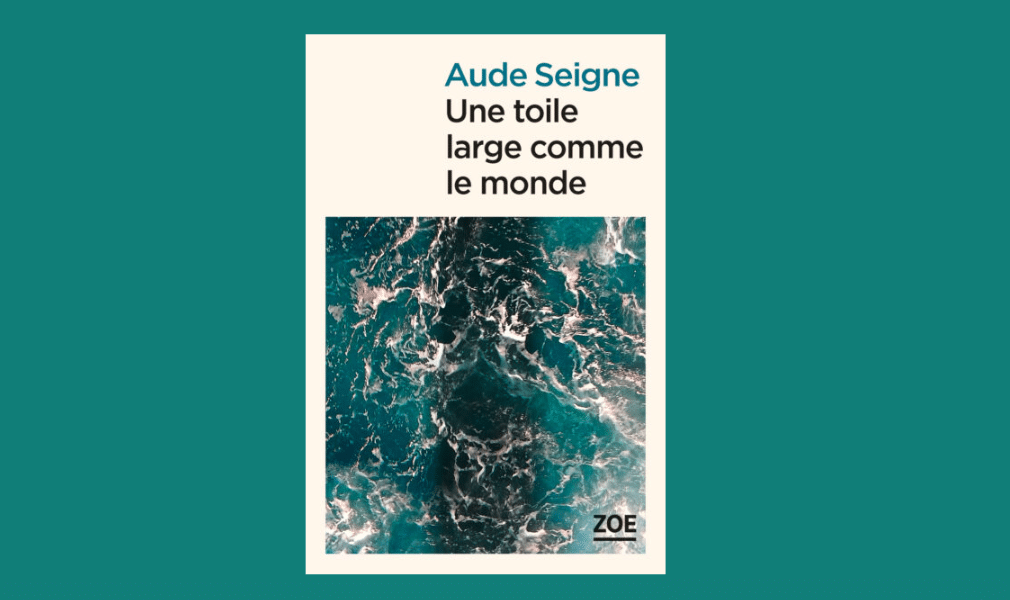Dans les débats actuels sur l’accompagnement de la fin de vie, en tentant de relier des faits et des jugements moraux, sans analyse ni discernement, de nombreuses prises de position apparaissent biaisées dès leur énoncé. Parler par exemple de « suicide assisté », de « liberté de mourir » ou de « mort dans la dignité » juxtapose une réalité physique et une thèse morale, la thèse justifiant le fait alors même qu’ils ne sont pas de même nature.
De quoi est-il question ?
Du moment même où il en a pris conscience, la mort l’être humain a toujours fasciné, au point que la première histoire racontée dans la Genèse au jardin d’Éden aboutit au fait que l’homme se rende compte qu’il est mortel. À ce titre, la mort ne fait pas partie de la vie mais en est l’interruption. Elle n’est pas une étape de transformation dans une éternité. La notion de vie éternelle peut intervenir, notamment dans la foi chrétienne, mais elle est toujours de la liberté et de l’initiative de Dieu seul ; Jésus lui-même ne se ressuscite pas, mais il est ressuscité.
Les religions ont parfois accordé à la vie un caractère sacré. Là encore il faudrait discerner la vie automatique et le souffle de vie, à l’image d’Adam formé en deux temps de la poussière puis du souffle insufflé dans ses narines. Accorder à la vie matérielle un caractère sacré, donc lié à Dieu, est un point de vue. On peut aussi faire correspondre la capacité de relation à Dieu avec le second temps de la création, c’est-à-dire le souffle, la conscience spirituelle, ce qui est un autre point de vue. La distinction entre les deux est essentielle au moment de parler de fin de vie, volontaire ou non.
Où se situe la dignité ?
La liberté de mourir ou le fait de vouloir rester digne relève d’une tout autre question. Il s’agit là du champ éthique de la perception que l’être humain a de lui-même. La dignité est une question de regard personnel dans un contexte social et culturel précis. La liberté s’inscrit dans le champ des relations sociales et le rapport à autrui.
Ces deux notions humanistes relèvent de la vie sociale, qui n’est plus réellement la question à l’approche de la fin ultime. En parler à propos de la mort dit souvent plus sur la peur de mourir que sur la mort elle-même. À titre d’exemple, je ne connais aucune personne en situation de fin de vie ou de soins palliatifs qui, demandant ardemment que ses souffrances soient abrégées et que la mort intervienne, que ce soit lors de son entrée à l’hôpital où à son domicile, ait été portée et accompagnée et maintienne au bout de quelques jours sa demande.
Favoriser l’accompagnement
Sans doute y a-t-il des situations personnelles de grande détresse, et l’on pourrait citer des maladies invalidantes où la conscience demeure, comme la maladie de Charcot. Mais d’une manière générale, prendre en compte la peur et son expression dans un champ social ou personnel n’est pas de même nature qu’un acte médical d’arrêt ou non de la vie. Et si des situations limites existent bien, l’exception ne justifie pas la loi.
Les directives anticipées qui permettent de donner son avis sur la vie et la mort sont, elles, des indications importantes pour réguler l’acte médical lié à la fin de la vie. Le débat sur la fin de vie gagnerait donc beaucoup à se concentrer sur les moyens d’accompagnement que l’État ou les associations mettent en œuvre pour que les personnes en souffrance soient dignement prises en compte. La grandeur d’un État est de savoir accompagner les vivants.