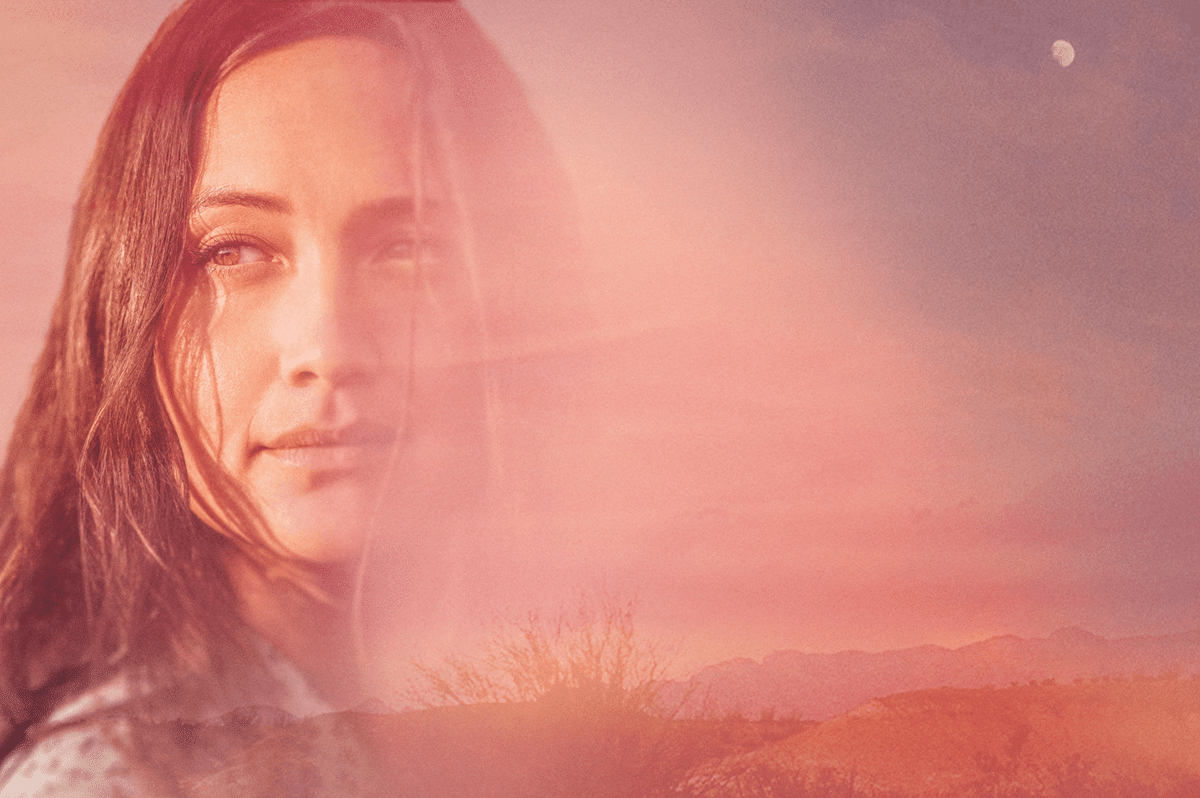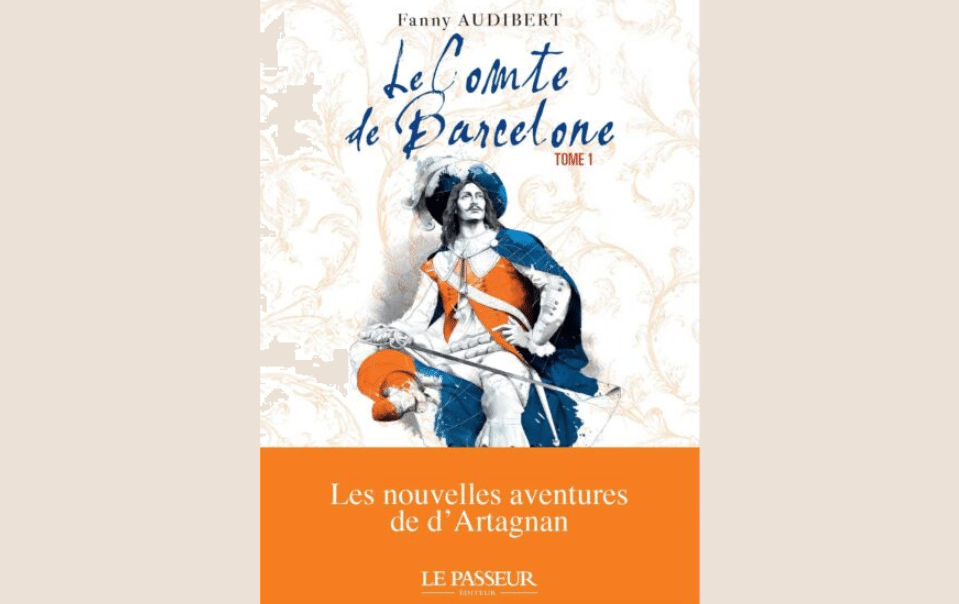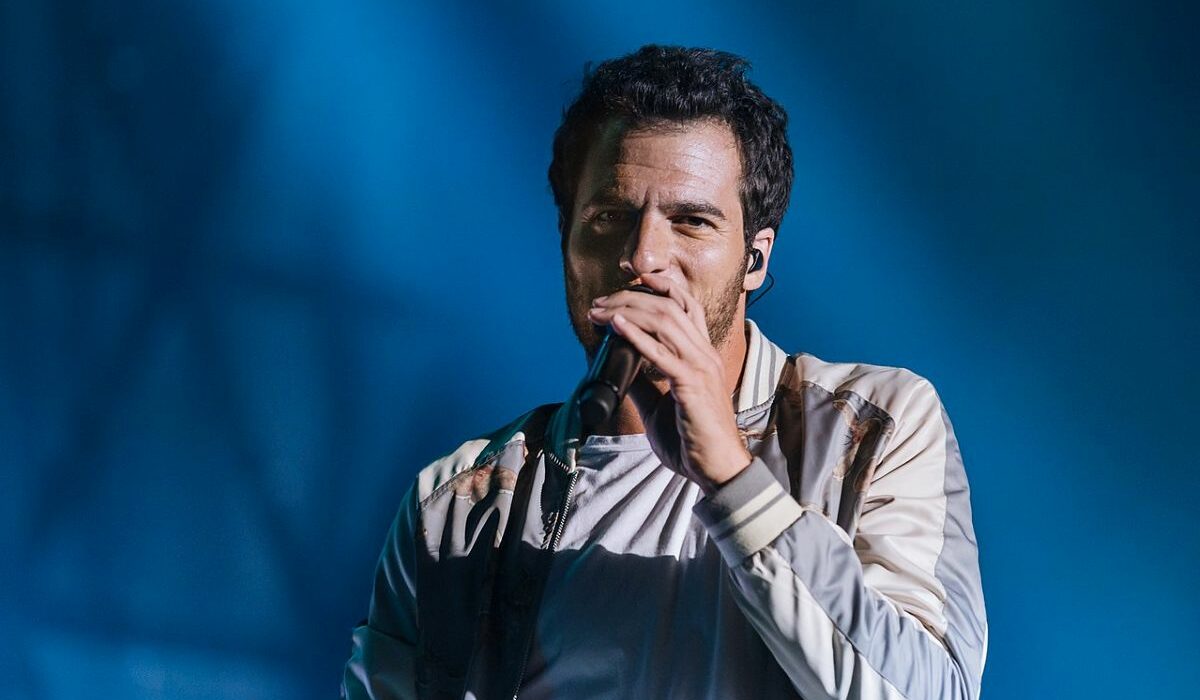6 avril 1917, la Première Guerre mondiale fait rage sur le front ouest. Will Schofield et Tom Blake, deux jeunes caporaux britanniques, sont chargés d’une mission vraisemblablement impossible. Les lignes de communication étant coupées, ils vont devoir traverser seuls le no man’s land et les lignes ennemies pour délivrer un message aux environs d’Écoust-Saint-Mein. Ce message doit permettre de sauver 1 600 soldats britanniques, parmi lesquels se trouve le frère de Blake, qui vont tomber dans un piège tendu par l’armée allemande.
Dès le début, le film est en mouvement, poursuivant un récit linéaire, suivant sans relâche nos héros dans leur course contre la montre, bien que le pays soit déchiré par la guerre. Pour nous faire entrer dans leur voyage de la manière la plus immersive possible, tout est filmé d’un seul point de vue, une seule caméra (ou du moins c’est ce qui parait) suivant Blake et Schofield de près tout le temps comme un tiers invisible du voyage : parfois en reculant devant eux alors qu’ils se précipitent dans une tranchée, parfois en les suivant intimement de derrière, parfois en les suivant à côté – en regardant seulement occasionnellement autour pour nous montrer ce qu’ils voient. C’était le même procédé qu’avait utilisé auparavant avec tant d’efficacité pour filmer l’horreur d’Auschwitz, le réalisateur László Nemes, dans Son Of Saul. Pas non plus de coupes ou de montages apparents, de sorte que tout semble être une longue prise, un quasi unique plan séquence… nous faisant progresser dans le présent continu, ininterrompu, sauf pour un seul black-out.
En fait, dans la réalité, le tournage (en grande partie sur la plaine de Salisbury et dans d’autres lieux britanniques, complété par les décors des studios Shepperton) a duré 65 jours en prises de sept ou huit minutes, assemblées ensuite de manière quasi invisible par le directeur de la photographie Roger Deakins et le monteur Lee Smith. Un procédé particulièrement adapté à une histoire comme celle-ci, une simple course contre la mort et pour espérer, afin d’atteindre un objectif avant qu’il ne soit trop tard. L’exploit technique présenté est exaltant ; la mise en scène du film par le réalisateur Sam Mendes est magistrale tout au long du film.
Comme spectateur, il est paradoxal de sentir parfois une sorte de besoin de transition, une aspiration à la ponctuation – au montage, en fait. Ce flux d’événements est comme un flux de prose sans points, paragraphes ou chapitres. Tout ce qui se passe au cours de leur voyage n’a pas le même intérêt, mais il est de durée égale. Et le sentiment d’asphyxie peut parfois se faire sentir… mais cette sensation est bénéfique et nous plonge un peu plus dans l’enfer de la situation. Les poils se dressent alors inévitablement, et les yeux s’humidifient quand résonne dans la forêt Wayfaring Stranger chanté au milieu des soldats, comme une pause bienfaisante, le pas se ralentissant et le rythme cardiaque par là-même aussi.
Et puis il y a cette caméra étonnamment et brillamment active et curieuse, qui suit le rythme de ces événements. Lorsque Blake et Schofield se frayent péniblement un chemin à travers les barricades de barbelés, la caméra les suit mystérieusement sans obstacle et on ne peut s’empêcher de se demander comment ? Lorsque Schofield est transporté impuissant dans les eaux d’une rivière agitée, la caméra est en quelque sorte juste à côté de lui, se précipitant elle aussi dans le courant, mais sans même être éclaboussée. Coup de chapeau ici forcément à Roger Deakins, le légendaire directeur de la photographie qui a été rendu célèbre pour ses 13 nominations aux Oscars avant de finalement en gagner un à sa 14ème. Non seulement Deakins et son équipe font bouger la caméra avec grâce, mais ils réussissent à capturer de magnifiques plans. Un glissement au-dessus d’un cratère rempli d’eau dans le No Man’s Land, une ville bombardée, une rencontre fortuite à la lumière d’une bougie – tout cela a l’air de peintures, de véritables œuvres d’art rendues d’autant plus impressionnantes que les conditions sont difficiles.
Il y a dans 1917 un savoureux mélange de Il faut sauver le soldat Ryan et de Gravity – avec la véracité et l’honnêteté immersives du premier, mélangées à l’intensité implacable du second. Il suffit alors pour le spectateur de s’accrocher et de serrer les dents, et de se demander comment quelqu’un a pu survivre à cette horreur. Le film est franchement palpitant et la reconstitution du champ de bataille spectaculaire. Dans l’ensemble, les aspects de poursuite et de mission de ce film le rendent beaucoup plus mouvementé que ce à quoi nous sommes habitués dans les films se déroulant dans les tranchées statiques de la Première Guerre mondiale – Sam Mendes expliquant que cette mobilité était précisément ce qui l’a attiré vers l’histoire de cette transmission d’un message à travers les lignes.
1917 se positionne pour moi comme l’un des meilleurs films de guerre, capturant l’ampleur et l’horreur de son cadre à travers son objectif épique tout en se concentrant sur l’impact humain et émotionnel du conflit. Une fantastique mise en scène de Mendes, une solide performance du sous-estimé George Mackay, une excellente attention aux détails d’époque dans les décors et les costumes, et le génie de Deakins et du compositeur Thomas Newman pour parachever l’ensemble… juste parfait !