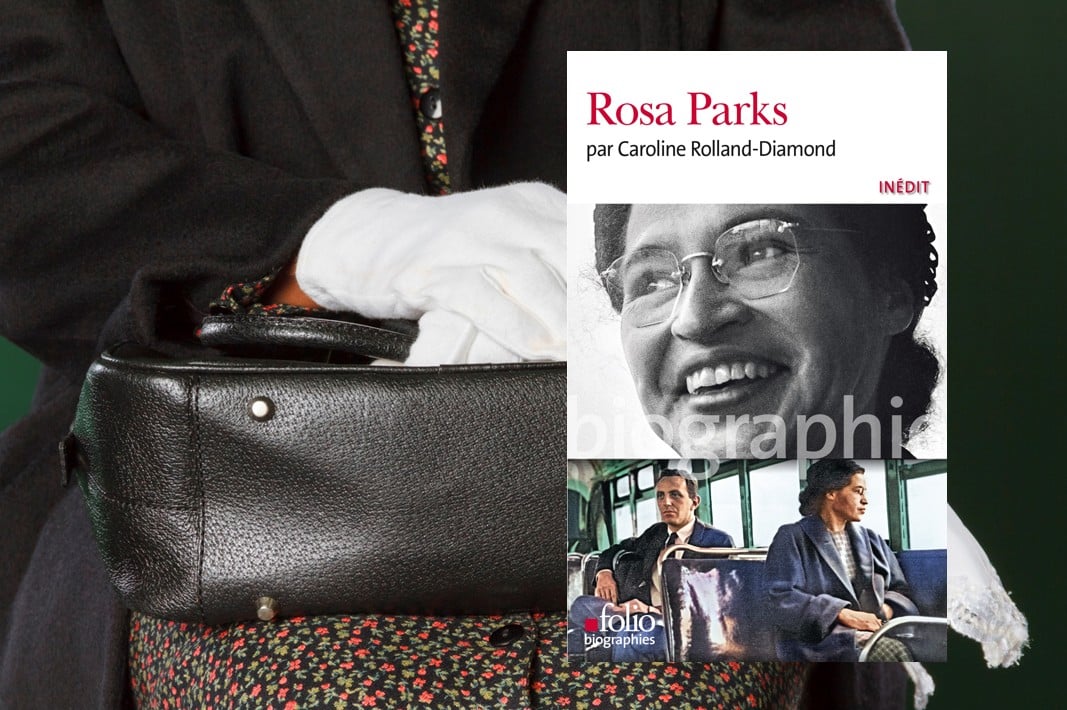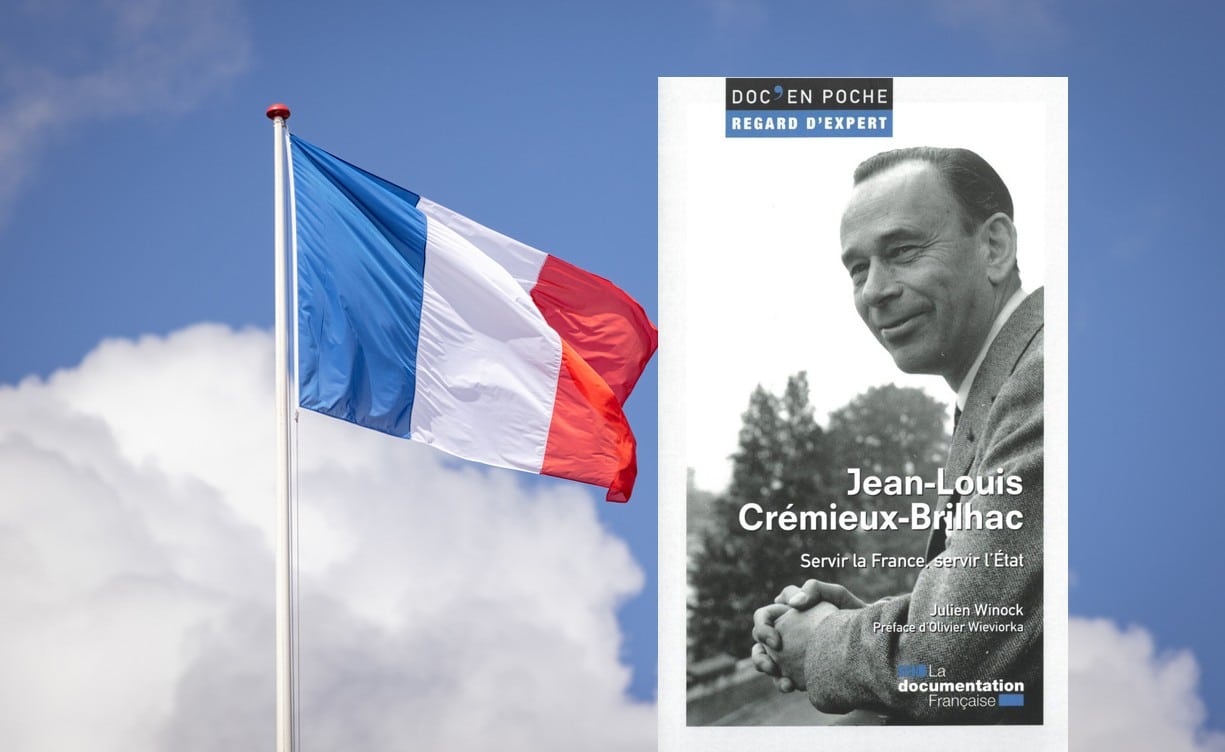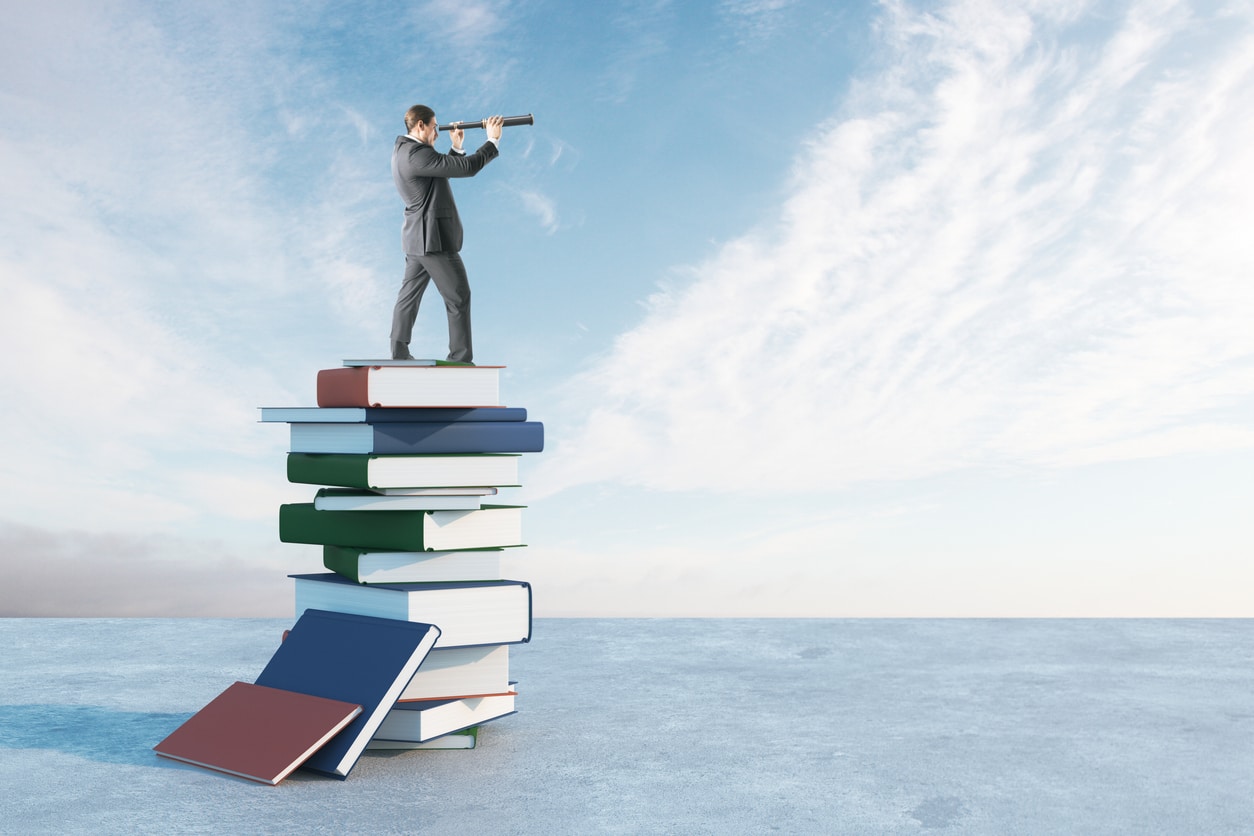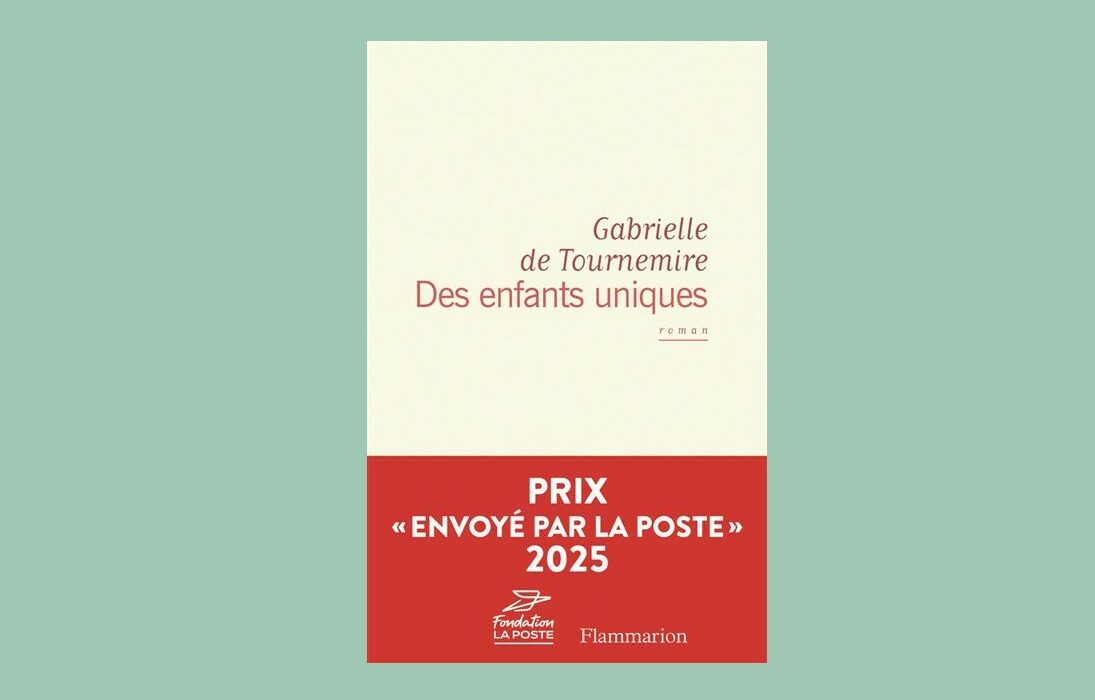Que l’on prononce devant vous le nom d’Anne d’Autriche (1601-1666) aussitôt vous cherchez les ferrets, poursuivez Milady, Buckingham et consorts, attentifs à préserver l’honneur d’une reine qui ne tient que par un fil, celui de l’épée de nos trois mousquetaires. Mais la vraie, la vraie de vraie, cette Anne d’Autriche au sujet de laquelle manquent tant de sources, la connaissez-vous ? Camelot de bazar, nous pourrions vous faire et vous écrire l’article tout à la fois, vous dire que la biographie que Joël Cornette publie ces jours-ci chez Gallimard est excellente, passionnante, foisonnante. Et nous aurions bien raison. Mais ce serait incomplet. Car ce livre, au-delà de son élégance et de son classicisme, offre une interrogation sur la place des femmes en politique.
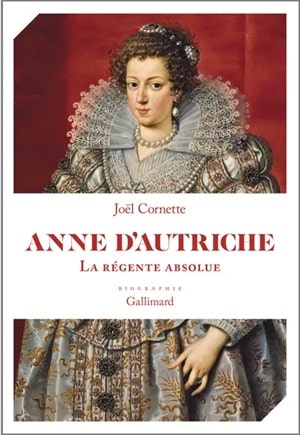
« Anne d’Autriche est la dernière femme à avoir exercé le pouvoir à un tel niveau, remarque pour commencer Joël Cornette. On pourrait, bien entendu, citer mesdames Borne et Cresson, qui dirigèrent des gouvernements ; mais toutes les deux dépendaient de la tutelle d’un Président, devaient compter avec des contre-pouvoirs, bref, ne disposaient pas de leviers considérables. Tout au contraire, Anne d’Autriche, durant la minorité de son fils, a détenu les pouvoirs d’une régente absolue. »
Quelle destinée !
Fille aînée de Philippe III, roi d’Espagne, elle devint l’épouse de Louis XIII à la faveur d’un calcul politique des plus malins, son père espérant qu’elle dévoilerait tout ce qui se trame chez son ennemi le plus déterminé. Ce qu’il advint ? Délaissée par son époux qui préférait la chasse et les favoris, considérée comme une espionne par le cardinal de Richelieu, la reine rongea son frein, cultivant l’entre-soi dans une cour hostile. Mais tout a une fin. La mort de l’Homme rouge en 1642, celle de Louis XIII en 1643, lui permirent de révéler des qualités que nul, à part ses proches amies, ne pouvait lui soupçonner.
« Devenue régente en attendant la majorité de Louis XIV, Anne d’Autriche, qui pourtant détestait Richelieu a poursuivi sa politique et fait la guerre à ses deux frères cadets, qu’elle aimait pourtant passionnément, dont elle se considérait un peu comme la seconde maman, et qui étaient devenus roi d’Espagne et gouverneur des Pays-Bas, remarque Joël Cornette. Cette révolution mentale démontre à tous ceux qui la dénigrent – à commencer par ses contemporains, mais encore par bien des historiens du XIXe et du XXe siècle – que cette femme disposait d’un caractère supérieur. »
S’impliquer dans la politique
La Fronde évidemment l’a contrainte à s’impliquer dans la bataille politique. Période extrêmement complexe qui s’est déroulée pour l’essentiel de 1648 à 1653, durant laquelle parlementaires et nobles ont contesté l’absolutisme en devenir, elle a cimenté les relations de confiance, déjà très fortes, entre trois protagonistes de l’Histoire : Anne d’Autriche, Louis XIV encore mineur et le cardinal Mazarin, parrain du jeune roi. « La Fronde est un peu la boîte noire de l’histoire de France, un moment extraordinaire où tous les possibles étaient en jeu, souligne encore Joël Cornette. Une politique contractuelle aurait pu voir le jour, la société, partie prenante de l’action publique par le biais des aristocrates, participant au conseil du roi, des Etats Généraux proposant des réformes, des Parlements voulant imposer un contrôle de la monarchie, le démantèlement de l’Etat Richelieu. »
Former le jeune Louis XIV
Par souci de transmettre à son fils la totalité de ses pouvoirs, Anne d’Autriche a choisi de défendre l’absolutisme. « Elle a fait fructifier l’héritage, admet son biographe. Que se serait-il passé si elle avait eu deux filles ? Il n’est pas interdit d’imaginer qu’elle aurait abordé la question d’une façon différente. En 1650, elle s’est déplacée dans le royaume pendant huit mois, pour vaincre la dissidence de la Normandie, la Bourgogne et la Guyenne, en compagnie de Louis XIV. Indéniablement, ce voyage initiatique a servi d’éducation politique, une école à ciel ouvert pour le souverain. »
La reine était loin d’être la seule femme à pratiquer l’art de la politique. Pendant la Fronde, jamais peut-être les femmes n’ont été si près d’obtenir une reconnaissance de leur droit et de leur pouvoir.
Un modèle pour d’autres femmes
« J’ai voulu restituer l’originalité des années 1640-1660, déclare Joël Cornette ; les femmes tiennent un vrai rôle, au tout premier plan politique : il suffit de citer la duchesse de Longueville, la Grande mademoiselle – qui fit tirer à coup de canons sur les armées royales depuis les tours de la Bastille – pour en prendre conscience. Le fait que Molière se soit moqué d’elles dans Les Précieuses ridicules montre qu’elles secouaient le joug d’une société masculine arcboutée sur ses prérogatives. »
Une fois la contestation passée, certaines d’entre elles se sont réfugiées dans l’écriture (voyez les Mémoires de la Grande Mademoiselle), d’autres dans la religion, mais souvent le jansénisme (comme la duchesse de Longueville), une façon de faire vivre une forme de dissidence. Anne d’Autriche, elle, resta fidèle à sa chère abbaye du Val de grâce, dont elle avait fait patiemment construire les bâtiments conventuels et le dôme de l’église.
Joël Cornette écrit : « Et alors que la duchesse de Montausier, la gouvernante de son fils, le dauphin, déclara à Louis XIV, au lendemain de sa mort qu’Anne méritait d’être « mise au rang de nos plus grandes reines », non rectifia-t-il, « de nos plus grands rois. » Tout était dit, non seulement sur l’admiration que le fils portait à sa mère, mais encore sur la fermeture d’une parenthèse « féminine » de notre histoire. Et si nous l’ouvrions de nouveau ?
A lire : « Anne d’Autriche, la régente absolue », Joël Cornette, 480 p. 25,50 €