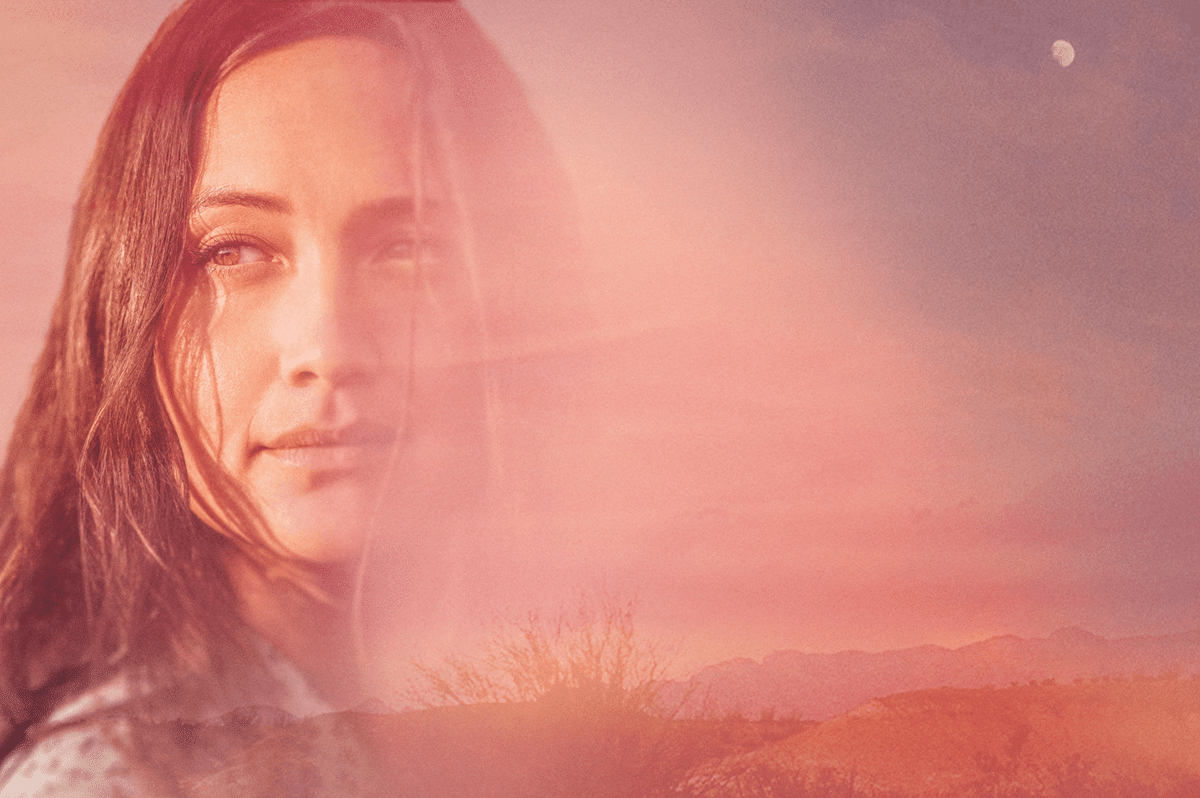Huitième long métrage de James Gray et cinquième sélection à Cannes, Armageddon Time s’éloigne des grosses productions de sa riche filmographie pour revenir avec une certaine mélancolie aux petites histoires new-yorkaises (à la manière de The Yards et Little Odessa) qui l’ont fait connaître. Il revisite ici ses années d’enfance dans le New York des années 1980 et tous les fantômes qui s’y rattachent dans un récit brillant et intime, présenté en compétition.
Alors, sachez-le, Armageddon Time n’est pas un nouveau film d’anticipation au caractère apocalyptique… En surface, il s’agit de l’histoire d’un garçon juif pré-pubère nommé Paul Graff (Banks Repeta), du jeune Noir Johnny Davis (Jaylin Webb), un peu plus âgé, qu’il rencontre lors de sa rentrée en septembre 1980, et de l’amitié infaillible qu’ils nouent grâce à leurs intérêts mutuels : l’espace et la tension qu’ils exercent sur leur professeur principal, visiblement raciste.
De la sorte, James Gray nous livre une histoire sur les lignes de faille invisibles de l’inégalité, sur les compromis moraux exigés par le rêve américain et sur les moyens très pratiques par lesquels se souvenir du passé peut être la seule défense légitime contre les forces sociales qui tentent sans cesse de le reconditionner comme une vision de l’avenir.
Et puis, plus en profondeur, Armageddon Time est une histoire sur la relation de Paul avec quelqu’un d’encore plus âgé que Johnny : son grand-père maternel. Incarné, une fois de plus, merveilleusement bien par un Anthony Hopkins, dont les performances courageuses au crépuscule de sa vie continuent d’extraire la vérité brute des profondeurs de la fragilité humaine. Nous avons tous encore en tête sa prestation héroïque dans The Father.
Dans Armageddon Time, il devient The Grand father, Aaron Rabinowitz, né à Liverpool parce que sa mère juive a dû fuir l’Ukraine, avant de déménager dans le Queens dans l’espoir de pouvoir échapper à l’antisémitisme en continuant à aller vers l’Ouest. Il est devenu un patriarche capable d’offrir à sa famille un siège conditionnel à la table de la société blanche américaine.
Mais en dépit de son attitude joyeuse et de son énergie de « grand-père préféré », Aaron est troublé par le pays où il a replanté ses racines. Il se bat (en privé, sans mot dire) pour concilier la stabilité socio-économique et le prix à payer pour la maintenir tout en reconnaissant la violence qui résulte de la complicité et l’impossibilité de l’accepter. Il est ainsi intéressant d’observer le rapport du petit Paul avec son père et son grand-père… deux discours différents qui lui sont offert dans l’attitude à avoir pour affronter la vie et ses injustices. Du côté du père le besoin d’apprivoiser cette réalité et de saisir la chance quand elle se présente, et du côté du grand-père le refus de plier et d’accepter. Deux concepts avec lesquels il devra grandir et se construire. Deux concepts avec lesquels nous aussi nous devons nous confronter plus ou moins constamment…