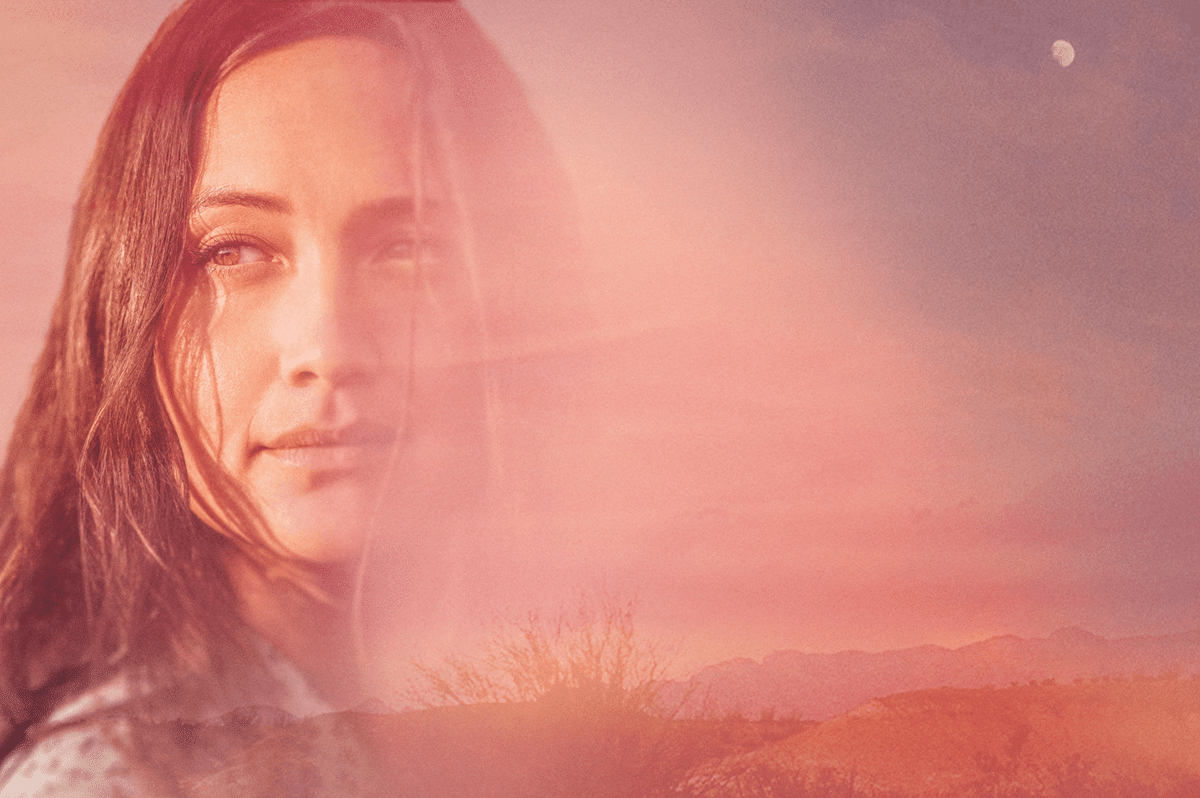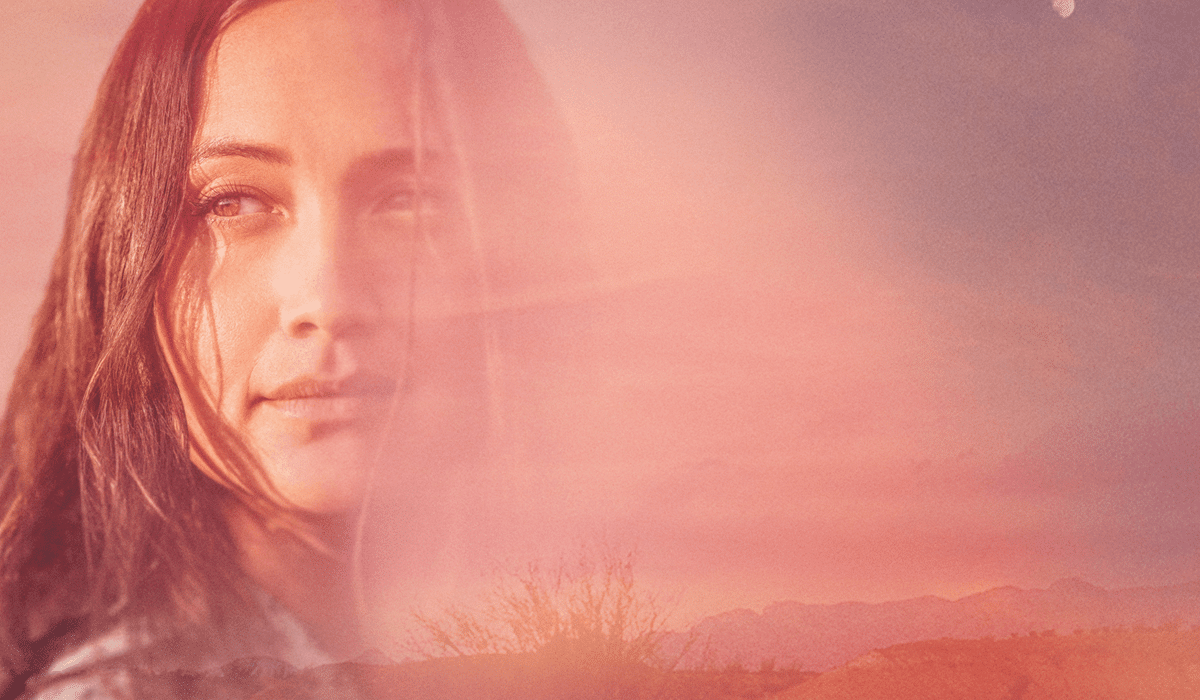Armageddon Time, huitième film de James Gray revient, avec une part de mélancolie, sur ces petites histoires new-yorkaises (façon The Yards ou Little Odessa) qui l’avaient fait connaître. Il repense à ses années d’enfance dans le New York des années 1980, avec les nombreux « fantômes » qui s’y rattachent, dans une brillante histoire, pétrie d’intimité.
Armageddon Time, c’est d’abord l’histoire d’un jeune juif, Paul Graff (Banks Repeta), issu d’une famille aimante, bien qu’éclatée qui, à onze ans, vit des expériences qui ébranlent sa confiance en ses parents et lui apprennent des vérités difficiles sur la société américaine.
C’est aussi l’histoire d’une profonde amitié, celle de Paul avec Johnny Davis (Jaylin Webb), un gamin noir un peu plus âgé, qu’il rencontre lors de sa rentrée en septembre 1980. Leur amitié se noue au-travers de leurs intérêts mutuels : l’espace et la tension qu’ils exercent sur leur professeur principal, visiblement raciste. Ainsi, Gray expose les lignes de faille invisibles de l’inégalité, nous éveille sur les compromis moraux exigés par le rêve américain et sur les moyens très pratiques par lesquels se souvenir du passé peut être la seule défense légitime contre les forces sociales qui tentent sans cesse de le reconditionner comme une vision de l’avenir.

Le titre de ces mémoires cinématographiques de Gray provient de deux sources. La première est une interview que Ronald Reagan a donnée au télévangéliste Pat Robertson, dans laquelle le candidat a insisté sur la possibilité d’un cataclysme nucléaire. La famille Graff est montrée en train de regarder un extrait de l’interview, Irving qualifiant le gouverneur de Californie d’imbécile avant que Paul n’entende ses camarades de classe à Forest Manor scander son nom en l’approuvant.
La deuxième référence est la chanson Armagideon Time de l’artiste reggae Wiili Williams, que l’on entend vers le début du film, puis complètement, dans la version de The Clash, à la fin. Ses paroles disent notamment (traduit en français) : « Beaucoup de gens n’auront pas de dîner ce soir, Beaucoup de gens n’auront pas de justice ce soir, La bataille devient plus chaude dans cette ´iration’, Temps d’Armagideon / Beaucoup de gens courent et se cachent ce soir, Beaucoup de gens n’auront pas de justice ce soir, Rappelez-vous de donner un coup de pied, Personne ne vous guidera, Temps d’Armagideon. » Mettez tout ça ensemble, et le propos du film devient clair…
En regardant son passé, Gray conclut que les inégalités dans les États-Unis d’aujourd’hui, et la menace de destruction qu’elles représentent, ont commencé avec Reagan et n’ont fait que se métastaser au fil du temps.
Tout comme son remords de ne pas avoir suffisamment résisté à l’attraction de ce « conservatisme », même lorsqu’il était enfant. C’est un message assez lourd pour un film semi-autobiographique sur le passage à l’âge adulte, mais Gray le fait passer sans se montrer moralisateur ou larmoyant. Le secret ne réside pas seulement dans la dureté du message lui-même, mais aussi dans la façon dont Gray le met en scène.
L’histoire est racontée du point de vue de Paul, mais à travers la toile de fond de la réimagination que Gray en fait lui-même. Cela implique alors que les personnages sont vus à travers les yeux d’un enfant maladroit qui essaie de donner un sens à ce qui se passe autour de lui.
Plus en profondeur, Armageddon Time raconte la belle histoire de cette relation que Paul entretient avec son grand-père maternel, incarné avec bonheur par un Anthony Hopkins, dont les performances courageuses au crépuscule de sa vie continuent d’extraire la vérité brute des profondeurs de la fragilité humaine. Nous avons tous encore en tête sa prestation héroïque dans The Father. Ici il devient donc ‘the grand father’, Aaron Rabinowitz, né à Liverpool parce que sa mère juive a dû fuir l’Ukraine, avant de déménager dans le Queens dans l’espoir de pouvoir échapper à l’antisémitisme en continuant à aller vers l’Ouest. Il est aujourd’hui le patriarche, celui qui est capable d’offrir à sa famille un siège conditionnel à la table de la société blanche américaine.
Mais en dépit de son attitude joyeuse et de son énergie de « grand-père préféré », Aaron est troublé par le pays où il a replanté ses racines. Il se bat (en privé, silencieusement) pour concilier la stabilité socio-économique et le prix à payer pour la maintenir, tout en reconnaissant à la fois la violence qui résulte de la complicité et, dans le même temps, l’impossibilité de l’accepter.
La caméra se fixe ainsi sur les rapports du petit Paul avec son père et son grand-père… deux discours différents lui sont offert quant à l’attitude à avoir pour affronter la vie et ses injustices.
Il y a son père, avec un besoin certain d’apprivoiser cette réalité et de saisir la chance quand elle se présente, et puis son grand-père qui privilégie le refus de courber l’échine. Deux concepts avec lesquels il devra lui-même grandir et, surtout, se construire.
Deux concepts de vie avec lesquels, finalement, nous aussi nous devons nous confronter… plus ou moins constamment. « La vie n’est pas juste », lui dira d’ailleurs son père vers la fin, ce qui résume assez bien le message que Paul apprend, réalisant que personne n’a joué le rôle de super-héros qu’il rêvait enfant de remplir lui-même.