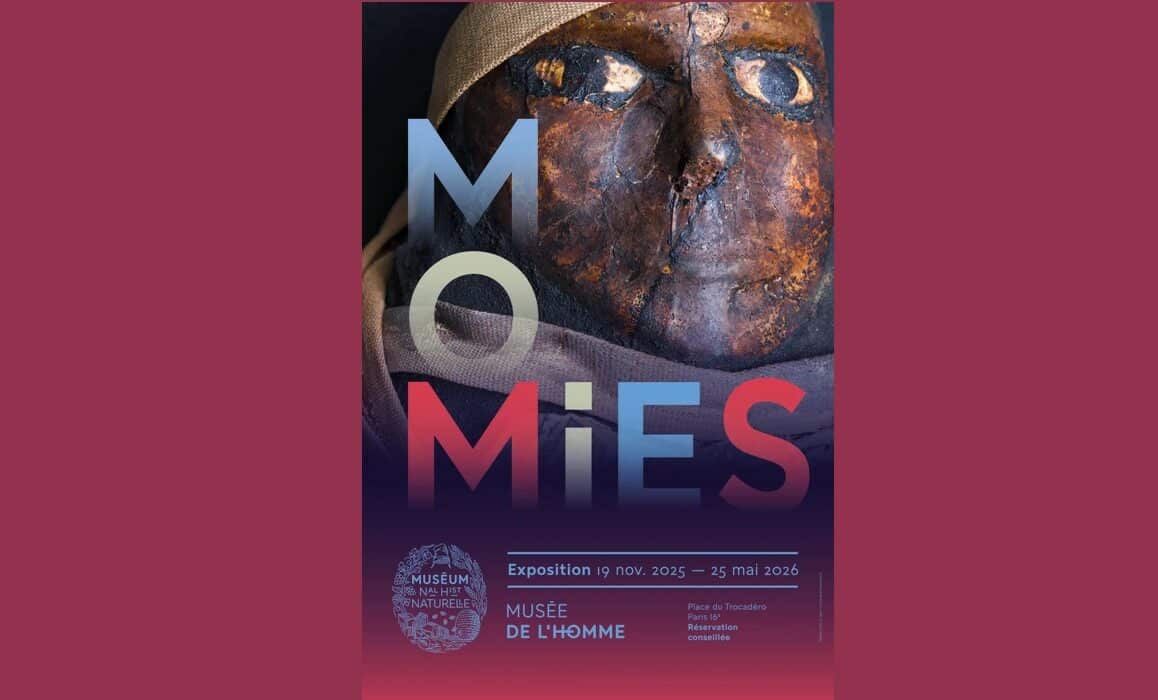Après avoir remporté le prix d’interprétation féminine à sa jeune héroïne Samal Yeslyamova qui jouait là dans son premier film, Ayka de Sergey Dvortsevoy est enfin sorti en salles.
Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se permettre d’avoir un enfant.Elle n’a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas une chambre à elle.Mais c’est compter sans la nature, qui reprendra ses droits.
Il faut le reconnaître, Ayka est terriblement oppressant mais tellement touchant à la fois. Samal Yeslyamova y crève littéralement l’écran et nous prend aux tripes dans sa capacité à projeter sa souffrance physique et psychologique. Un film qui, par ailleurs, trouve de la grandeur et de la dignité dans un refus de l’enjolivement et du romanesque en prenant le risque de mettre le spectateur, avec brutalité, à l’épreuve de la laideur du monde et de la souffrance des démunis, dans un Moscou enneigé.
Le réalisateur Kazakh Sergey Dvortsevoy, qui avait été révélé en 2008 avec Tulpan, prix « Un Certain Regard »à Cannes cette année-là, choisi de traquer son personnage, caméra à l’épaule, scrutant sa détermination à s’en sortir. Doloriste bien évidemment, par la nature même du récit, Ayka narre ainsi un portrait de femme très proche de celui pensé par les frères Dardenne ou même à l’écriture de Zola. Dvortsevoy emprunte cinématographiquement parlant naturellement beaucoup aux Dardenne, en revisitant leur univers dans des lieux et des circonstances différentes. Style cru et austère, le monde est montré sans fard, sans fioritures. Le portrait d’une héroïne en souffrance se dévoile alors… Mais il brille au travers d’une épure volontaire du réalisateur, ne donnant que peu de clefs sur le passé de la jeune femme, et où seul demeurent quelques rares ellipses permettant ainsi d’éviter tout pathos.
On est là, face à un long-métrage dénudé des artifices du cinéma, mais qui pourtant révèle une vraie proposition cinématographique aussi intense que passionnante. Par exemple, cette proposition de Dvortsevoy qui choisit d’encadrer métaphoriquement son histoire par deux plans qui se répondent – le premier ouvre le film et montre quatre nouveau-nés braillards sur un chariot de clinique, le second, juste avant l’épilogue, aligne quatre chiots en train de téter leur mère, dans le cabinet d’un vétérinaire. Chacun pourra y donner sens en fonction de sa lecture personnelle de l’histoire de cette femme. Mais, il est clair qu’il y a, derrière cette douleur constamment éclaboussant le regard du spectateur, de la grandeur d’âme, une vraie dignité dans ce refus de l’enjolivement et du romanesque, et la force de la résilience qui éblouit dans cette figure maternelle.
Un film de survie et de révélation… un film coup de poing, radical qui trouve sens et qui démontre que de l’obscurité la plus épaisse peut révéler une forme d’éclat bienveillante et nécessaire.