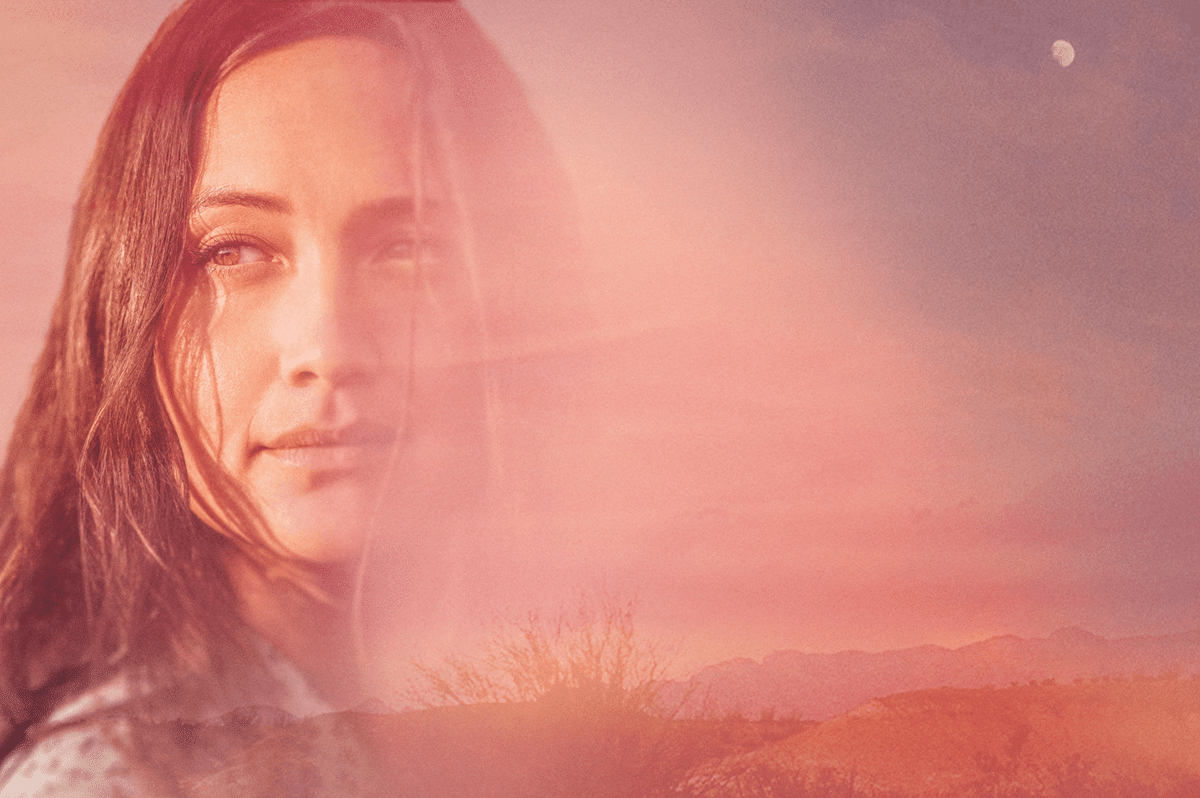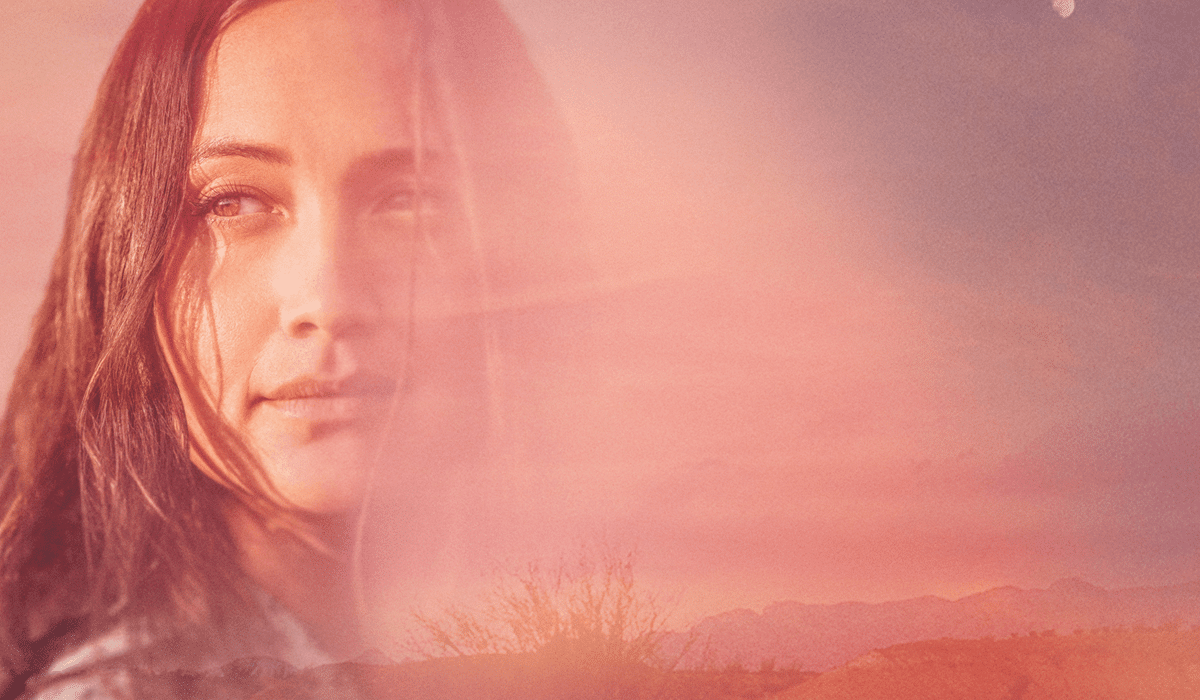Babylon, c’est le blockbuster de cette semaine, qui sort ce mercredi 18 janvier, et, osons le dire, de ce début d’année. Après Avatar en décembre, les professionnels du cinéma comptent sur de bons chiffres d’entrée en salles, pour vivifier l’industrie souffrante. Mais, en même temps, Damien Chazelle ne fait pas dans la dentelle, avec un énorme métrage de plus de 3h, une prise de risque maîtrisée offrant une vision plus qu’audacieuse et sans compromis, une sorte de réinterprétation déconcertante et grandiloquente de la décadence, de l’horreur, de la mystique et du mythe à un tournant majeur de l’histoire du cinéma, de l’apogée des films muets aux débuts désordonnés des films parlants.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.
La vraie Babylone, celle dont le film de Damien Chazelle tire son nom, était la capitale d’un ancien et puissant empire. La Bible la mentionne presque dès que l’humanité arrive sur la scène : « Venez, bâtissons-nous une ville, avec une tour qui atteigne les cieux, afin de nous faire un nom », décident les humains. Du haut du ciel, Dieu regarde, rit et confond leurs langues pour qu’ils ne puissent pas communiquer entre eux, ce qui fait échouer le projet. L’endroit est baptisé Babel. Et finalement, il devient un centre de recherche humaine, de connaissance et de pluralisme, mais aussi d’oppression impérialiste et d’hédonisme.
C’est pourquoi Babylone, au fil du temps, est devenue plus une métaphore qu’un lieu littéral. Ce qu’elle était, importe finalement moins que ce qu’elle représente. C’est un symbole de l’oppression et de la tyrannie, la représentation de la fausse religion alliée au pouvoir temporel, et même un synonyme du mal, son roi étant dans le texte biblique associé à Lucifer, cette « étoile du matin », ce « porteur de lumière » devenu le prince diabolique de ce monde.
C’est aussi l’incarnation de l’orgueil démesuré. C’est enfin un symbole de la décadence, d’un genre qui combine l’extase et le désespoir. Vous pourrez vous perdre dans les entrailles de Babylone, et Babylone s’en moque allègrement…
Avec ces repères historiques, spirituels et culturels, on imagine alors le sens que prend la métaphore choisie par Chazelle pour décrire les débuts d’Hollywood, ancrée dans l’histoire, même si, sa propre version est, à bien des égards, inventée.
Le film, qui se déroule à la fin des années 1920, est une épopée sans concession sur le moment fatidique et stratégique où le cinéma est passé du muet au sonore.
Son regard sur cette période de l’histoire du septième art est affiné et renforcé par les raisons humaines profondément personnelles pour lesquelles les gens sont attirés à la fois par le cinéma et par le milieu de la production cinématographique.

Raconté sous la forme d’un triptyque, le scénario est centré sur trois personnages : la star vieillissante Jack Conrad (Brad Pitt), la starlette Nellie LaRoy (Margot Robbie) et un ouvrier appelé Manny Torres (Diego Calva), qui cherche désespérément dans le préambule à aller sur un tournage. À ces trois personnages ajoutons celui du musicien noir Sidney Palmer (Jovan Adepo) qui, à lui seul, raconte aussi tout le pan musical et racial des débuts de l’histoire du cinéma.
Alors, il est indéniable, que Chazelle a choisi l’outrance, en tout et pour tout, dans ce Babylon qui, sans nul doute, déplaira à un grand nombre de spectateurs.
Les excès sont à voir comme l’ingrédient de fond de cette histoire et de sa restitution sur grand écran. Elle accompagne le scénario du début à la fin. Il y a une dimension foutraque qui explose, dérange, ébloui, amuse et peut rebuter. C’est Babylon ! Babylone la grande, Babylone et ses jardins suspendus, l’une des Sept Merveilles du monde antique… mais c’est aussi Babylone la prostituée, celle où fleurissent le vice et le mal, où ceux qui veulent s’approcher trop près du soleil se brulent les ailes et s’écrasent pitoyablement jusqu’à en mourir… C’est la Babylone de Lavilliers qui est là derrière ces 3 heures incroyables : « Comme les vierges de Babylone, tu cherchais dans la fumée, dans les cartes des médiums, dans la force des marées. Tu marchais dans la tempête. Tu buvais des alcools forts. Tu croyais le reconnaître. Mais tu le rêvais encore… Noir comme le diable, chaud comme l’enfer, insaisissable. Seigneur de guerre ». C’est aussi pour moi comme pour Deraime, celle qui déconne et qui, peut-être un jour, n’écrasera pourtant plus personne.

Chazelle livre un véritable hymne d’amour au cinéma. Une ode dantesque que l’on pourra sans doute mieux saisir dans le dernier quart d’heure au travers du regard de Manny devant cet écran de L.A. où et projeté Singing in the Rain et ce qu’en livre au-delà le réalisateur américano-français dans un final exaltant, une dernière outrance cinématographique que Malick ne renierait pas. Manny souffre, pleure et sourit à la fois. C’est tout cela que le cinéma et, plus largement possiblement, la culture du loisir et du plaisir procurent, semble nous dire Chazelle.
Le film se déroule principalement, rappelons-le, pendant la transition tumultueuse entre le cinéma muet et le cinéma sonore, lorsque le processus de fabrication des films a changé à jamais le paysage d’Hollywood. Des carrières ont été créées et détruites, et à Babylon, l’acte de création n’est jamais loin de l’acte de destruction, et d’une certaine manière, ils sont inexorablement liés.
D’un point de vue technique, Chazelle s’appuie à nouveau sur les artisans experts qui l’ont aidé à créer Whiplash, La La Land et First Man – le premier homme sur la Lune. Tom Cross monte avec compétence les longues séquences fluides et les courtes séquences rapides, ce qui fait que les deux premières heures de ce film passent relativement vite.
Justin Hurwitz, qui, outre les films susmentionnés, a également été le compositeur du premier film de Chazelle, Guy and Madeline on a Park Bench, un film musical centré sur le jazz, compose l’une des partitions qui sera sans doute l’une des plus mémorables et des plus émouvantes de l’année. Preuve en est d’ailleurs, le compositeur repart de la toute récente cérémonie des Golden Globes (le 10 janvier dernier) avec le trophée de la meilleure musique originale, et l’avenir de Justin Hurwitz aux Oscars s’annonce très encourageant.
Enfin, la photographie de Linus Sandgren a rarement été aussi belle. À Babylon, Lucifer est roi… et le film ne peut être alors qu’un médium né de l’ombre et de la lumière, construit sur des cendres et des rêves gâchés qui flirtent pourtant avec l’éblouissant et l’immortel jusqu’à rejoindre les fantômes… Cette tension constitue le conflit central du film, qui ose, d’une certaine manière, demander si tout cela en vaut pourtant bien la peine.