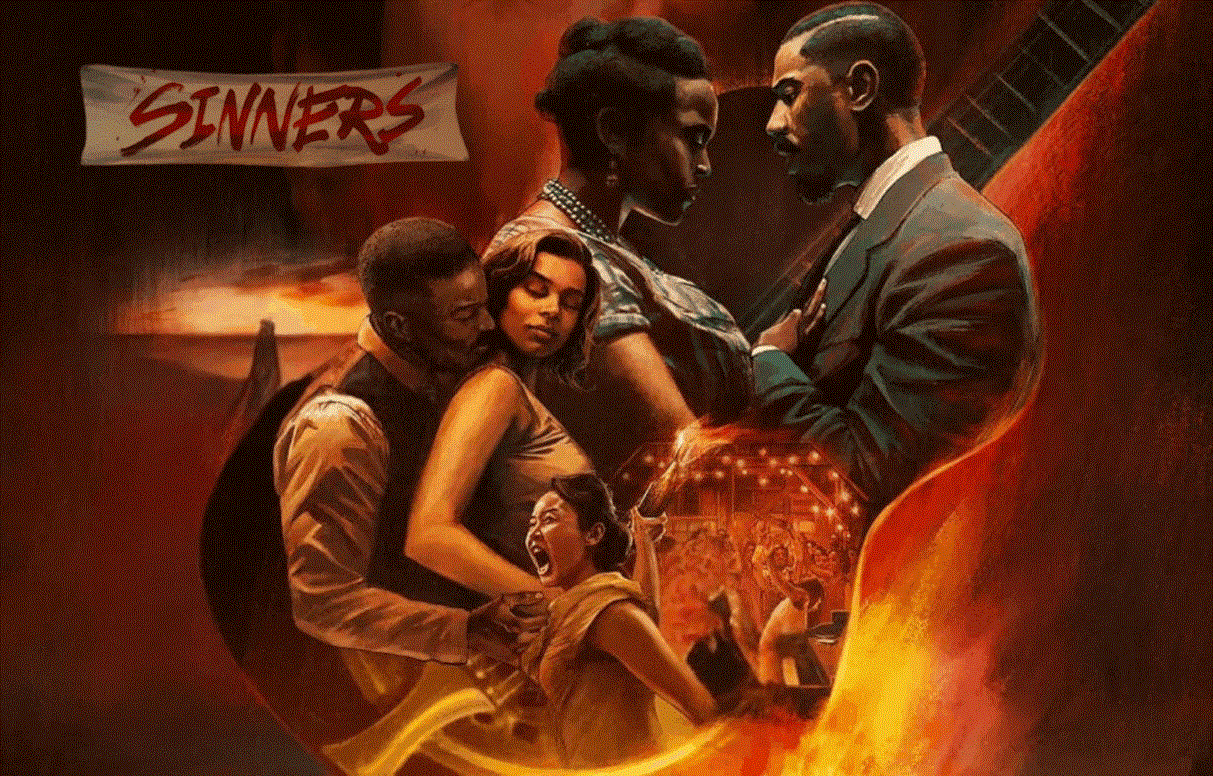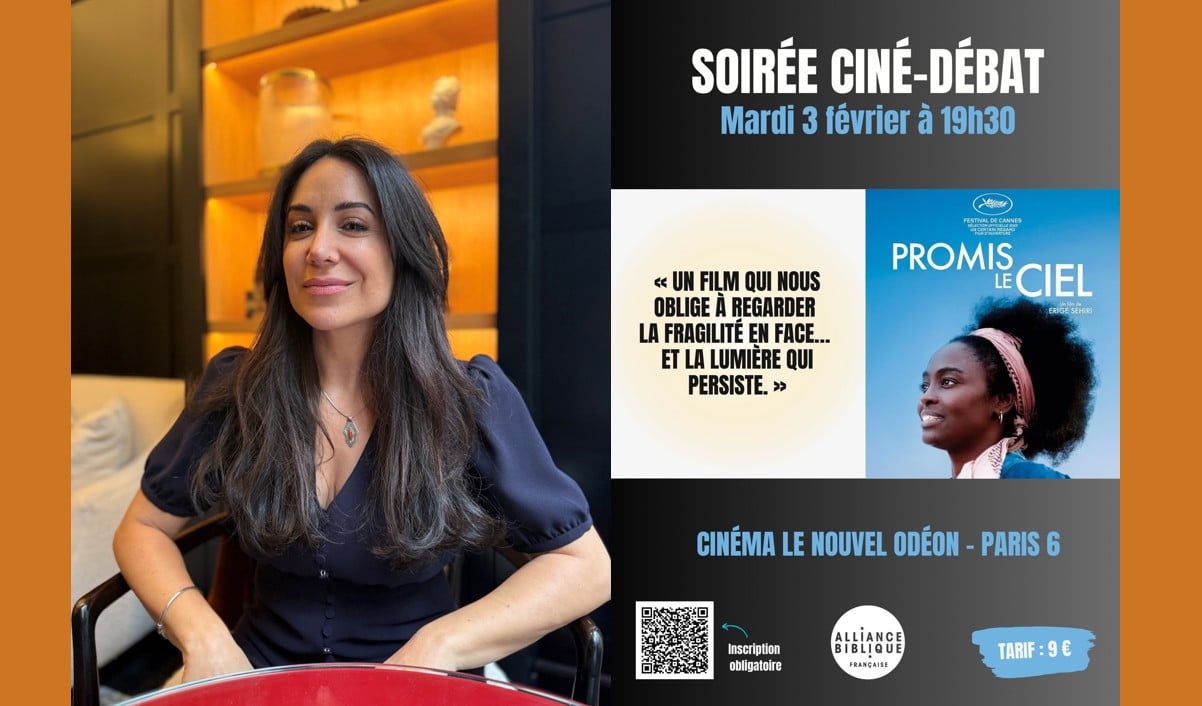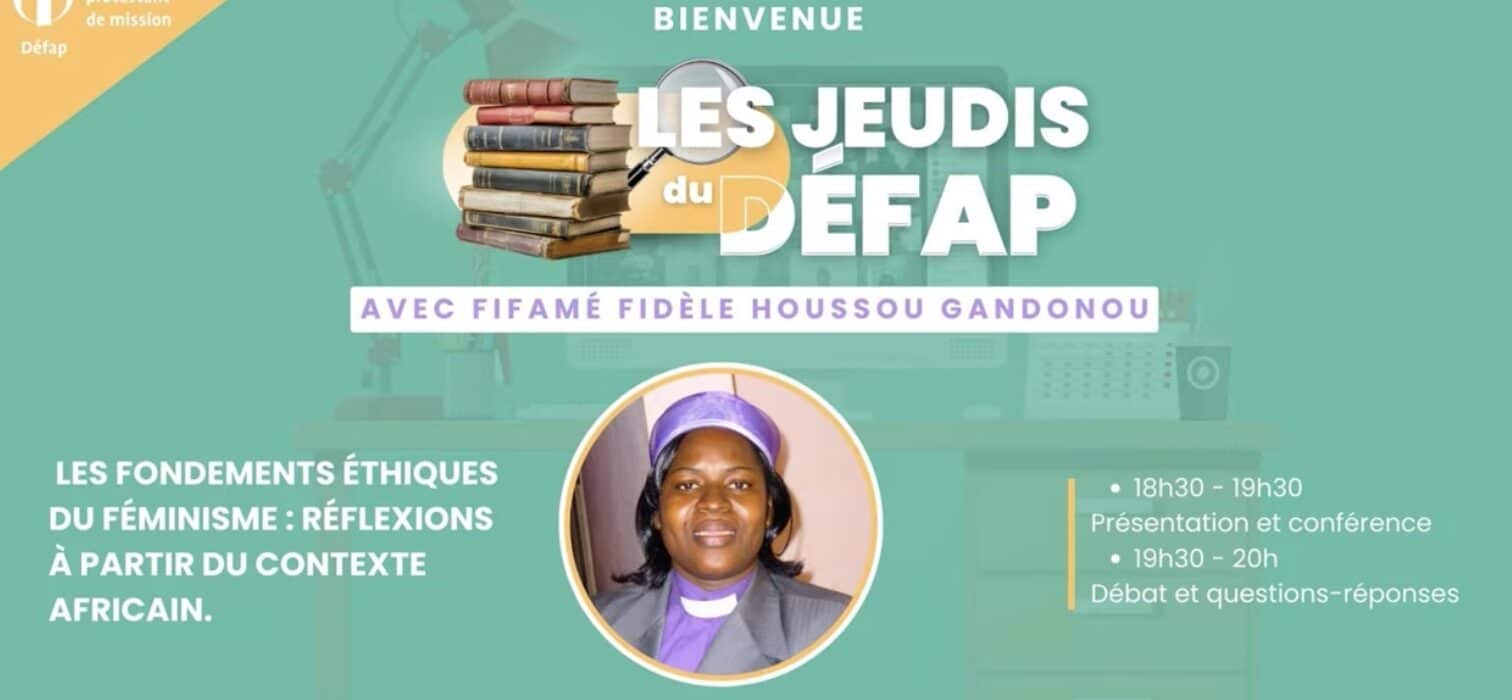Le cinéma est parfois ce lieu rare où les choix les plus intimes deviennent des actes universels. 7 jours, en salles le 6 aout 2025, le bouleversant long métrage d’Ali Samadi Ahadi, coécrit avec Mohammad Rasoulof, en est un exemple frappant. Inspiré de la vie de Narges Mohammadi, figure emblématique de la lutte pour les droits humains en Iran et Prix Nobel de la paix 2023, le film n’est pas une biographie mais une parabole tragique sur la liberté, la maternité, et la dignité en exil intérieur.
Myriam, activiste et militante pour les droits de l’Homme, est emprisonnée depuis des années en Iran loin de son mari et de ses enfants. Lorsqu’elle obtient enfin une permission pour raisons médicales, elle a 7 jours pour décider de fuir le pays et retrouver sa famille ou de rester en Iran pour continuer sa lutte. Commence alors une véritable course contre la montre.
Le titre du film annonce déjà son compte à rebours : sept jours. C’est le délai laissé à Maryam, prisonnière politique temporairement libérée pour raisons médicales, pour décider : fuir l’Iran et rejoindre ses enfants exilés… ou retourner en prison. Le film suit ces journées comme une tension permanente, chaque geste habité par l’éventualité d’un renoncement ou d’un sacrifice. Et si elle part, peut-elle encore être elle-même ? Et si elle reste, que devient son amour de mère ?

Ali Samadi Ahadi filme cette traversée intérieure et extérieure avec une sobriété brûlante. Le froid de la neige, la morsure du vent, les tensions muettes du quotidien composent un thriller moral, aussi haletant que silencieux. Ce n’est pas le récit d’un départ, mais celui d’un combat : rester fidèle à sa voix, mais jusqu’à quel prix ?
Un corps en résistance
Le choix de Vishka Asayesh pour incarner Maryam ne doit rien au hasard. Immense actrice en Iran, elle fut bannie pour avoir refusé de porter le hijab à l’écran. 7 jours marque donc son retour et sa rupture avec le cinéma officiel. La première scène où elle touche librement ses cheveux est d’une puissance bouleversante : elle redonne au geste quotidien toute la force d’une libération intime. La caméra, souvent portée à l’épaule, suit Maryam au plus près : son souffle, ses frissons, ses hésitations, sa détermination. L’objectif ne lâche jamais son regard, créant une proximité presque documentaire. Cette caméra tremblante, légèrement désaxée, traduit visuellement l’instabilité permanente du personnage : celle d’une femme suspendue entre deux abîmes.
Entre fiction et vérité
Si le récit est fictionnel, le contexte est on ne peut plus réel. Coécrit avec Mohammad Rasoulof (Les graines du figuier sauvage, prix du Jury œcuménique et prix spécial du Jury à Cannes 2024), cinéaste iranien persécuté et aujourd’hui exilé, le film porte la marque d’une histoire collective. Rasoulof a lui-même fui l’Iran à pied en 2024. Quant au tournage, il a eu lieu en Géorgie, dans des conditions extrêmes, à proximité d’une frontière sous tension. Toute l’équipe partageait alors une même urgence : raconter cette histoire, coûte que coûte.
C’est cette urgence morale qui donne au film sa gravité. 7 jours n’est pas un récit d’évasion, mais un film sur la responsabilité, la solitude de la décision, et la radicalité du refus. En Iran, refuser l’exil est parfois une forme ultime de présence. Maryam sait que si elle part, elle cessera d’exister politiquement, spirituellement, humainement.
Maternité, exil, foi
L’un des aspects les plus émouvants du film est sans doute sa dimension materno-politique. Maryam aime ses enfants, mais ne peut plus vraiment leur parler : ils vivent loin, parlent une autre langue, ont une autre vie. Cette barrière linguistique symbolise une rupture émotionnelle profonde. Et pourtant, l’amour ne faiblit pas. Il s’exprime dans le regard, dans l’éloignement assumé, dans la retenue bouleversante d’une scène où Maryam, à deux pas de ses enfants, choisit de ne pas les embrasser, pour les protéger. Il y a là une dimension spirituelle, presque sacrificielle. Cette femme qui choisit l’absence au nom de la fidélité à sa cause rejoint, par-delà les cultures, les grandes figures de la résistance intérieure. On pense à Etty Hillesum, à Dietrich Bonhoeffer, à toutes celles et ceux qui ont compris que la vérité n’est pas négociable, même si elle coûte.

7 jours ne délivre pas de message clair. Il propose une forme de méditation. Son dernier plan, figé sur le visage de Maryam, est un manifeste de cinéma : une femme regarde l’avenir qu’elle choisit, sans fléchir. Pas une héroïne, pas une martyre. Une femme libre, dans un monde où la liberté est un luxe risqué. En refusant les effets faciles, le film invite à une réception profonde. Il est lent, aride, tendu. Il ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. Dans un monde saturé de récits consensuels, 7 jours réaffirme le pouvoir du cinéma comme espace de conscience, de complexité, et de courage.
Rarement film aura si bien porté le poids du politique dans la chair du quotidien. 7 jours est à la fois un thriller intérieur, une élégie sur la maternité empêchée, un manifeste sur l’impossibilité du renoncement. Il faut voir ce film pour mieux comprendre ce que signifie résister, aimer, et tenir bon, sept jours durant… et au-delà.