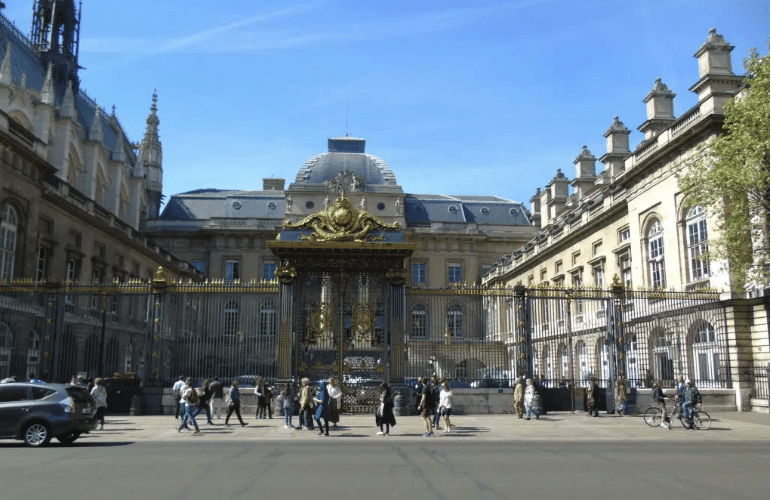Dans les cinémas français ce 14 janvier, présenté en première mondiale au Festival international du film de Busan, puis couronné de trois distinctions majeures, dont le Grand Prix du Jury et le Prix de la Critique au Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul en février 2025, le premier long métrage d’Elzat Eskendir s’impose comme une œuvre exigeante et profondément politique. Le film s’ouvre sur un texte qui pose le décor : l’effondrement du secteur agricole, la disparition de millions de têtes de bétail, et, plus encore, la perte de sens qui accompagne ces bouleversements économiques. Un regard exigeant sur une société en transition.
Dans le tumulte post-soviétique du Kazakhstan en 1993, les fermes collectives sont démantelées et les propriétés sur le point d’être privatisées. Les dirigeants locaux ont depuis longtemps outrepassé leurs pouvoirs officiels, se partageant les ressources comme ils l’entendent. Abel, éleveur local, voudrait simplement sa part, mais la situation est plus complexe qu’il ne l’imaginait. Doit-il jouer le jeu de la corruption ou défendre ce qui lui paraît juste ?

Les steppes comme miroir d’une société en ruines
Dans les steppes kazakhes, la fin d’un système a laissé derrière elle des terres sans règles et des hommes sans repères. À travers le destin d’Abel, c’est toute une société qui vacille. Le personnage, incarné avec une sobriété remarquable, affronte non seulement la spoliation matérielle, mais aussi une forme de dévalorisation morale. Après avoir consacré sa vie au collectif, il devient soudain superflu. Comme le souligne le réalisateur, le film interroge « le traitement le plus cruel infligé à une personne : la dévalorisation de l’individu par la société après qu’il lui a consacré toute son énergie ».
La mise en scène se distingue par un réalisme quasi documentaire. Elzat Eskendir filme les gestes du travail, les silences familiaux, les regards des enfants, sans jamais appuyer son propos. La collaboration avec la directrice de la photographie Jolanta Dylewska confère au film une puissance visuelle saisissante faite de plans larges embrassant l’horizon infini des steppes, compositions épurées, attention extrême portée aux visages.
Les paysages arides deviennent un espace cinématographique à part entière, miroir de l’isolement et de la solitude croissante des personnages.
Ce choix esthétique radical renforce la dimension politique du film, mais en constitue aussi la limite. Très ancré dans la culture et l’histoire kazakhes, le récit peut parfois sembler difficile d’accès pour un public étranger. Les personnages, plus figures que vecteurs d’identification universelle, servent avant tout un commentaire précis sur l’effondrement économique et moral d’un pays en transition. Ce parti pris assumé confère à l’œuvre une cohérence formelle indéniable, même s’il freine parfois l’émotion.
Abel demeure néanmoins un film puissant, porté par une vision claire et une grande maîtrise cinématographique. Plus qu’un drame individuel, il s’agit d’un constat lucide sur la violence des mutations économiques et sur la solitude de celles et ceux qu’elles laissent derrière elles. Une œuvre exigeante, visuellement remarquable, qui révèle Elzat Eskendir comme un cinéaste à suivre de près, attentif aux vies ordinaires broyées par les grands tournants de l’histoire.