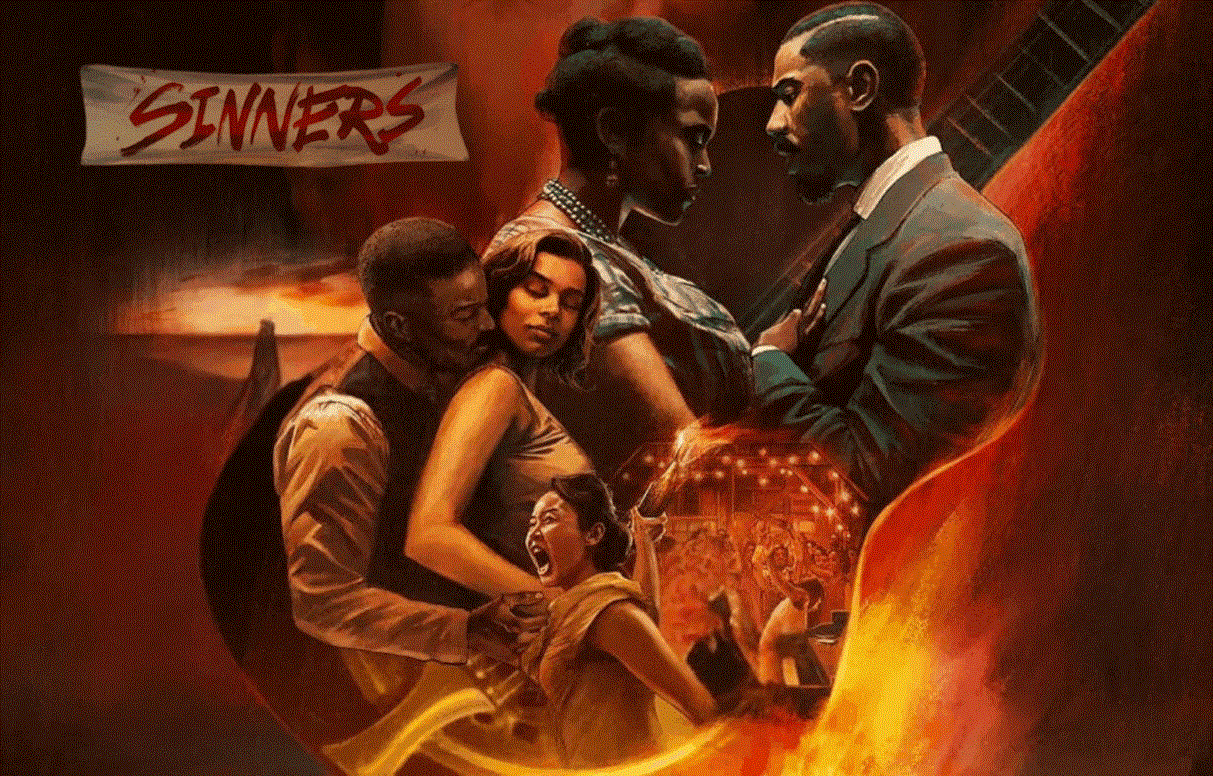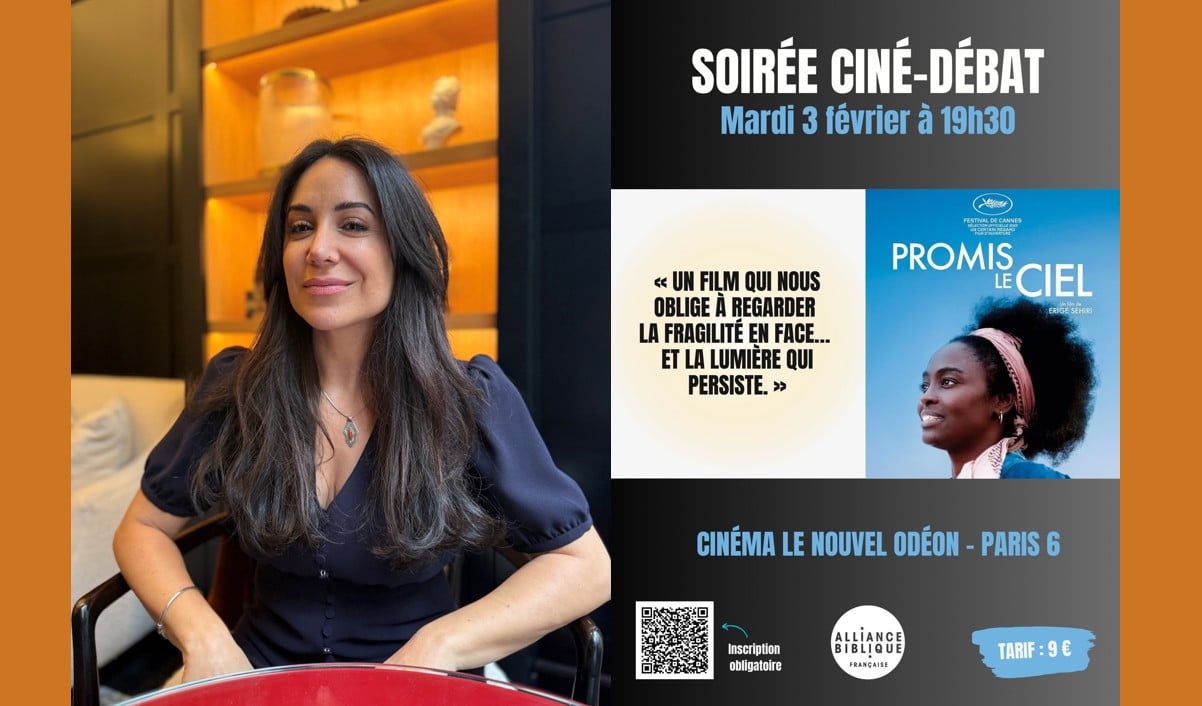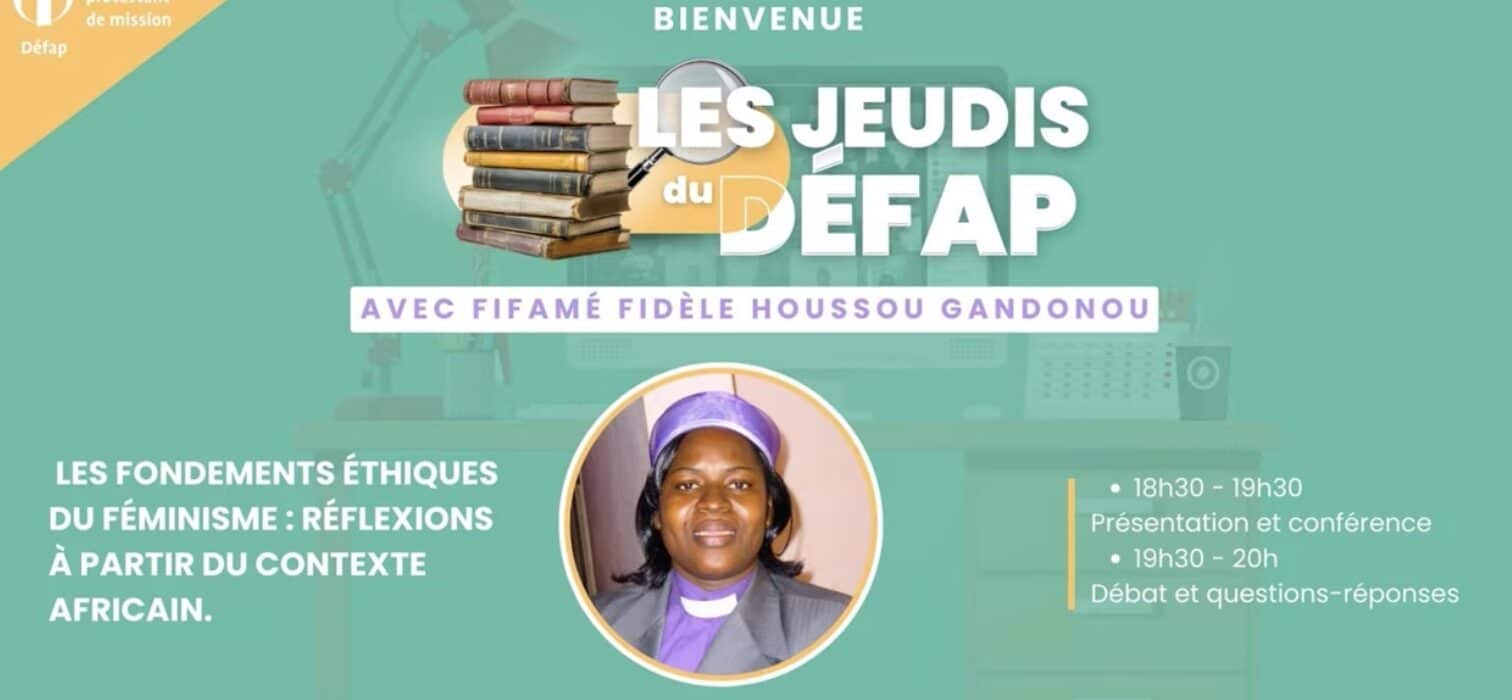Il y a des films qui s’offrent comme des confidences, à peine murmurées. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, second long métrage de fiction de Lyne Charlebois après Borderline en 2008, est de ceux-là. Ni biopic, ni romance conventionnelle, le film trace la cartographie d’un amour qui s’écrit à l’encre du savoir, du silence et du sacré. Une proposition qui a charmé Angoulême l’année passée, où Mylène Mackay a obtenu le Valois de la meilleure actrice.
Dès les premières images, le film s’installe dans une lenteur habitée. Les séquences en forêt, les herbiers que l’on tourne comme des psaumes feuilletés, les regards suspendus sur une tige ou un pétale : ici, la science n’est pas une affaire d’objectivité froide, mais un émerveillement sacré.
Le frère Marie-Victorin, religieux et homme de science, trouve dans l’observation du vivant une voie de communion avec le Créateur. Marcelle, elle, s’en approche avec une curiosité ardente et humble. Ensemble, ils explorent, écrivent, devinent ce qui se dit derrière le visible.
La beauté, ici, n’est pas décorative : elle est appel, mystère, chemin. Le film saisit cette dimension avec une douceur presque mystique. Les lettres échangées deviennent des prières croisées, où les mots osent dire la beauté, la souffrance, la solitude, le désir même… un désir qui reste chaste mais jamais tiède. Dans un monde où la foi et la chair s’opposent souvent, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ose une autre voie : celle d’un amour spirituel, tendre, pleinement incarné sans être consommé.

Deux époques, deux récits en miroir
La réalisation joue avec le temps. Le film alterne entre les années 30, celles de la relation entre Marie-Victorin et Marcelle, et une époque contemporaine où deux comédiens répètent une pièce inspirée de cette histoire. Si ce dispositif de mise en abyme peut parfois troubler, il n’est jamais gratuit. Il souligne ce que le film veut dire : que cette relation a traversé le temps, qu’elle continue d’inspirer, de questionner. Les résonances sont nombreuses entre les deux récits : les blessures intimes, les limites imposées par la société ou par soi-même, la quête d’un amour vrai qui ne trahit ni soi, ni l’autre.
À travers ces jeux de miroir, c’est aussi le langage qui est mis en scène. La langue savante, élégante, des lettres d’autrefois répond aux hésitations, aux silences, aux mots mal ajustés du présent. Comme si le film nous rappelait que la beauté, celle des choses et des êtres, tient aussi à la manière dont on la dit.

Des interprètes en état de grâce
Le duo formé par Mylène Mackay et Alexandre Goyette touche par sa justesse. Elle, incarne Marcelle avec une intelligence vibrante, jamais figée dans une image de « femme d’exception ». Elle doute, espère, aime, sans jamais se réduire à une fonction ou un rôle. Lui, donne au frère Marie-Victorin une densité intérieure impressionnante : homme de foi, de rigueur, mais aussi de trouble et de tendresse. Leurs échanges sont faits de regards, de soupirs contenus, d’élans bridés : autant de gestes minuscules qui prennent, dans ce film, des proportions bouleversantes.
La direction photo magnifie ces présences, avec une attention soutenue à la lumière, aux textures, aux atmosphères naturelles. Les plans de nature ne sont jamais de simples respirations esthétiques. Ils sont le cœur battant du film. Une feuille, une tige, un mouvement de sève deviennent matière à méditation, matière à poésie. Le monde végétal n’est pas observé, il est écouté.

Foi, désir et langage du vivant
Ce qui frappe dans Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, c’est la manière dont il articule foi, science et amour sans jamais les opposer. La relation entre Marcelle et Marie-Victorin n’est pas seulement amicale ou intellectuelle. C’est un amour profond, intime, retenu, porté par une même quête d’absolu. Un amour où l’on ne s’appartient pas, mais où l’on se comprend. Un amour qui n’est ni transgressé ni nié, mais offert dans le respect du mystère.
Dans une perspective spirituelle, ce film pose une question rarement entendue au cinéma : et si l’on pouvait aimer sans posséder ? Et si la contemplation du vivant, celle d’une fleur, d’un mot, d’un être, suffisait parfois à nous conduire vers Dieu ? La foi, ici, n’est pas une institution pesante, mais une voie d’attention, d’écoute, de patience. Elle habite les lettres, les silences, les gestes contenus.

Un film pour l’âme
Il faut prendre le temps d’entrer dans ce film. Son rythme lent, ses allers-retours entre passé et présent, son refus du spectaculaire peuvent dérouter. Mais pour qui accepte cette patience, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles est une expérience rare. Une œuvre qui parle à l’intelligence, au cœur, à la foi. Qui rappelle que certaines formes d’amour, même tues, même empêchées, laissent une trace indélébile dans le tissu du monde.
Et surtout, il nous offre une leçon d’émerveillement. À l’heure des écrans saturés, du bruit, de la vitesse, voici un film qui s’arrête devant une fleur, une phrase, un visage. Et qui nous murmure : regarde, écoute. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles…