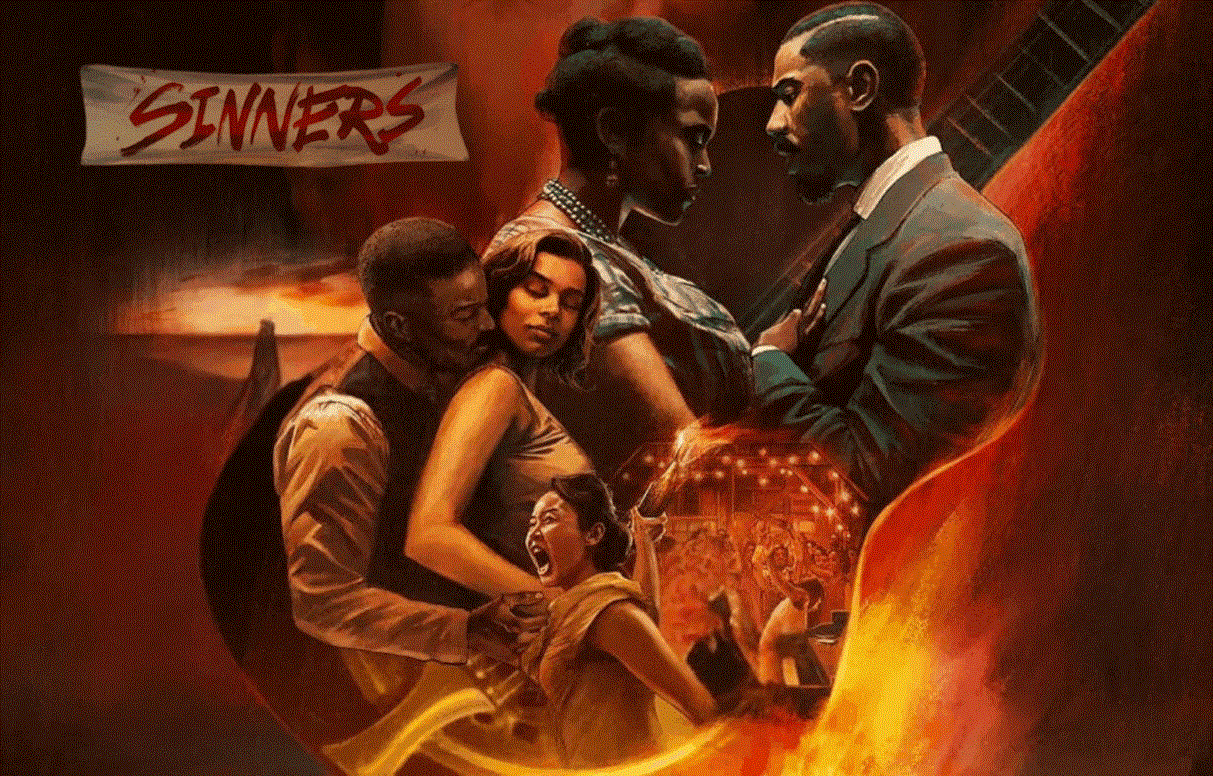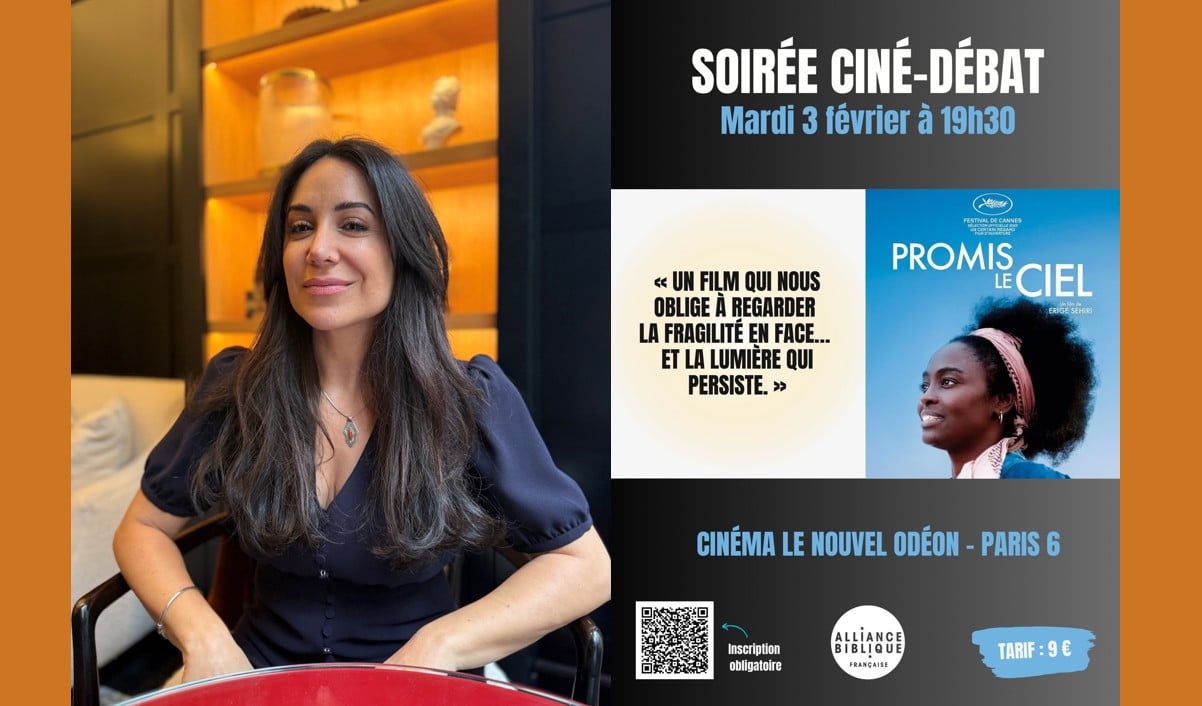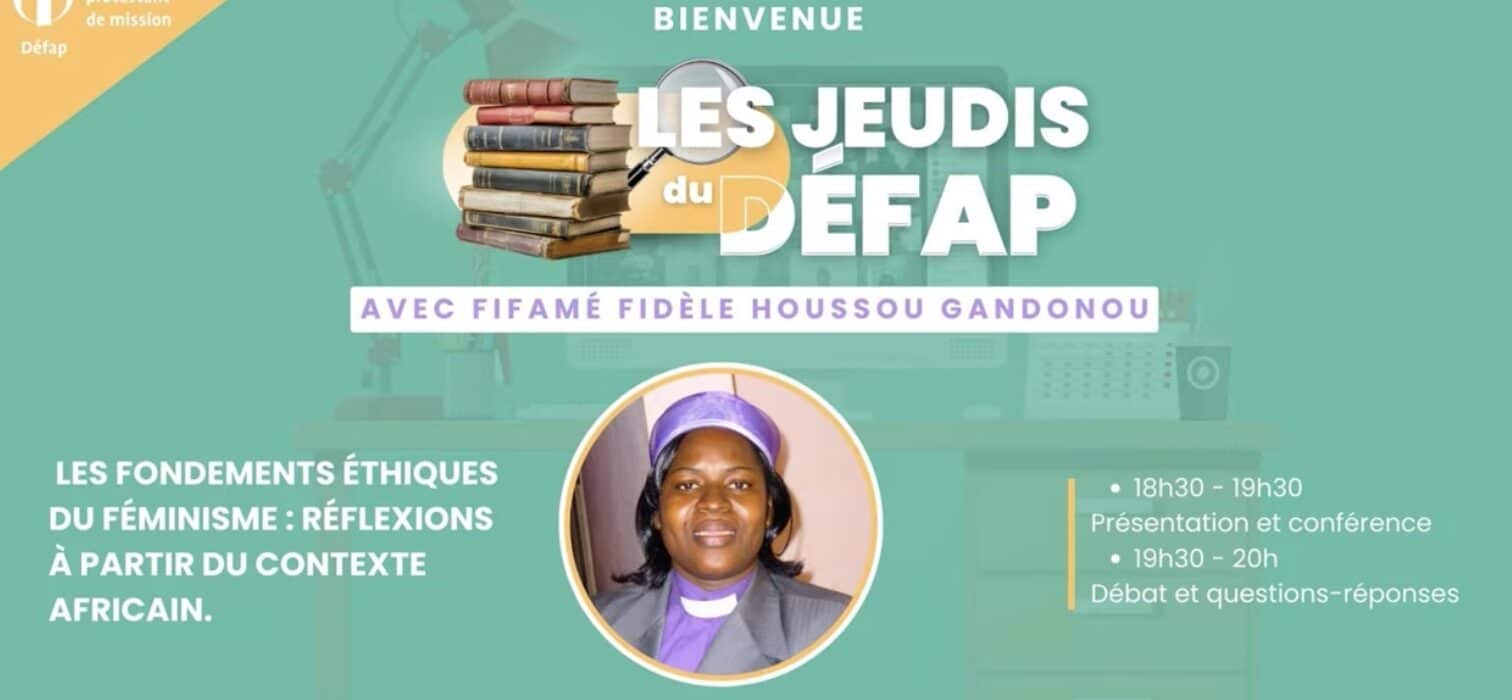Depuis le 1ᵉʳ septembre, Canal+ nous offre une vraie pépite : Empathie. Une série québécoise signée Florence Longpré, où hospitalité de la psychiatrie rime avec humanité radicale. Création originale de la plateforme Crave, la série se déroule à l’Institut psychiatrique Mont-Royal, institution fictive où Suzanne Bien-Aimé, psychiatre au passé de criminologue, accueille patients, familles, et blessures intimes avec une écoute à la fois tendre et exigeante.
Ce qui frappe d’emblée dans Empathie, c’est sa capacité à mêler les registres sans tomber dans l’excès. Florence Longpré, qui joue Suzanne, incarne une femme abîmée, pleine de doutes, mais guidée par une compassion ferme. Thomas Ngijol l’accompagne dans le rôle de Mortimer, agent d’intervention au caractère complexe, lui-même marqué par le désordre familial et la souffrance psychologique. Les dix épisodes offrent autant de portes d’entrée vers la maladie mentale – dépression, bipolarité, traumatismes invisibles – que de moments d’allégresse, d’humour presque absurde, parfois carrément grinçant. On rit, on pleure, mais surtout on écoute. Et la série ne juge jamais : elle témoigne. Chaque personnage, patient, collaborateur, famille, est dessiné avec nuance, porté par le désir de soin autant que par sa propre vulnérabilité.

Une esthétique de la proximité
La mise en scène de Guillaume Lonergan privilégie les gros plans, les silences, les corps fatigués, les gestes maladroits. L’institut n’est pas une dystopie, mais un microcosme où s’inventent des formes de solidarité inattendues. Le contraste entre la réalité brutale des diagnostics et la douceur des gestes produit une émotion forte. La lumière, les espaces confinés, les moments de silence donnent à Empathie un rythme qui respire : le spectateur est autant soignant que témoin. Empathie se révèle ainsi être bien plus qu’un divertissement ou qu’un portrait de la psychiatrie. Elle constitue une parabole du prochain, de la faiblesse assumée, de l’amour obstiné envers celui que la société préfère parfois exclure ou oublier.
- L’écoute : Suzanne et Mortimer nous rappellent que le soin commence par le silence, la disponibilité, le respect de l’autre comme être humain.
- La fragilité partagée : on comprend que le soignant peut être blessé, le patient porteur d’histoire, mais que chacun porte de la dignité, non négociable.
- La grâce non méritée : certains épisodes suggèrent que l’accompagnement, ce ne sont pas les compétences seules mais la présence désintéressée, la constance, le pardon.
L’importance d’une série qui risque
C’est aussi, très clairement, une série qui prend des risques : montrer ce que beaucoup veulent taire, explorer ce qui dérange, ne pas lisser les arrachements de parole, les fêlures. Et ce risque est justement ce qui fait sa force : elle ne cherche pas à guérir ou à simplifier, mais à faire voir, faire ressentir. Elle interroge la ligne entre culpabilité et responsabilité, entre maladie et identité. Empathie est donc une œuvre rare tant par la forme que dans le fond. Drôle, profonde, délicatement douloureuse, elle nous invite à regarder autrement la souffrance mentale, non comme spectacle, mais comme appel. Appel à la compassion, à la justice, à la présence.
Sur Canal+, c’est une lumière offerte : celle qui perce, même dans les ténèbres de l’âme. Et pour nous qui croyons qu’aimer le prochain est un commandement, Empathie est un témoignage. Celui d’apprendre à entendre les cris dissimulés, à accompagner ceux qu’on redoute et, par-dessus tout, à ne pas juger. Et la bonne nouvelle, c’est qu’une saison 2 a été commandée par Crave.