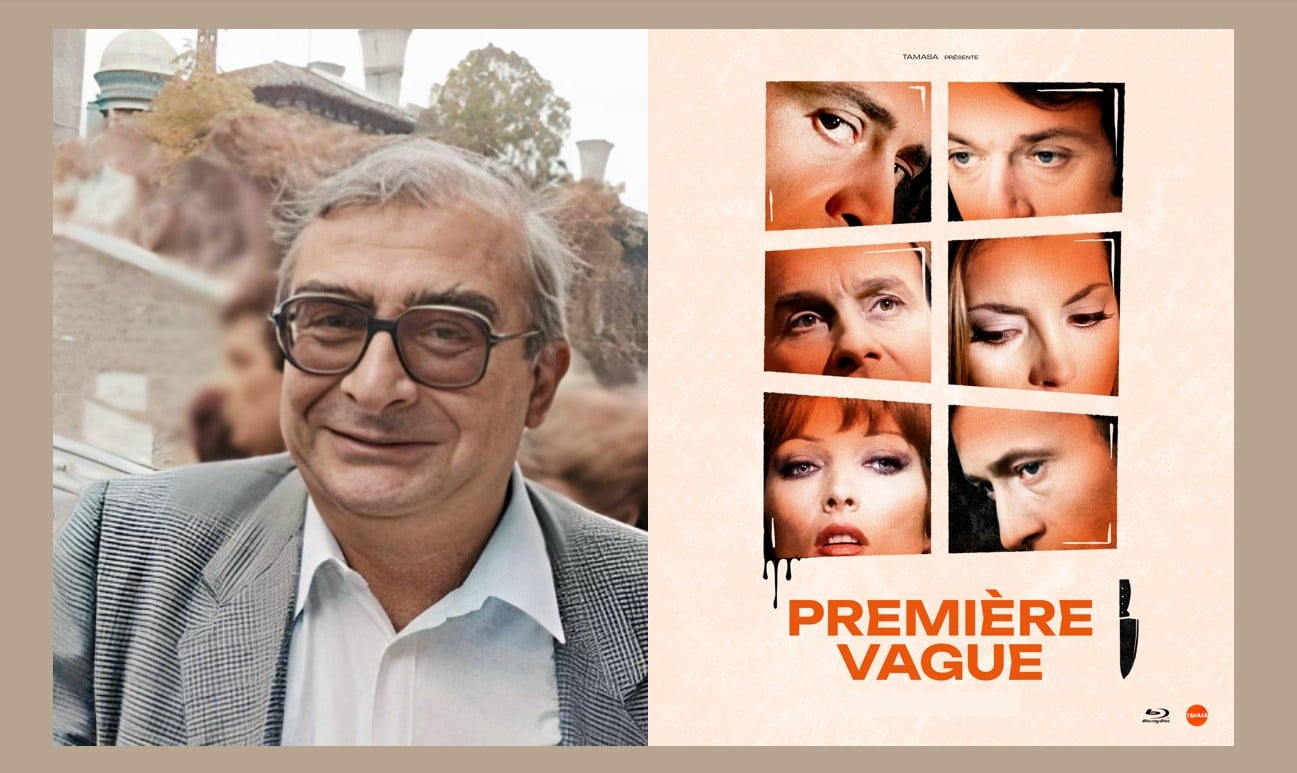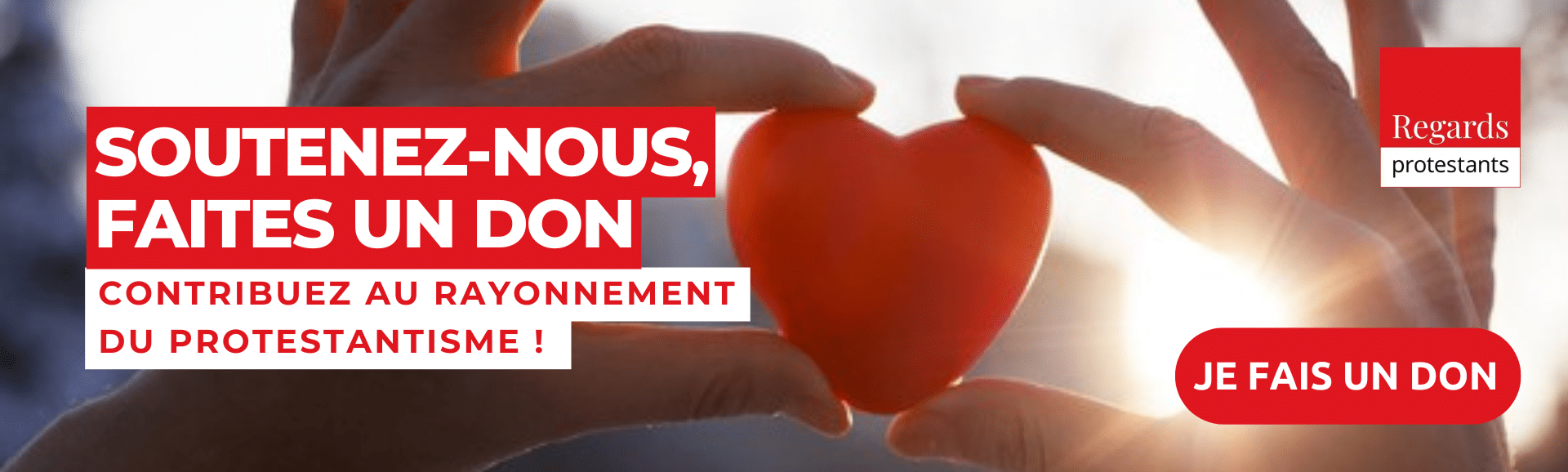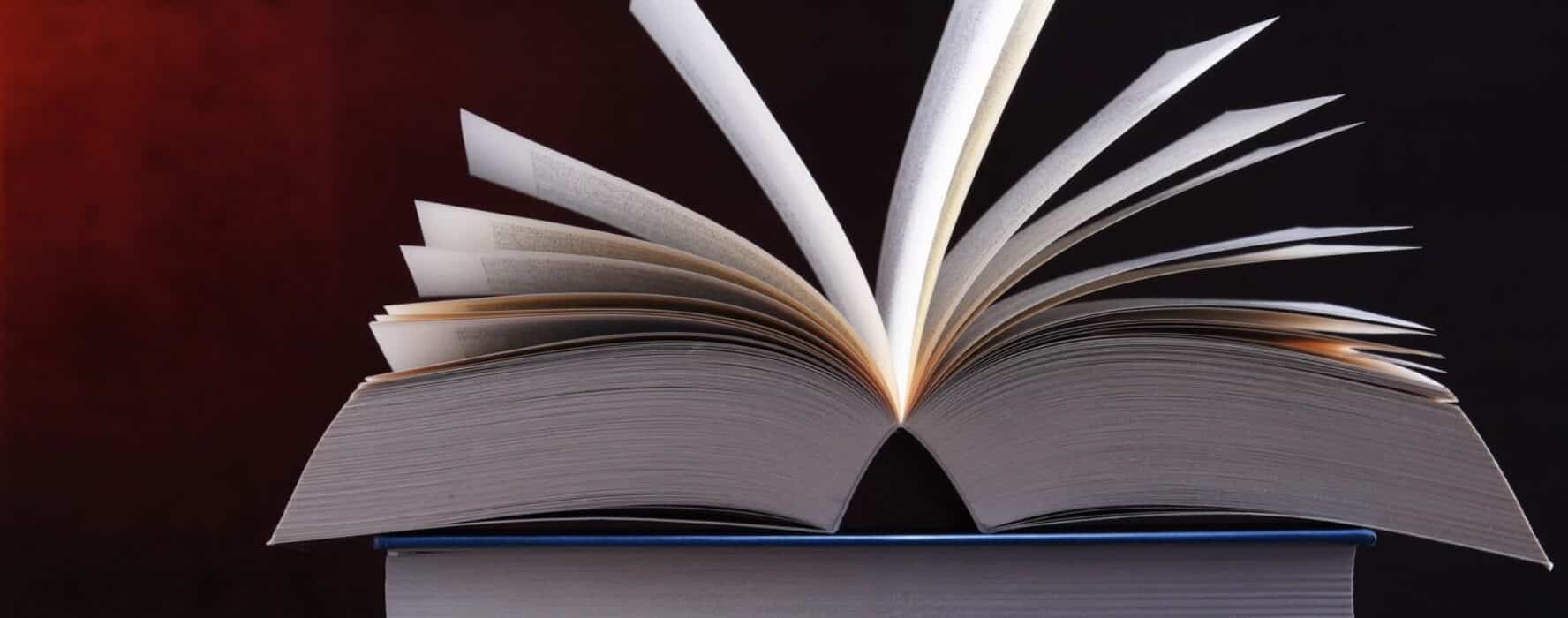Depuis sa mise en ligne sur Netflix le 25 septembre 2025, Indociles (Wayward en version originale), mini-série créée par Mae Martin, suscite autant d’admiration que de malaise, précisément parce qu’elle explore des zones d’ombre. Autorité, abus, vulnérabilité, manipulation, mais aussi réveil et espérance sont au programme de ce thriller psychologique en 8 épisodes d’une quarantaine de minutes.
L’intrigue se déroule dans une petite ville américaine tranquille, Tall Pines, mais sous cette apparence de quiétude se cachent de lourds secrets. Une académie pour adolescents “en difficulté”, dirigée par Evelyn Wade (interprétée par Toni Collette), prétend offrir des méthodes radicales pour les “réformer”. Deux jeunes filles s’enfuient, et le policier local Alex Dempsey (joué par Mae Martin), fraîchement arrivé, se met en tête de dévoiler ce qui se trame derrière les murs de l’institution. Peu à peu, ce qui semblait relever du soin et de la discipline se révèle être un système de contrôle, de coercition et de peur.
Si l’intrigue de la série est fictionnelle, elle s’inspire néanmoins d’expériences bien réelles. Mae Martin confie s’être nourri de souvenirs personnels et s’est inspiré de témoignages réels, notamment de centres de “redressement” pour adolescents ou de la « secte » Synanon. Bien que Tall Pines soit fictive, les pratiques décrites, isolement, manipulation, culpabilisation, ne le sont pas. Présentées comme des internats thérapeutiques ou des programmes de thérapie en pleine nature, ces écoles pour adolescents en difficulté ont souvent été dénoncées pour leurs méthodes brutales. Intensives et très encadrées, elles séparent les jeunes de leur famille tout en proposant thérapie, suivi scolaire et traitement de troubles émotionnels ou de dépendances. Mais de nombreux anciens élèves racontent que ces mesures, loin d’aider, ont souvent été sources de souffrance et de graves traumatismes, voire parfois de disparitions ou de suicides.

Une mise en scène troublante, au service de la tension morale
Sur le plan cinématographique, Indociles impressionne par sa réalisation sobre et tendue, signée Minkie Spiro (Downton Abbey, Better Call Saul…). Les cadrages serrés, presque étouffants, traduisent la claustration psychique des jeunes pensionnaires, tandis que les extérieurs baignés d’une lumière froide instaurent un climat de faux apaisement, où le “mal” n’a pas besoin de hurler pour exister. La bande-son, discrète mais précise, s’efface souvent derrière le silence. Ce silence pesant qui devient un personnage à part entière.
Toni Collette livre une performance magistrale. Autoritaire, charismatique, ambivalente, elle incarne à merveille cette figure de pouvoir persuadée d’agir pour le bien. En contrepoint, Mae Martin, d’une sobriété presque fragile, apporte une humanité désarmée, une empathie qui vacille entre colère et compassion. Autour d’eux, la jeune génération, notamment Alyvia Alyn Lind ou Sydney Topliffe, confère à la série une justesse émotionnelle rare. Leurs regards disent tout de la peur et du courage mêlés. La mise en scène joue ainsi un double rôle. Elle dénonce le mécanisme d’emprise tout en révélant les forces de résistance, dans un réalisme où chaque plan semble poser une question morale.
Ce qu’Indociles nous pousse à interroger
Indociles n’est pas un manifeste spirituel : elle ne propose pas de réponse « évangélique » explicite, ni de “solution de foi” fermée, ce qui peut frustrer ceux qui cherchent un récit de rédemption chrétien conventionnel. De plus, le ton est sombre, l’atmosphère oppressante, avec des scènes fortes, ce qui nécessite discernement, surtout pour un public jeune ou sensible. Néanmoins, ce réalisme cru crée aussi une ouverture à la réflexion, à la dénonciation, à l’appel à des valeurs plus profondes.
- Autorité vs liberté intérieure
Le pouvoir institutionnel veut imposer une version du “bien”, de ce qui est juste, ce qui doit être obéi, souvent sous couvert de protection. Mais la série montre que l’autorité sans écoute ni discernement devient pouvoir, oppression.
- Vulnérabilité, exclusion et dignité
Les adolescents “rebelles” deviennent ici paraboles des blessés de la vie. Ceux que l’on choisit d’isoler plutôt que d’écouter. Leur humanité, même défigurée par la peur, appelle compassion et reconnaissance, valeurs au cœur de l’Évangile.
- Le silence, le secret, la culpabilité
Indociles montre comment le secret peut devenir un instrument de domination et de manipulation.
- Espérance et résistance
Malgré la noirceur, l’espérance affleure. Dans les gestes de solidarité, dans la vérité arrachée au mensonge, dans le courage d’affronter la peur, s’esquisse une grâce ordinaire, celle d’une humanité qui refuse la résignation.
Que faut-il donc retenir de cette exploration ? D’abord, l’importance d’une autorité qui se mette véritablement au service des autres, capable de se remettre en question et de reconnaître ses limites, y compris dans les institutions religieuses ou éducatives. Une autorité qui écoute, qui accompagne, et qui ne se confond jamais avec la domination ou le contrôle. Ensuite, la valeur du silence rompu et de la vérité vécue. Une spiritualité qui ne se limite pas à des paroles ou des rituels, mais qui se traduit dans les actes, dans l’honnêteté avec soi-même et avec autrui. Cette exigence se conjugue avec la vocation de justice et de soin, qui consiste à défendre les plus vulnérables, à tendre l’oreille à ceux dont les voix sont souvent étouffées, et à agir concrètement pour alléger leurs souffrances. Enfin, il y a la liberté intérieure, cette dimension profonde où se joue le salut, ce lieu intime où la foi peut s’enraciner et s’affirmer en dépit des pressions extérieures, des contraintes sociales ou des normes imposées. C’est en cultivant cette liberté et cette conscience éclairée que chacun peut devenir capable de résistance face à l’injustice et d’engagement authentique dans le monde.
Indociles est clairement une série choc sur le pouvoir et la conscience, sur la peur et la vérité. En suivant ces “indociles” qui refusent le mensonge d’un bien autoritaire, le spectateur se découvre témoin d’une lutte spirituelle opposant ce qui pourrait se qualifier de lumière contre le contrôle, la dignité contre la peur. Une proposition qui nécessairement trouve un écho consistant dans la période actuelle que connait les Etats-Unis.