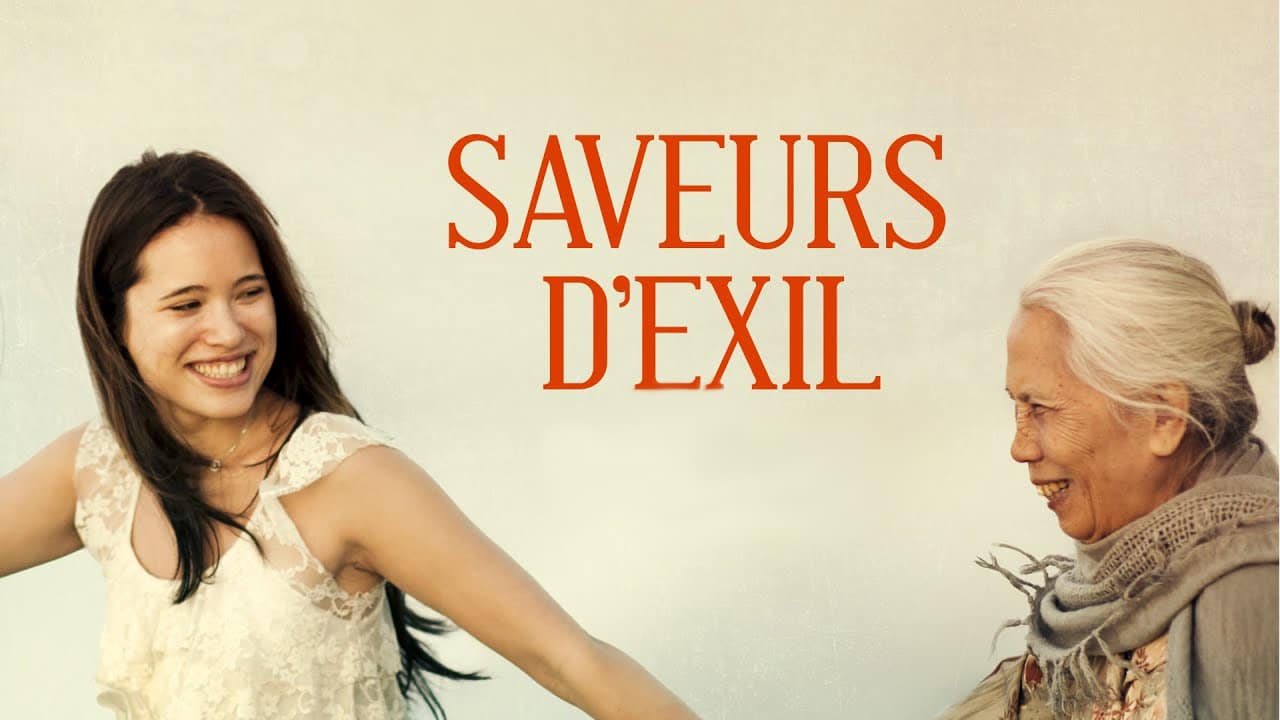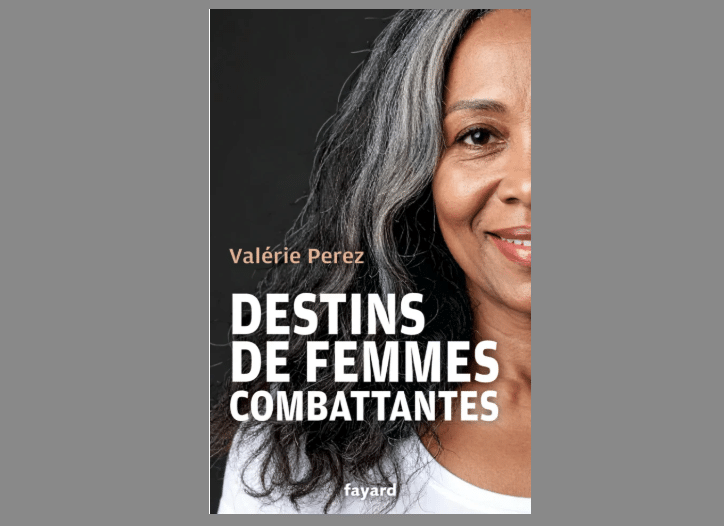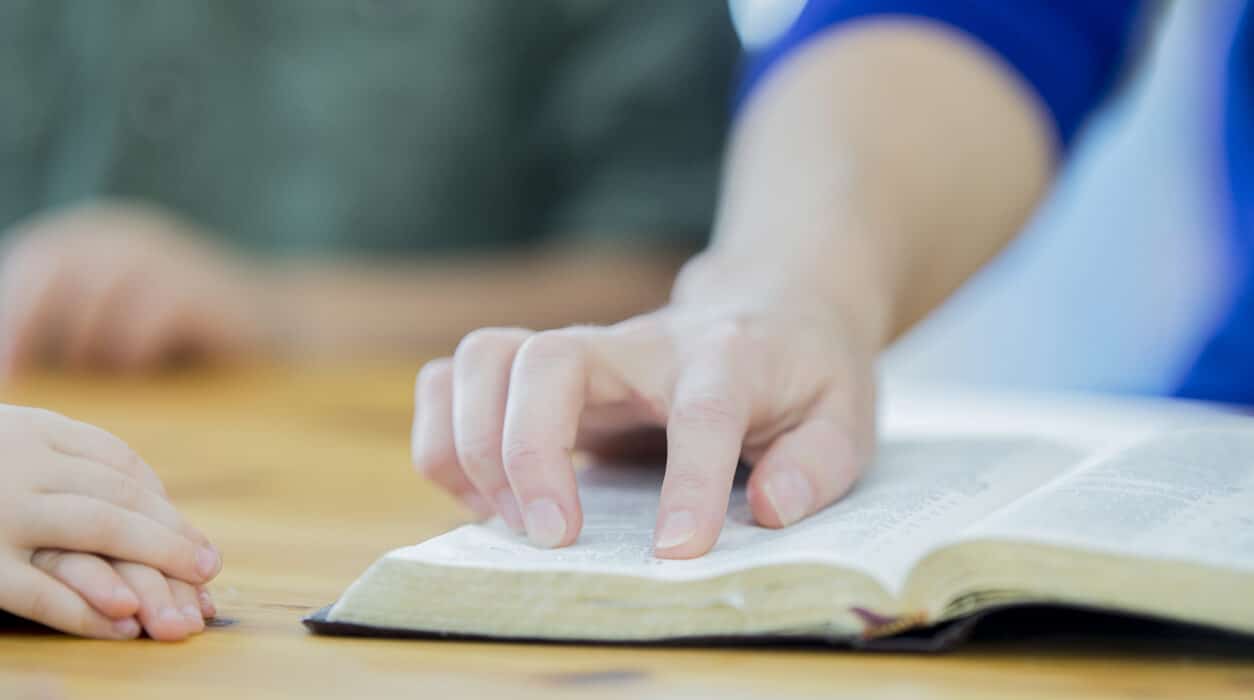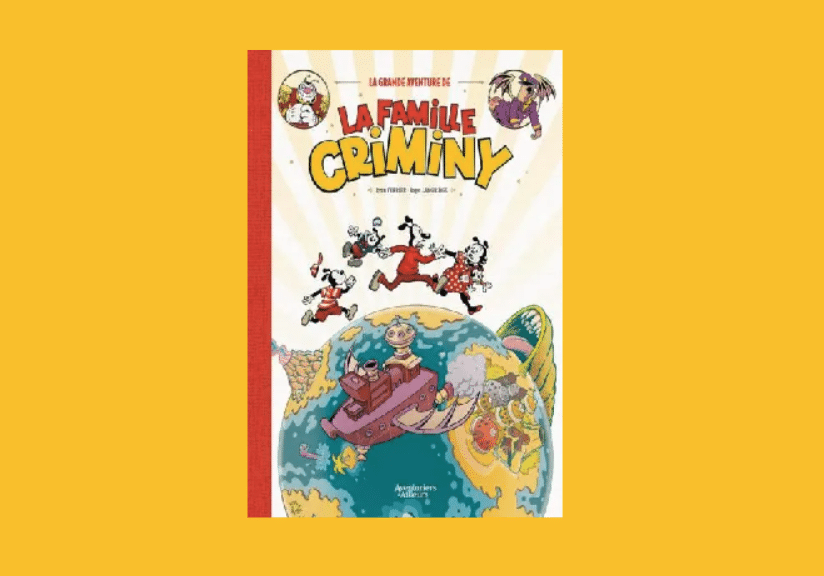Comment rendre audible l’indicible ? Kaouther Ben Hania (Les filles d’Olfa) relève ce défi dans son dernier film, en retraçant les dernières heures d’une petite fille palestinienne prise au cœur d’un conflit mortifère. Le récit s’appuie entièrement sur l’enregistrement audio de ses appels désespérés au Croissant-Rouge.
C’est cette voix tremblante d’Hind Rajab, six ans, qui supplie, décrit son environnement sous les tirs, demande qu’on vienne la chercher, qui reste là gravée à jamais. Ces 70 minutes réelles d’échange téléphonique constituent l’armature du récit. Pas de reconstitution graphique de la violence, pas de scènes de guerre, mais une plongée dans le centre des appels du Croissant-Rouge, où des opérateurs humains, incarnés par des acteurs, tentent de maintenir le lien vital. La mise en scène est minimaliste, presque ascétique. Ben Hania filme le centre d’appels comme un sanctuaire de la vie, un espace suspendu où se joue une bataille de mots. Les dialogues, parfois interrompus par l’émotion, sont portés par les acteurs et actrices qui incarnent les secouristes avec dignité et gravité. Ils ne surjouent jamais. Ils écoutent, rassurent, paniquent, parce que leur travail est moins un rôle qu’un devoir.
Maintenir le lien vital jusqu’au bout
Le choix de n’utiliser que la voix d’Hind, sans la représenter visuellement, est un geste respectueux et radical. C’est la voix fragile, enfantine qui devient le personnage principal. Chaque mot prononcé, chaque silence occupe l’espace moral d’une vie que l’on tente de sauver, mais aussi d’une vie qu’on n’oubliera jamais. La réalisatrice affirme que cette voix est plus qu’une histoire personnelle : « C’était la voix de Gaza appelant à l’aide ».

Présenté en 2025 à la Mostra de Venise, le film a reçu le Lion d’argent du Grand Jury, après une ovation de près de 24 minutes. Cette réaction témoigne de l’impact universel d’un film qui ne cherche pas seulement à dénoncer, mais à rendre vivante une mémoire.
Au-delà du drame individuel, l’œuvre est un acte de résistance. Dans un contexte où la guerre efface les corps, la réalisatrice fait le choix de préserver la voix, de la porter encore. Face à l’indifférence ou à l’oubli, le film se pose en gardien de dignité. L’appel d’Hind n’est pas juste un témoignage, c’est un cri pour être reconnu, écouté, sauvé… même après la mort.

Pour un public qui croit en la puissance de la parole, en la force du témoignage, cette œuvre résonne si profondément. Elle dit combien chaque vie compte, combien chaque voix est irremplaçable. En redonnant à Hind Rajab sa voix, le film nous invite à prendre part à son appel, non pas seulement comme spectateurs, mais comme partageurs d’humanité.