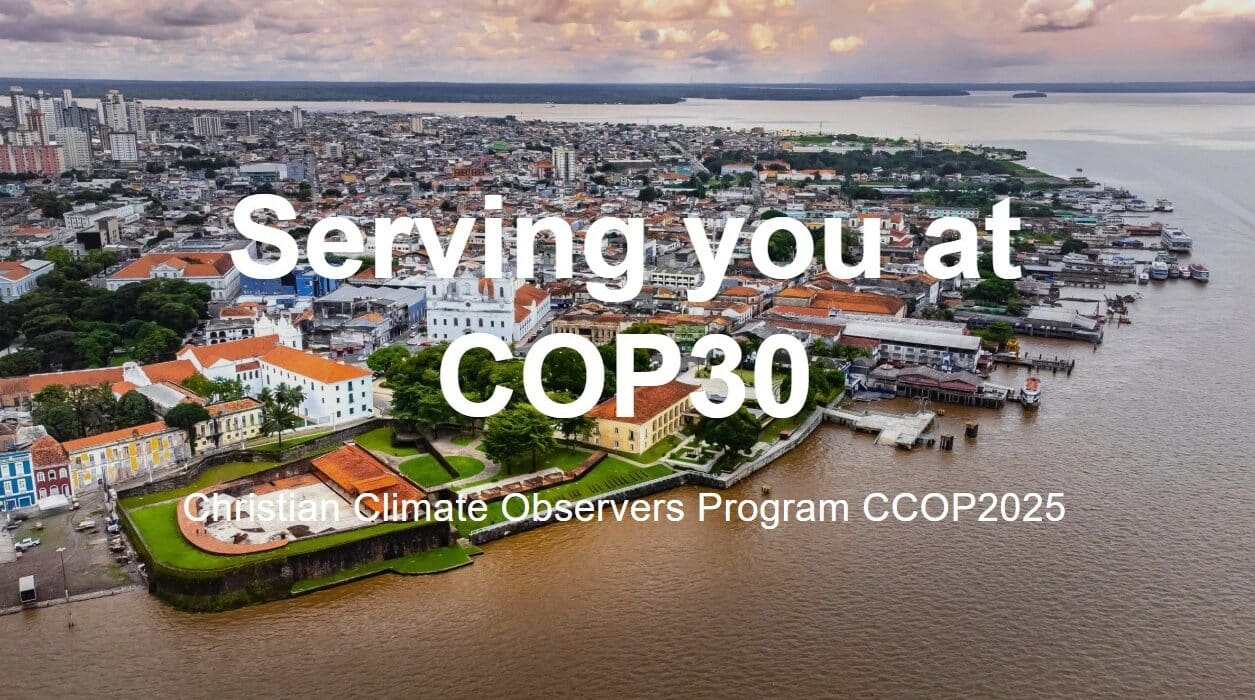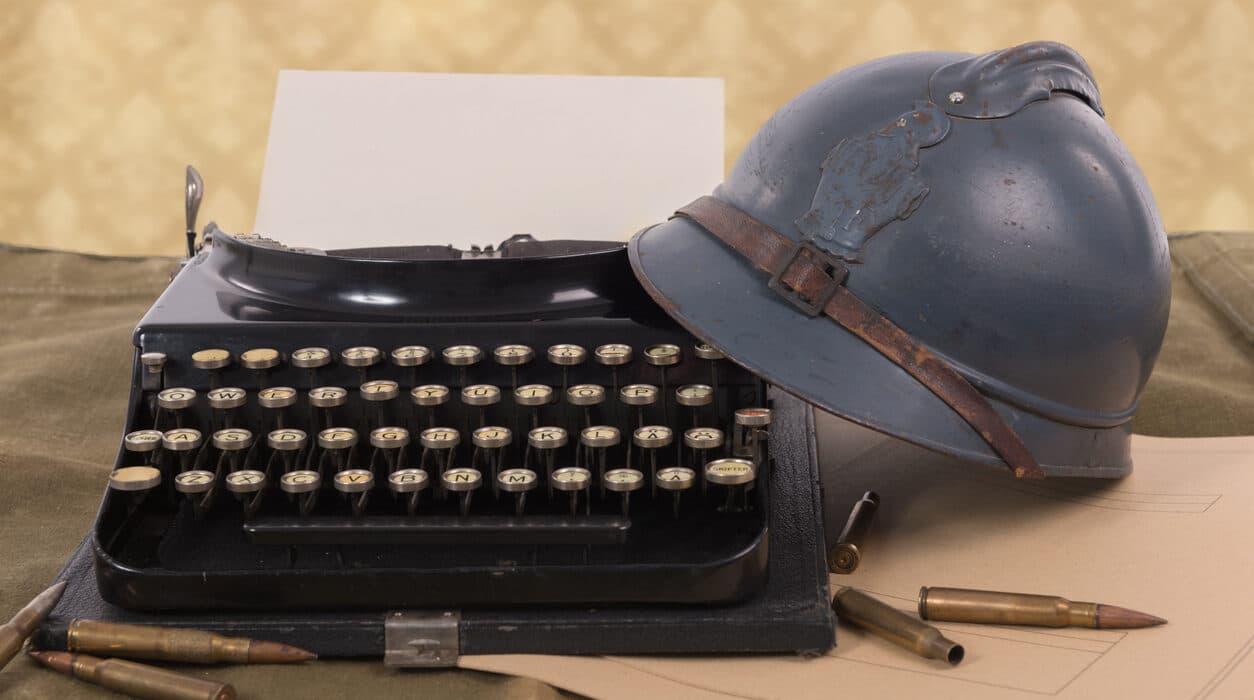Sous le vernis doré du pouvoir, Tarik Saleh filme la duplicité, la peur et la fascination. Il poursuit ainsi son exploration d’une Égypte éternellement en tension entre la vérité et le mensonge, entre le cinéma et la propagande.
George Fahmy, l’acteur le plus adulé d’Égypte, est contraint par les autorités du pays d’incarner le président Sissi dans un film à la gloire du leader. Il se retrouve ainsi plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film.
Dernier volet de la « trilogie du Caire »
Saleh poursuit avec ce film le dernier volet de sa « trilogie du Caire » (après Le Caire confidentiel et La Conspiration du Caire), en dressant une critique acérée et méditée des régimes autoritaires, de la manipulation des images et de la subordination de l’art au pouvoir. Le dispositif même du film-dans-le-film fonctionne comme une mise en abyme. George ne joue plus un rôle, il subit la mise en scène d’un pouvoir qui veut se faire crédible par l’écran. Le cinéma devient alors outil de domination, la star devient pantin.

Saleh choisit ici la voie du film noir, celle où la lumière se dépose sur la corruption des âmes. Comme dans ses deux précédentes réalisations, il scrute les visages d’hommes piégés par leurs illusions. Mais cette fois, la critique politique s’enrobe du lyrisme mélancolique de l’âge d’or du cinéma égyptien avec ses stars, ses décors, son glamour, et devient un souvenir hanté. Chaque plan semble porter la nostalgie d’un art libre désormais captif des discours officiels.
Au cœur du récit, deux pôles : George, le menteur magnifique, et le docteur Mansour, figure d’intégrité, sorte d’ange sombre qui veille sans juger. Entre eux, des femmes (magnifique Zineb Triki dans le rôle de l’épouse infidèle du général, Cherien Dabis, Lyna Khoudri) qui détournent le regard masculin et rappellent que le mystère reste leur dernière arme. Tous évoluent dans un décor somptueux, presque irréel, où le faux et le vrai se confondent.

La mise en scène, dense et feutrée, joue de l’ambiguïté
Chaque cadre semble à la fois confession et mascarade. Saleh, qui vient du documentaire, sait que la vérité n’est jamais nue… qu’elle se révèle, paradoxalement, à travers la fiction. L’Égypte qu’il filme n’est pas celle d’un régime, mais celle d’un songe fissuré, où l’artiste, comme le citoyen, apprend à survivre dans la dissimulation. L’acteur Fares Fares, dans un rôle à contre-emploi, livre une performance remarquable, donnant à voir à la fois la star et l’ombre d’un être contraint à l’ »alignement ».
Le film pose que la liberté de l’artiste est un combat, mais que la liberté de tout être humain l’est tout autant.
On peut y entendre un appel à se tenir debout dans l’image qu’on veut vous faire porter, à ne pas devenir complice de ce que l’on désavoue, à garder un regard critique, à écouter ce que vous dites et aussi ce que vous laissez voir.

Sortie en salles ce mercredi, Les Aigles de la République est un bel outil de réflexion, une boîte noire du pouvoir et de l’art. Ce film raconte l’histoire d’une servitude. Celle du créateur pris entre l’envie de dire et la nécessité de se taire. L’acteur y incarne tous les artistes contraints de composer avec l’autorité. Mais sous la surface du mensonge affleure toujours la vérité d’un cinéma capable, encore, de transformer la peur en beauté.