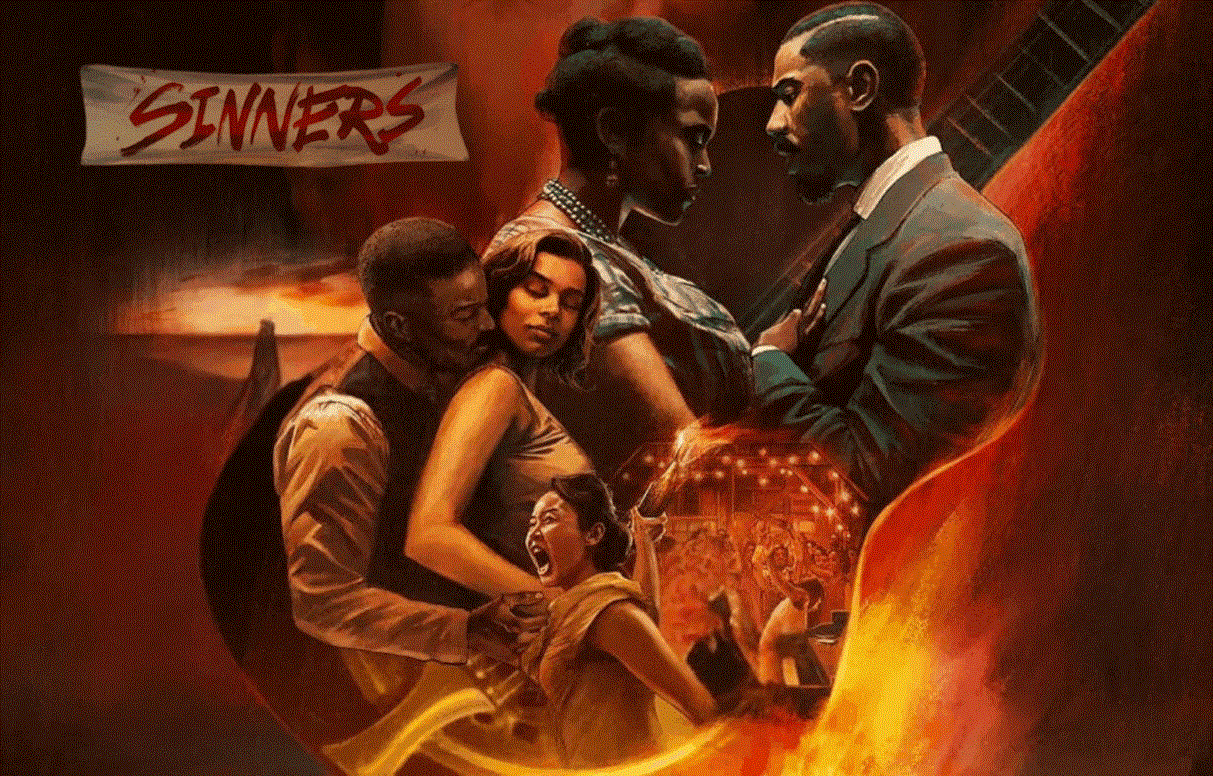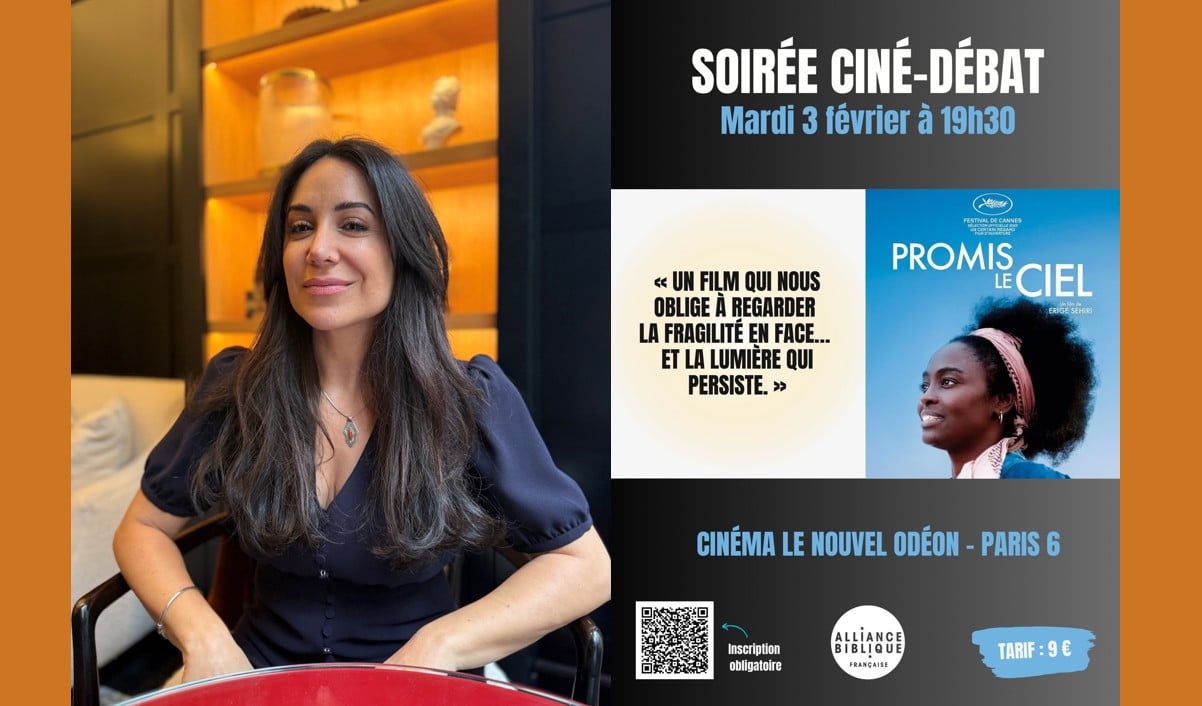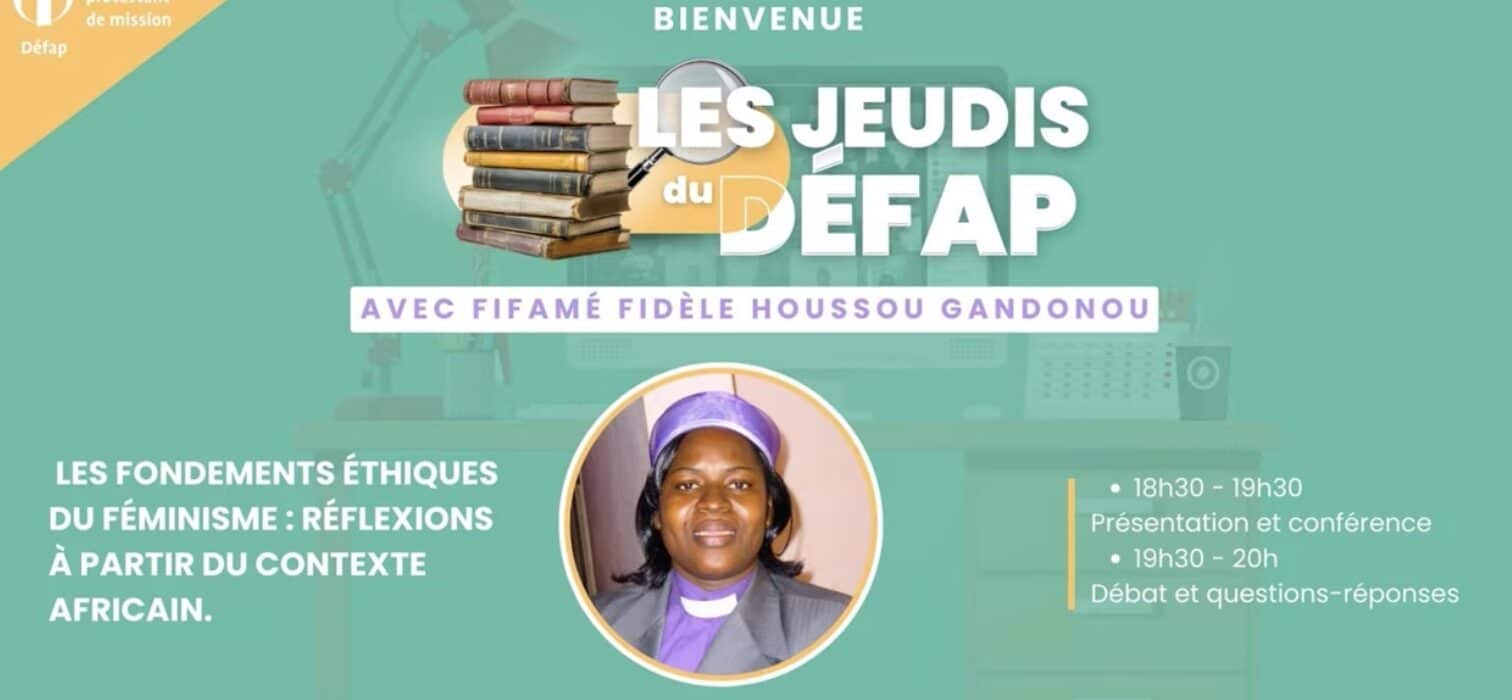Après Un monde (2021), plongée sensorielle dans la cour d’école, la cinéaste belge choisit cette fois l’hôpital comme cadre de son récit. Là où l’institution scolaire révélait la violence du groupe et les hiérarchies précoces, l’institution hospitalière dévoile, avec la même intensité, les tensions entre justice, médecine et maternité.
L’histoire est simple en apparence : Adam, quatre ans, est hospitalisé pour malnutrition à la suite d’une décision judiciaire. Sa mère, Rebecca, est autorisée à rester à ses côtés au-delà des visites grâce à la bienveillance de Lucie, infirmière en chef, qui transgresse les règles pour soutenir cette relation fragile.
La caméra à hauteur d’enfant
La simplicité du synopsis cache une densité émotionnelle et morale rare. À hauteur d’enfant, une fois encore, Laura Wandel raconte la lutte pour préserver l’essentiel : le lien vital entre une mère et son fils. La force de la réalisatrice est de filmer toujours au plus près des corps et des visages, en refusant le spectaculaire. La caméra ne surplombe jamais ; elle s’agenouille, se met à la mesure de l’enfant. Adam est à l’écran comme nous sommes à ses côtés : petit corps perdu dans un lit trop grand, souffle fragile, yeux qui cherchent. La mise en scène épouse ce rythme, alternant le silence des couloirs d’hôpital et l’intimité presque suffocante de la chambre. Pas de musique ajoutée, pas de grands effets : le silence, les respirations, les bruits de pas deviennent la bande-son d’un combat discret mais essentiel.

Le film repose sur un trio d’acteurs remarquables. Anamaria Vartolomei (Rebecca, la mère) incarne une maternité ébranlée, entre tendresse infinie et désespoir de ne pas être jugée digne. Léa Drucker (Lucie, l’infirmière) donne au rôle une gravité contenue : celle de la professionnelle qui sait ce que disent les règles, mais choisit parfois de les contourner au nom d’une vérité plus grande. Et puis, bien sûr, il y a l’enfant, véritable présence, qui porte avec son corps et son regard une intensité bouleversante.
L’hôpital comme théâtre des tensions
Ce que L’intérêt d’Adam met en lumière, c’est la tension permanente entre l’application des normes et la nécessité d’une humanité incarnée. L’hôpital n’est pas montré comme un ennemi, mais comme un lieu traversé par des contradictions : soigner l’enfant, oui, mais dans les limites de protocoles qui peuvent parfois l’éloigner de ce qui le nourrit vraiment, la présence maternelle. La justice, censée protéger, peut devenir machine à séparer. Tout le film interroge cette frontière : jusqu’où obéir à la règle quand elle contredit la vie ?

Désobéir pour soigner : le choix de l’humanité
Derrière ce récit hospitalier, l’enfant devient le centre autour duquel se rejoue une lutte universelle : protéger l’innocence contre l’emprise des systèmes, sauvegarder la relation contre la froideur des procédures. Le spectateur est invité à prendre parti : faut-il appliquer les normes, ou les dépasser ? Faut-il rester neutre, ou risquer l’engagement ? Dans une perspective chrétienne, on ne peut que penser à l’attitude de Jésus qui plaçait l’enfant au cœur du Royaume de Dieu : « Laissez venir à moi les petits enfants, car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent » (Matthieu 19,14). Dans L’intérêt d’Adam, l’enfant devient effectivement mesure de justice et de vérité.
Le bien d’Adam prime sur tout autre intérêt, qu’il soit judiciaire, médical ou administratif. Lucie, l’infirmière, choisit de transgresser les règles pour que la mère reste auprès de son fils : ce geste a valeur de parabole. Il dit que l’amour ne se réduit pas à un protocole, qu’il faut parfois désobéir pour être fidèle à l’essentiel.
Le film met aussi en lumière la figure de la vocation. Le soin n’est pas qu’un métier ; il est un appel. Lucie ne soigne pas seulement des corps, elle veille sur un lien, elle protège une relation, elle garde une flamme fragile. Dans une société où le soin est souvent réduit à une mécanique, L’intérêt d’Adam rappelle que soigner est une mission éthique et spirituelle.

Esthétiquement, Laura Wandel poursuit son choix de dépouillement radical. La caméra reste sobre, les plans sont longs, le montage laisse le temps aux émotions de naître. Cette retenue, loin de refroidir, intensifie le ressenti : chaque geste devient signifiant, chaque silence prend du poids. Le spectateur n’est pas guidé par une musique, il doit entrer dans la densité du moment. C’est un cinéma exigeant, mais d’une sincérité rare. L’intérêt d’Adam devient une sorte d’appel à la vigilance : que faisons-nous des plus fragiles ? Quels compromis acceptons-nous quand institutions et procédures écrasent la singularité d’une vie ?
Laura Wandel nous rappelle que la vérité ne se situe pas toujours du côté des règles, mais parfois dans l’acte fragile et courageux de celles et ceux qui osent les dépasser.
En ce sens, le film touche au cœur d’une éthique chrétienne : mettre le plus petit au centre, protéger coûte que coûte ce qui fait grandir la vie. Adam, par son regard, nous oblige à choisir : voulons-nous défendre les règles, ou l’enfant ?