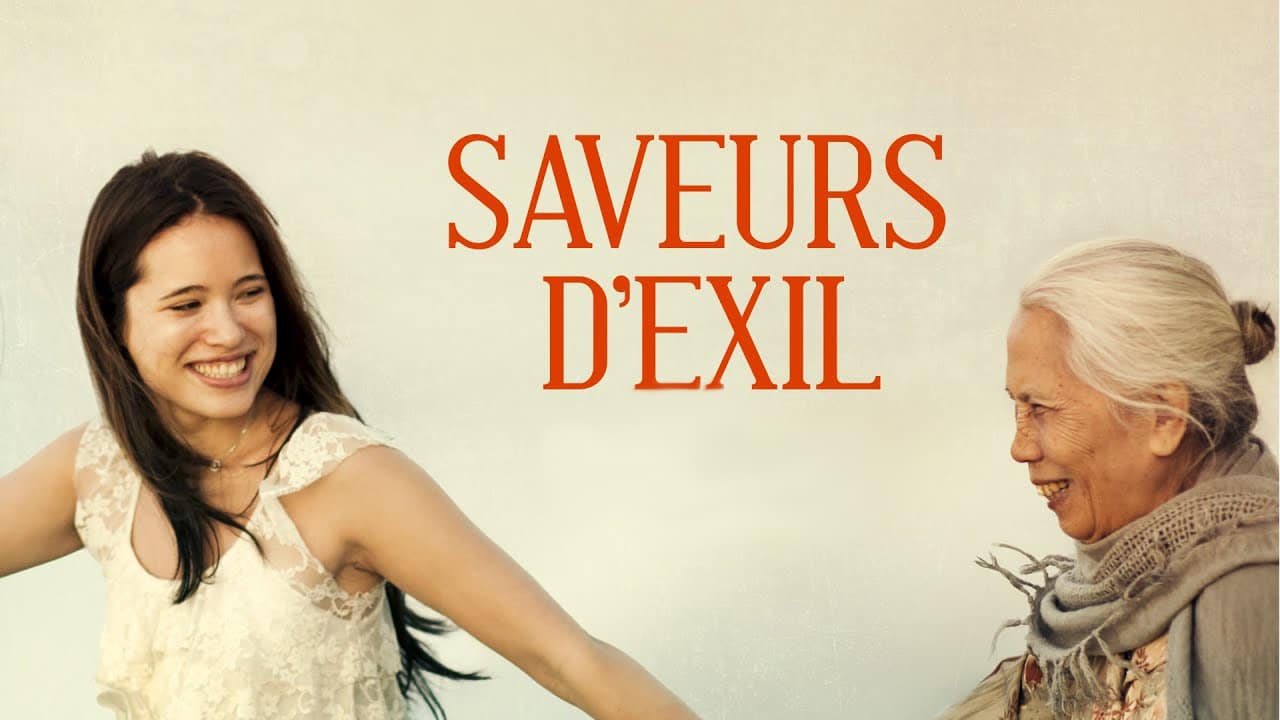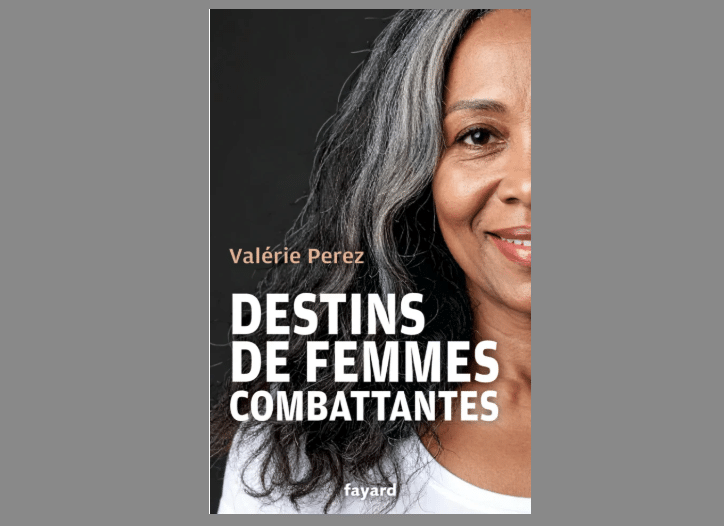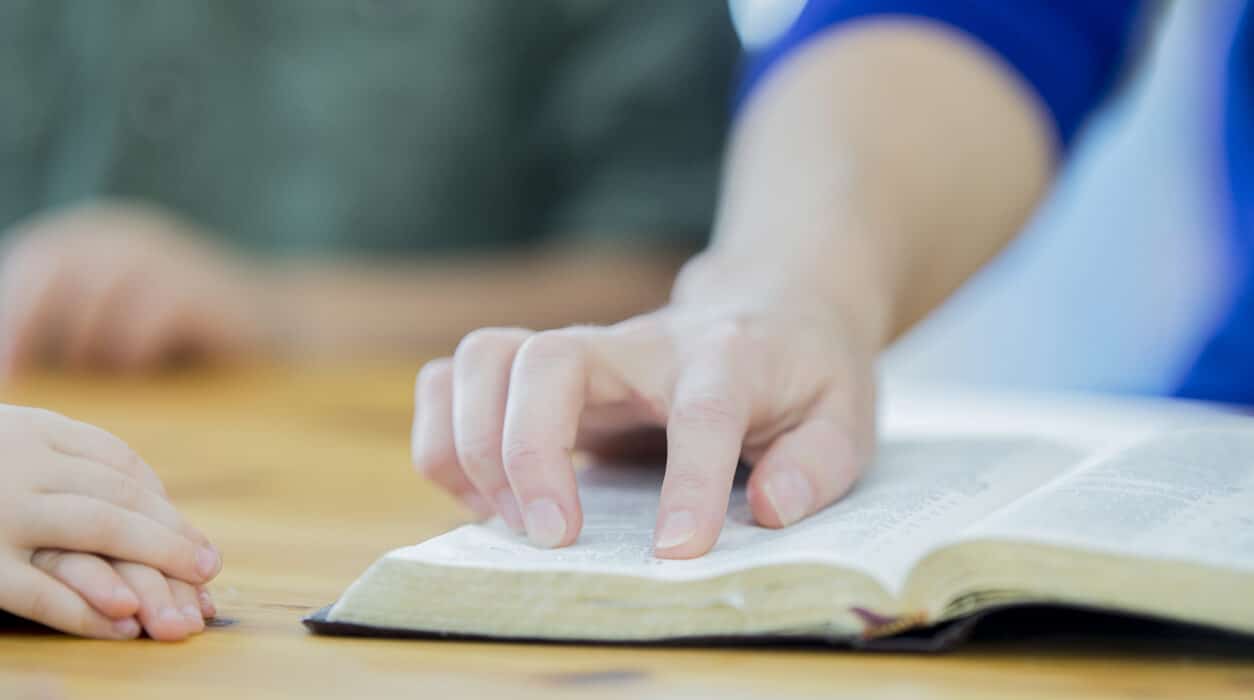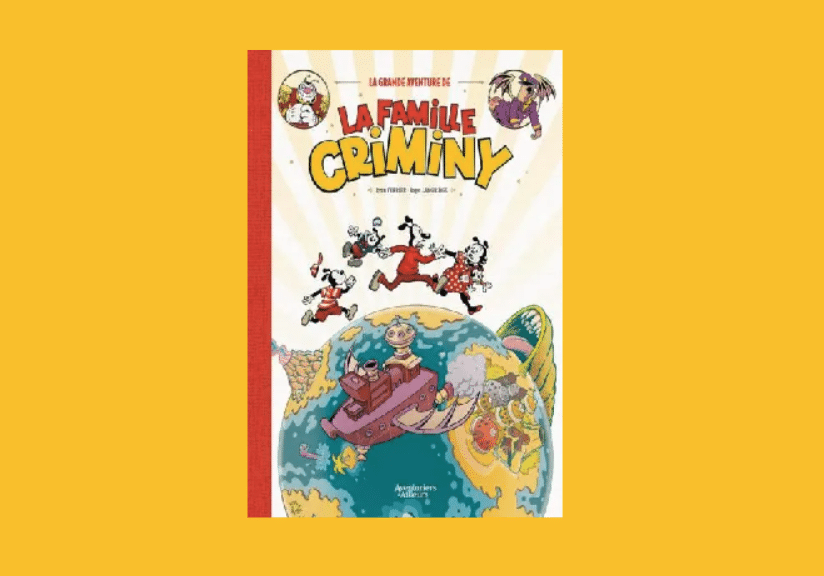Royaume-Uni, 1982. Une jeune anglo-japonaise entreprend d’écrire un livre sur la vie de sa mère, Etsuko, marquée par les années d’après-guerre à Nagasaki et hantée par le suicide de sa fille aînée. Etsuko commence le récit de ses souvenirs trente ans plus tôt, lors de sa première grossesse, quand elle se lia d’amitié avec la plus solitaire de ses voisines, Sachiko, une jeune veuve qui élevait seule sa fille. Au fil des discussions, l’écrivaine remarque une certaine discordance dans les souvenirs de sa mère… les fantômes de son passé semblent toujours là – silencieux, mais tenaces.
Le film alterne deux temporalités : le Japon des années 1950, lumineux, fragile, en pleine reconstruction après Nagasaki, mais déjà porteur de cicatrices invisibles ; et l’Angleterre de 1982, dans la maison silencieuse d’une femme vieillissante surveillant ses souvenirs. La reconstitution des années japonaises est à la fois esthétique (espaces ouverts, lumière douce, nature présente) et douloureuse : traces de destructions évitées mais présentes, regards évitant le passé, gestes de retrait. Dans la partie anglaise, Ishikawa use de l’ombre, de l’absence et du non-dit. L’adaptation choisit de déplacer le point de vue. Ce sont les mots de la fille qui ouvrent le film, qui questionnent les récits de la mère, révélant les mots manquants.
Actrices, intimité et vérité
Suzu Hirose incarne Etsuko jeune avec une grâce retenue, Fumi Nikaidō prête à Sachiko, la voisine veuve, une présence troublée. Yô Yoshida donne à la version adulte d’Etsuko une dignité douloureuse, où toute émotion semble pesée. Les personnages secondaires comme la petite Mariko, la dynamique entre femmes voisines deviennent autant de miroirs de ce que le silence forge ou effrite. Le film évite les démonstrations spectaculaires : les dialogues sont rares, les gestes simples ; les regards, les silences, les pauses. C’est dans le presque rien que s’infiltre le poids du souvenir.

Le deuil, la mémoire, la vérité
Sur le plan éthique, cette œuvre invite à s’interroger sur ce qu’on fait des traumatismes : doit-on les raconter ou les taire ? Quelle est la responsabilité qu’on porte envers les générations suivantes ? Le film résonne avec l’idée que le pardon ne peut surgir qu’à partir de la vérité, même fragmentée, et que la mémoire est une forme de service envers ceux qui ont vécu l’horreur. Le suicide, la culpabilité non résolue, le déplacement géographique sont autant de lignes de fracture, mais aussi de réconciliation possible.
Sur le plan spirituel, Lumière pâle sur les collines esquisse un chemin vers une forme de rédemption silencieuse à travers le récit, le partage des souvenirs, la reconnaissance des absences.
Le paysage du Japon post-bombardement, la maison anglaise maternelle, le jardin entretenu par mère et fille… tous ces lieux deviennent des sanctuaires du souvenir où la grâce peut percer, dans les interstices du silence.
Même si la beauté formelle est certaine, certains moments pourront paraitre didactiques. Expliciter des non-dits que le spectateur pouvait deviner aurait pu nuire à la force implicite du récit. La lenteur, parfois, semble mesurer le temps plus que l’émotion, ce qui peut laisser certains spectateurs en retrait. Mais ces choix sont aussi ceux de l’honnêteté, car le film ne cède pas au sensationnalisme, préférant la patience et la suggestion.
Une œuvre de lumière et de ténèbres
Au final, on tient une adaptation remarquable ! Kei Ishikawa réussit le pari difficile de traduire à l’écran non seulement les mots d’Ishiguro, mais l’atmosphère subtile d’un roman qui parle autant de ce qu’on retient que de ce qu’on perd. Ce film est un cadeau pour les spectateurs qui acceptent d’y entrer doucement, d’y marcher dans les ombres, mais d’y voir aussi la lumière, une lumière pâle, mais persistante. Une œuvre qui conforte cette conviction que la dignité humaine survit aussi aux blessures, que le confessionnel n’est pas spectacle, mais lieu où l’on peut entendre les voix oubliées et s’y reconnaître.