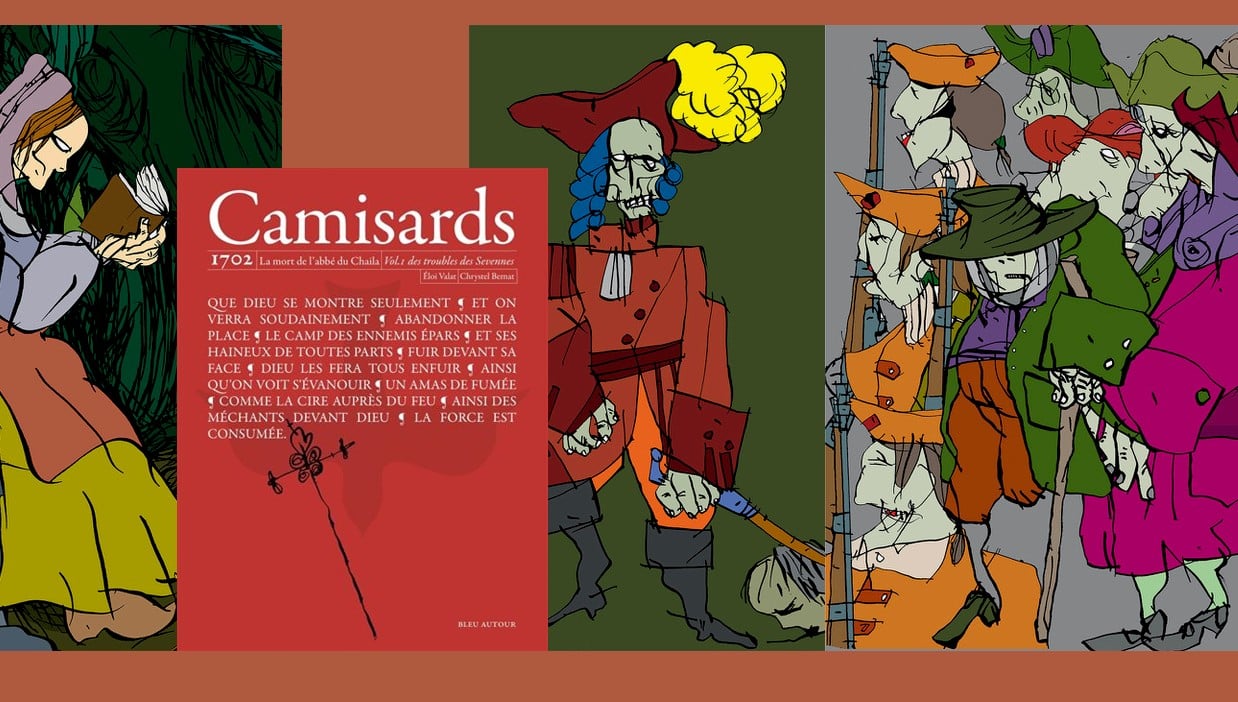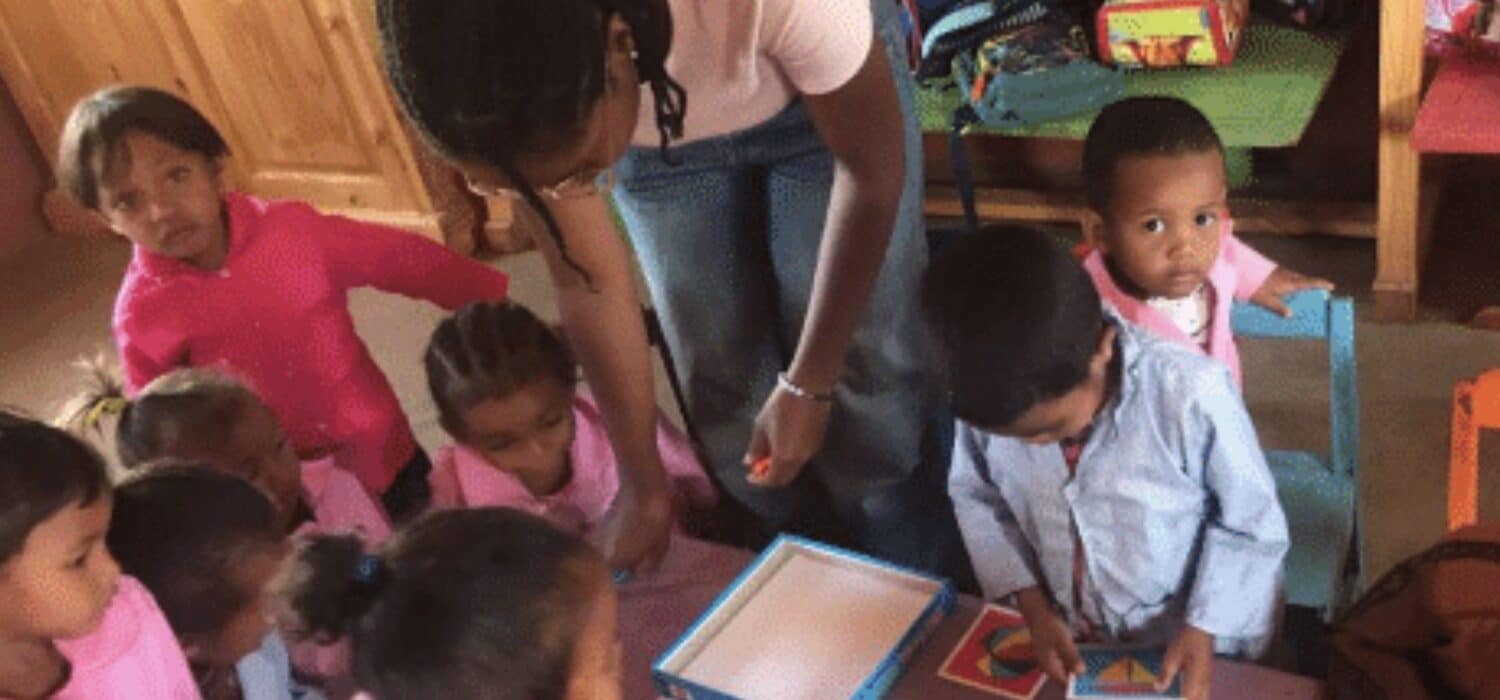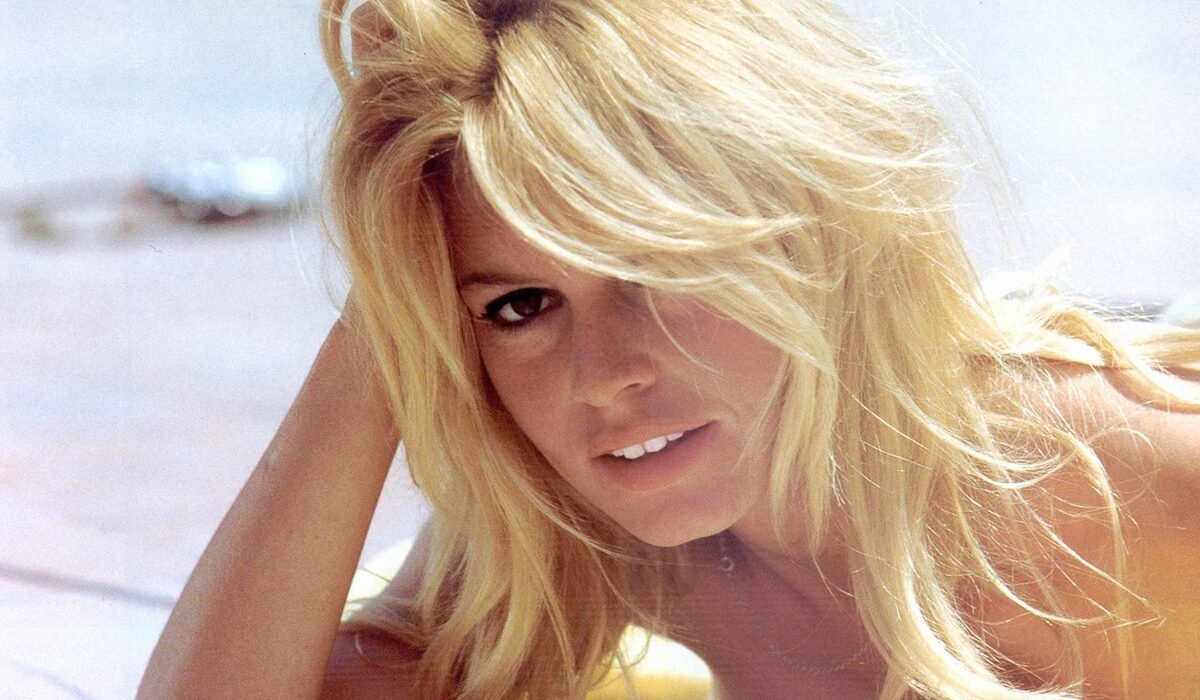Depuis le 7 novembre, Apple TV+ déploie une toute nouvelle série ambitieuse signée Vince Gilligan, l’homme derrière Breaking Bad et Better Call Saul. Baptisée Pluribus (stylisée PLUR1BUS).
Avec Pluribus, Vince Gilligan surprend en quittant les territoires criminels qui ont fait sa renommée pour s’aventurer dans une science-fiction intime, douce-amère, où la question du bonheur devient un champ de bataille. La série s’ouvre sur un phénomène étrange. Une part croissante de la population est touchée par un phénomène d’origine extra-terrestre qui fusionne les consciences humaines en une entité collective rayonnante, unie, parfaitement satisfaite. Dans ce monde soudain harmonieux, une poignée d’individus restent en marge, incapables de rejoindre cette euphorie partagée. Parmi eux, Carol Sturka, interprétée par une Rhea Seehorn magistrale, devient le cœur battant du récit.
Quand l’harmonie résonne comme une menace
Gilligan situe l’intrigue à Albuquerque, mais loin de la rugosité criminelle qui servait de décor à ses séries précédentes. Ici, la ville semble flottante, baignée d’une lumière presque trop douce, comme si l’utopie envahissait déjà l’image. Ce contraste entre beauté sereine et tension sous-jacente donne à la série une atmosphère singulière. C’est un monde qui sourit, mais où quelque chose inquiète, sans qu’on puisse d’abord en saisir la cause. Carol, elle, n’est pas infectée ; elle reste en dehors du « grand tout », prisonnière d’une solitude paradoxale dans un univers qui ne connaît plus le conflit.

Solitude métaphysique
Le titre Pluribus puise son sens dans le latin « e pluribus unum », « de plusieurs, un », conçue par Gilligan comme une boussole thématique. Ici, l’unité ne naît pas de la paix ou du consensus, mais d’une absorption forcée des individualités dans un tout plus grand, ce qui interroge, ironiquement, le prix de l’harmonie collective. La force de la série réside dans ce décalage profond entre la douceur apparente du concept et la dureté émotionnelle qu’il produit, non sans certains traits d’humour. Gilligan ne filme pas l’apocalypse, mais une apocalypse inversée… Celle où tout devient trop parfait. À travers Carol, il explore les fissures de cette perfection forcée. Son isolement n’est pas seulement social, il est métaphysique. Elle voit le monde s’unifier autour d’elle, tandis qu’elle demeure un fragment dissonant, une conscience encore libre et c’est précisément cette liberté qui devient un poids.

Les zones d’ombre derrière l’apparente quiétude
L’écriture joue subtilement avec l’ambiguïté morale. Le « collectif » n’est jamais montré comme un mal absolu. Au contraire, il semble offrir une fraternité lumineuse. Mais cette lumière a un revers. Gilligan ne juge pas, il questionne. Qu’est-ce qui fait de nous des individus ? Pourquoi tenons-nous tant à nos cicatrices ? Et à quel moment le bonheur cesse-t-il d’être un don pour devenir une contrainte ? À travers cette dystopie douce, Pluribus interroge nos rêves les plus secrets, ceux d’un monde apaisé, débarrassé des conflits et des douleurs tout en montrant qu’ils peuvent pourtant devenir dangereux. Visuellement, la série adopte une esthétique presque méditative. Les cadres sont amples, les couleurs chaudes, comme si l’image elle-même cherchait à séduire le spectateur dans cette utopie. Mais au cœur de ces paysages apaisés, la musique et le jeu des acteurs instillent une tension continue, révélant la confusion intérieure de ceux qui résistent. Cette contradiction permanente entre la forme et le fond donne à la série son identité. Une beauté inquiète, un calme prêt à se fissurer.
Avec Pluribus, Gilligan continue d’explorer la complexité humaine, mais avec un langage nouveau. Le drame ne naît plus du crime, mais de la conscience. La notion de liberté, si fragile, devient son véritable enjeu narratif. La série avance ainsi sur un fil tendu, entre contemplation et angoisse, entre poésie et vertige philosophique. C’est cette capacité à mêler l’intime et le conceptuel, le sensible et l’abstrait, qui fait de cette 1ère saison (une deuxième serait commandée) une œuvre singulière. C’est une splendide méditation sur ce que nous sommes prêts à abandonner pour être heureux, et sur ce que nous refusons de céder pour rester humains.