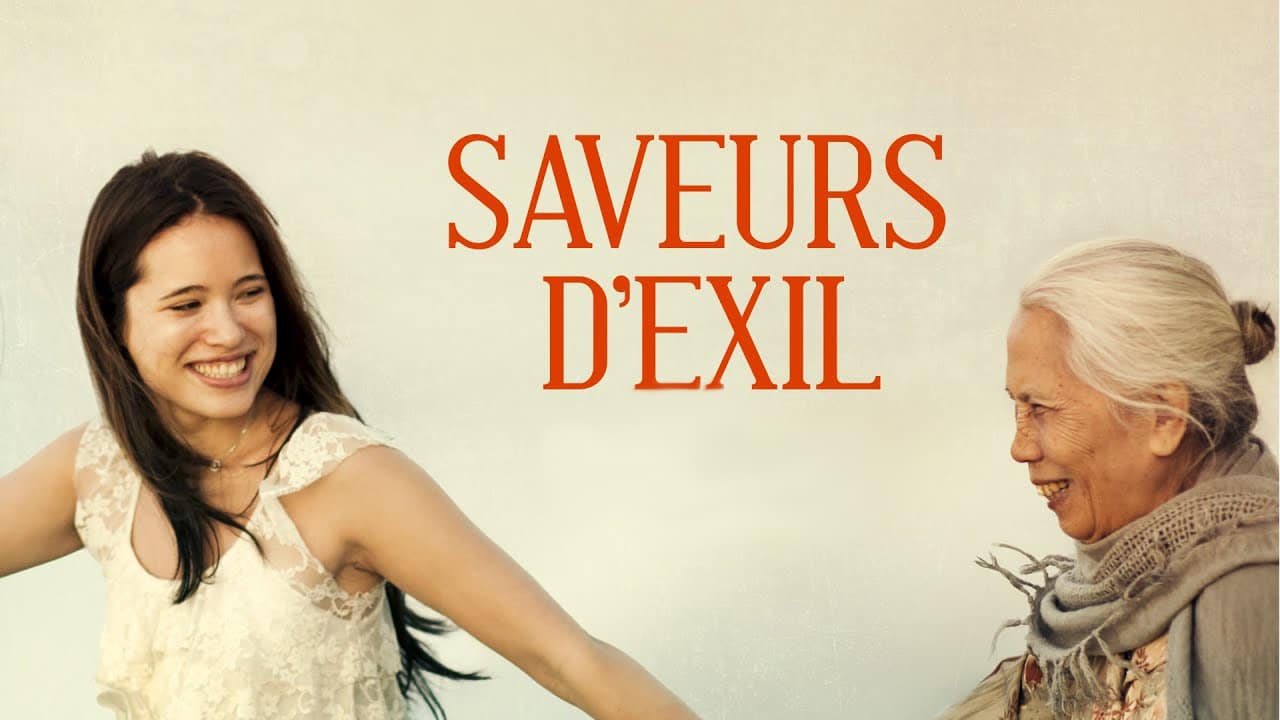Adaptation libre du roman Vineland de Thomas Pynchon, le film mêle action, comédie et politique avec un casting royal… Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Benicio del Toro, Tayana Taylor ou encore la jeune Chase Infiniti.
Leonardo DiCaprio incarne Bob, ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque vivant dans la clandestinité depuis seize ans avec sa fille Willa, jouée par Chase Infiniti, indépendante et pleine de ressources. Quand un ennemi du passé refait surface et enlève Willa, le père sort de l’ombre pour la sauver et affronter les fantômes de ses choix passés.
Entre fiction spectaculaire et critique sociale, Paul Thomas Anderson, de réputation exigeante, allie ici la virtuose mise en scène aux scènes d’action explosives. Le conflit n’est pas seulement celui des armes, mais de la mémoire, du mensonge et de l’engagement idéologique. Les anciens révolutionnaires que Bob retrouve sont devenus des silhouettes brisées ou amollies, prises dans la nostalgie, la trahison, ou l’usure du temps. Le colonel Lockjaw, antagoniste saisissant, ne représente pas uniquement un ennemi physique : il incarne la figure de l’autoritarisme et de la suprématie virile, souvent toxique, que le film démonte.

Quand les idéaux se heurtent à la réalité
La comédie et l’absurde ne sont pas absents : Anderson utilise l’humour pour souligner les outrances, les contradictions, les postures martiales grotesques. Mais derrière le sourire se trouve une colère, une interrogation éthique. Le film interroge le prix de la radicalité : que reste-t-il de ses idéaux quand ils tournent au mythe personnel ? Quand l’engagement s’isole, ne devient-il pas une prison ?

Une bataille après l’autre pose des questions cruciales autour de l’idolâtrie du passé : Bob a idolâtré une cause, des idéaux révolutionnaires, mais le film montre comment toute cause, non soumise à la réflexion, peut devenir tyrannique, perdre de vue les personnes qu’elle est censée servir. C’est aussi la responsabilité personnelle qui est interrogée. Même en marge, Bob est appelé à répondre, non seulement à son ennemi, mais à sa fille. Le film invite à regarder chaque acte, chaque engagement, non comme un slogan, mais comme une manière de prendre soin des autres et de soi. Enfin, c’est la question du pardon et de la réconciliation qui traverse l’histoire. Sans renier le passé, le film suggère que le retour sur soi est possible. On ne peut pas toujours réparer ce qui a été détruit, mais on peut accepter de changer, de se confronter au mal commis, de restaurer ce qui peut l’être.

Un film d’action habité par le doute et l’émotion
Avec ses quelques 2h40 d’intensité, le film exige beaucoup du spectateur. Parfois trop ambitieux : certaines scènes ralentissent le rythme, certaines digressions semblent superflues. Mais ces longueurs permettent aussi des respirations, des moments d’humanité inattendue, des doutes et des ruptures. Leonardo DiCaprio, puissant dans le chaos, porte une rage rentrée, fragile, belle. Willa apporte une présence silencieuse mais déterminante : elle est ce qui reste quand tout vacille.
Une bataille après l’autre est, certes, un film d’action, mais c’est aussi un film de bataille intérieure autant qu’extérieure. Il nous rappelle qu’il y a toujours des combats à mener : contre les idoles personnelles, contre les culpabilités, contre les mémoires figées. Il peut, je le crois, devenir même fenêtre d’une méditation : sur ce que signifie vivre fidèle, même dans l’échec, sur ce que signifie aimer assez pour revenir, reconnaître, pardonner. Le film invite à la bataille chaque jour, non contre un ennemi environnant, mais souvent contre ce qui nous habite.