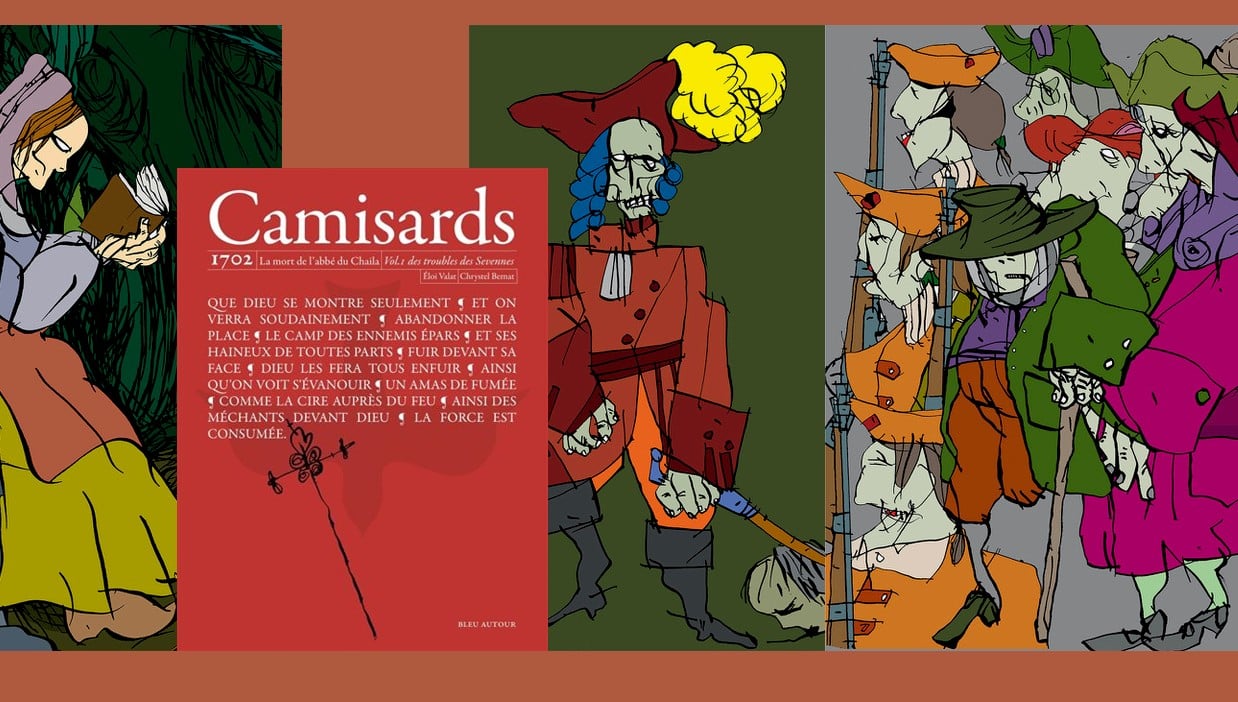Avec Une place pour Pierrot, la comédienne Hélène Médigue inaugure sa première fiction comme réalisatrice, en prise avec une réalité qu’elle connaît intimement, en particulier via son engagement associatif pour les adultes autistes. Elle est également la fondatrice de l’association « Les Maisons de Vincent », lieux de vie et d’accueil adaptés pour adultes autistes, adossés à l’agroécologie.
Camille (Marie Gillain), avocate et sœur dévouée, découvre que son frère Pierrot (Grégory Gadebois), homme autiste de 50 ans, est soumis à une médication abusive qui le pousse vers la régression. Déterminée à lui restituer sa singularité, elle le prend chez elle et entame, contre vents et institutions, une quête éprouvante pour lui trouver un lieu de vie adapté et respectueux.

Entre compassion et contraintes
L’énergie du film repose sur un équilibre subtil entre l’intime et l’engagement pour développer une fiction tendre et lucide, portée par deux interprètes vibrants de vérité. Les intentions se traduisent dans les choix de mise en scène : Médigue filme avec délicatesse l’épuisement affectif d’une femme prise entre compassion et contraintes. Marie Gillain est sobrement bouleversante, loin des clichés humanistes, sa Camille est une femme ordinaire confrontée à l’exceptionnel. Elle incarne la force tranquille, l’obstination bienveillante, la fatigue de l’aidant. À ses côtés, Grégory Gadebois, offre Pierrot en chair et en os, non comme un symbole, mais tout simplement comme un homme. Sa performance, toute en retenue, fait de son personnage un véritable compagnon de route. Médigue souligne ce lien non hiérarchique : l’acteur travaille “comme il est”, “sans convenances”, et transmet au spectateur la simplicité émotive du héros qu’il interprète.

La dignité du regard posé sur l’autisme
D’emblée, le film déploie cet horizon de dignité intime ; Camille n’aspire pas à “sauver” son frère, mais à rétablir sa place au monde. Le regard posé sur l’autisme, loin du manichéisme, est empreint d’humilité. Les scènes quotidiennes faites d’hésitations, d’instants de joie furtive, de frustrations silencieuses, composent un récit puissant. Le décor n’est jamais spectaculaire, mais toujours à hauteur d’homme, centrant la dignité au cœur de ce cheminement. Cette approche réaliste rejoint d’ailleurs une perspective spirituelle chère aux traditions protestantes : la dignité de chaque personne, l’appel à l’attention à l’autre, et la lutte concrète pour la justice sociale. Camille n’impose pas une morale, mais agit par un amour inconditionnel, un geste de grâce incarnée plus que de l’héroïsme spectaculaire. L’enfance retrouvée, au-delà des contraintes médicales, recompose la possibilité de relation authentique, libre de l’adaptation forcée.

Notre rapport à la différence
Au-delà du récit individuel, Une place pour Pierrot renvoie au soin communautaire et à l’accueil… à la responsabilité solidaire envers les plus vulnérables. Il questionne aussi notre rapport à la différence et à la place de chacun dans la cité. Par la mise en récit d’une femme aux prises avec un système qui ne voit pas Pierrot, le film invite à réorienter notre regard vers ceux que la société met de côté.
Ce film peut être vu comme un acte de présence : celle d’une sœur, d’un frère, et d’un cinéma engagé. Une œuvre capable de nous rappeler que, dans la vie réelle ou à l’écran, une place ne s’impose pas. Elle se conquiert, jour après jour, à force de patience, de vigilance et de fidélité.