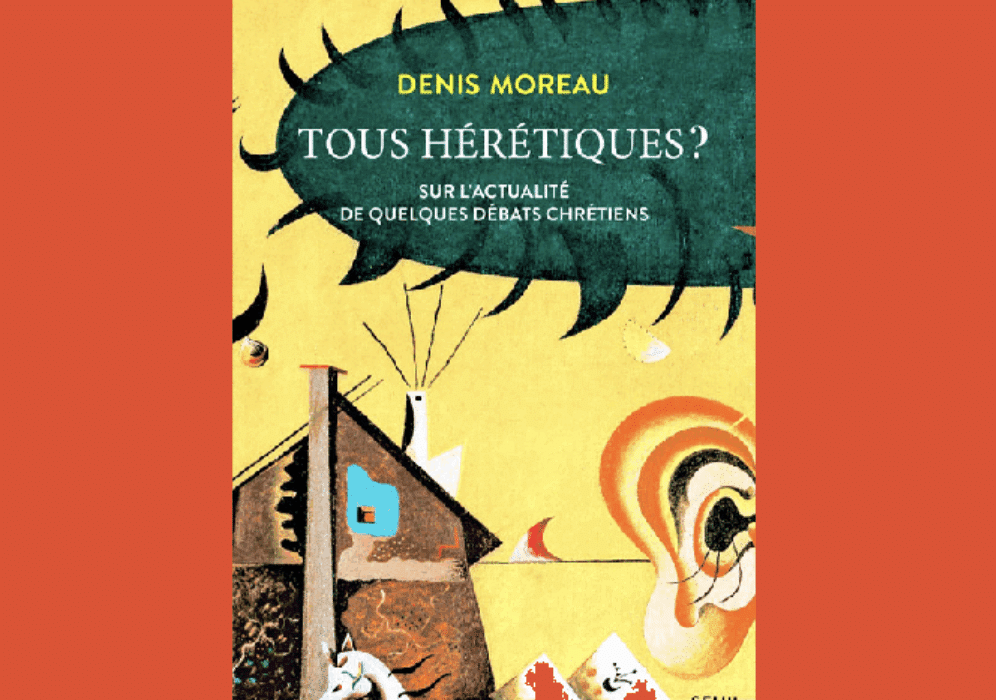Netflix continue de travailler la diversité culturelle de son offre. L’un des films qui cartonne ces jours-ci sur la plateforme vient ainsi de Turquie. Un cinéma encore assez méconnu, qui se concentre souvent sur des histoires de type « tranche de vie », et qui ne cesse de gagner les cœurs du monde entier. Des vies froissées y participera, sans nul doute, en nous plongeant au cœur de l’existence et des luttes des pauvres à Istanbul.
Dans les rues d’Istanbul, nous suivons l’histoire de Mehmet (Çagatay Ulusoy), un propriétaire d’une forme de déchetterie. Avec son ami Gonzales (Ersin Arici), affectueusement appelé Gonzo, qui est pratiquement un frère pour lui, il aide à employer des dizaines d’adolescents et d’enfants de la rue qui collectent des objets comme le papier, le verre et le plastique dans les poubelles de toute la ville. Après avoir frôlé la mort à la suite d’une insuffisance rénale, Gonzo et Mehmet prévoient d’utiliser l’argent qu’ils ont collecté au fil des ans pour réaliser les objectifs de Gonzo. Mais ce soir-là, Mehmet découvre un jeune garçon nommé Ali (Emir Ali Dogrul), dans l’un des conteneurs à déchets. Mehmet prend Ali sous son aile. Il devient pour Ali la figure paternelle qu’il n’a jamais eue et, ce faisant, il doit affronter sa propre enfance traumatisante.
Au travers d’une histoire poignante, Des vies froissées est l’occasion d’aborder de nombreux sujets de société tels que la maltraitance des enfants, les traumatismes, la maladie, les figures du père et de la mère et bien sûr la pauvreté. Certes, des thématiques qui pèsent… mais qui, ici, sont très bien traités car empreintes d’une forte intensité et ancrées dans la réalité culturelle d’une ville.

Ulusoy déverse également toute son émotion dans son personnage et parvient ainsi à nous accrocher de bout en bout. Il interprète parfaitement son rôle, cet homme profondément gentil, attentif et généreux, bien qu’il ait été un « enfant des rues » pendant la majeure partie de sa vie. Il veille sur sa famille de substitution et partage avec elle tout ce qu’il peut. Mais son enfance tumultueuse et les années qui ont suivi dans les rues d’Istanbul l’ont aussi profondément traumatisé. Ulusoy capte tous les états émotionnels variés de Mehmet, sa volatilité, sa joie extatique, sa douceur, son impuissance, sa rage, sans aucun faux-semblant. Quant à Dogrul, il est tout à fait à la hauteur. Il possède de réelles compétences et aptitudes à son jeune âge qu’il est capable de dominer des scènes où il joue aux côtés d’acteurs adultes beaucoup plus expérimentés. Il m’a rappelé fortement le jeune Zain al-Rafeea, découvert dans Capharnaüm, et que l’on aura d’ailleurs le plaisir de revoir très prochainement dans le nouveau Marvel, Eternals, réalisé par Chloé Zhao où il se retrouvera aux côtés de Richard Madden, Salma Hayek ou Angelina Jolie, à l’âge de 16 ans aujourd’hui.
Ersin Arici, enfin, joue Gonzo, l’ami le plus proche de Mehmet. Ensemble, ils se débrouillent seuls depuis de nombreuses années. Gonzo est responsable mais il aime s’amuser. Il ne se vexe pas non plus, même quand il le pourrait. Il tient beaucoup à Mehmet. Arici est un excellent contrepoids au Mehmet d’Ulusoy. Ils forment aussi un second duo dans l’histoire qui participe à témoigner de la force d’un amour fraternel qui fait chaud au cœur.

Quelques mots aussi pour évoquer la cinématographie excellente du réalisateur Can Ulkay. Il utilise de longues prises de vue, souvent aussi caméra à la main, et complète son travail d’une parfaite utilisation des gros plans aux bons moments, rendant les émotions encore plus fortes. La photo est aussi de la partie… et les couleurs et l’éclairage des scènes, notamment celles de nuit, sont magnifiques. Il faut dire que l’ambiance de Des vies froissées est volontairement sombre bien que, même les bidonvilles, avec les squatters et les enfants qui snifent de la colle, soient lumineux et colorés pendant la journée, baignés par la douce lumière méditerranéenne. La ville d’Istanbul devient ainsi un personnage supplémentaire, une étude de contrastes – bordée par le clapotis des vagues, reliée par des ponts modernes, parsemée de cafés aux allures parisiennes, et avec ses appels à la prière dans les haut-parleurs. C’est un endroit où, dans ce récit, les hommes s’appellent affectueusement « frère », mais où une multitude de garçons vivent apparemment dans la rue, abandonnés, fuyant parfois la violence et soumis à la drogue. Un thème récurrent est le besoin qu’éprouvent ces garçons et ces hommes d’une figure maternelle aimante et protectrice. Une musique traditionnelle atmosphérique crée également l’ambiance dans plusieurs scènes, notamment une séquence mélancolique où l’on s’éloigne des urgences en voiture tandis qu’une voix à la radio chante : « Je m’oppose à mon cruel destin… à cette agonie sans fin ». Le musicien traduit ici exactement les sentiments de Mehmet.
Et puis il y a, bien évidemment, la fin… qui rend l’histoire encore plus intéressante. Une issue magnifique qui met en lumière tous les ajouts subtilement obscurs dans la réalisation, le jeu des acteurs et l’écriture que les spectateurs auraient pu brièvement remettre en question au fur et à mesure que les événements se déroulaient plus tôt dans le film. Mais vous n’aurez qu’à regarder pour découvrir les détails de tout cela car, sur ce point… je me dois de faire silence et vous laisser simplement cheminer dans cette belle histoire et vous laisser peut-être surprendre et, sans nul doute, toucher.