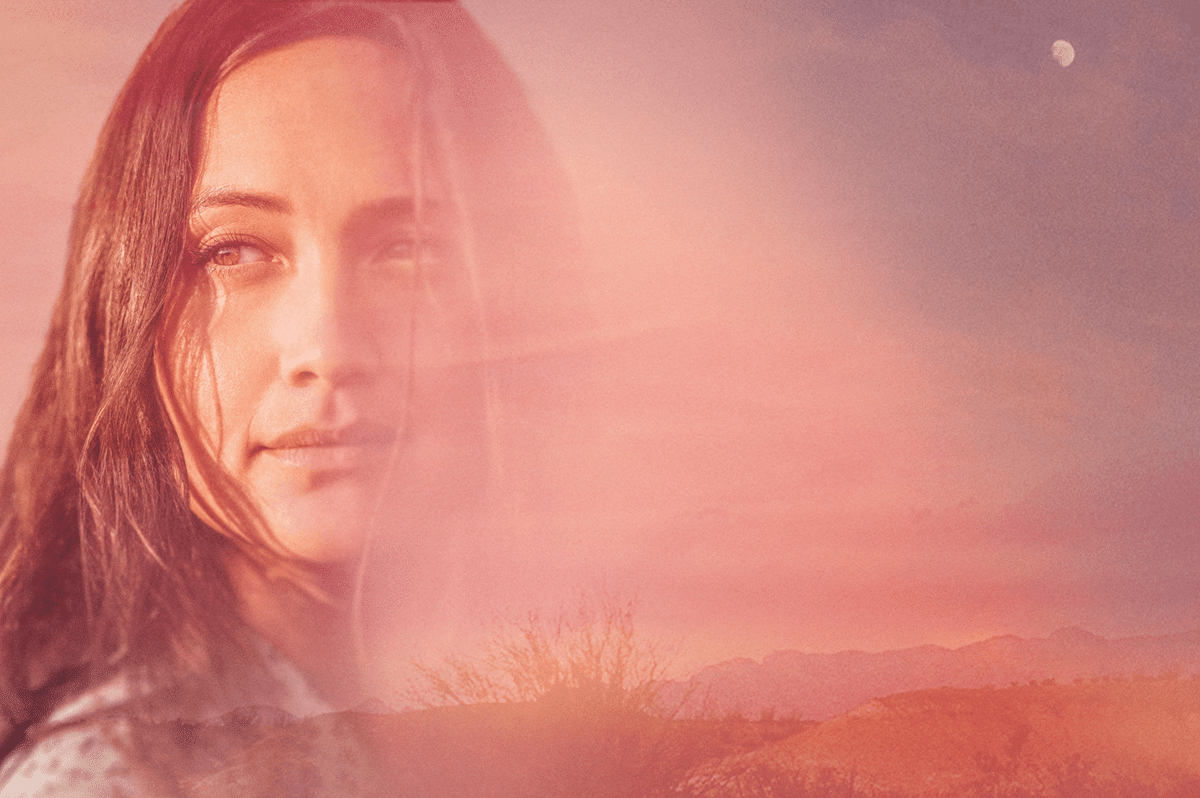Dieu est une femme était initialement le nom d’un documentaire que Pierre-Dominique Gaisseau réalisa à la suite de son expérience de vie avec les Kunas, indigènes panaméens, qu’il reconnaît comme une communauté potentiellement matriarcale. Nous sommes en 1975. Quelques années plus tôt, le réalisateur français avait filmé une expédition en Nouvelle-Guinée, où il avait reconnu un territoire vierge – et donc hostile – à la civilisation européenne et entièrement dominé par les habitants de la région. C’est de cette rencontre qu’est né Le ciel et la boue (1961), documentaire pour lequel il a reçu un Oscar.
Les années 1960 et 1970 marquent l’essor du cinéma ethnographique, symptôme des différentes indépendances que les colonies acquièrent progressivement vis-à-vis de l’Europe.
Non seulement la longue période d’appropriation territoriale et d’anéantissement culturel prenait fin, mais une dénonciation symbolique des politiques expansionnistes s’était répandue à l’échelle mondiale. Le monde occidental commence à éprouver un sentiment de conscience et de remords. En ce sens, les documentaires ethnographiques, pour certains cinéastes, compensent cet esprit d’aventurisme et de colonisation profondément ancré. Ainsi, l’appropriation des terres s’échange contre l’exploitation de l’image de certaines communautés.
Un film perdu puis retrouvé
Dieu est une femme, cette fois-ci d’Andrés Peyrot, sort ce mercredi 03 avril. Il raconte, quant à lui, le processus de sauvetage du film perdu de Gaisseau. Le documentaire n’a jamais été achevé faute de financement et d’une faillite qui a suivi. Cinquante ans plus tard, les Kunas attendent toujours de découvrir « leur » film, devenu une légende transmise par les plus anciens aux plus jeunes. Un jour, une copie cachée est retrouvée à Paris…
Si l’histoire elle-même est fascinante, le réalisateur Andres Peyrot soulève, en 1h25, de sérieuses questions sur les normes éthiques de la réalisation de films documentaires. Car, ce n’est pas tant la demande et la rencontre avec la mémoire filmique qui est stimulante dans ce film, mais plutôt l’état de réflexion promu par les membres de la communauté Kuna et qui s’opère au fur et à mesure des recherches sur ce bien culturel.
Il est émouvant de voir Peyrot projeter le documentaire original aux Kunas, qui veulent, non seulement, voir comment ils sont représentés dans le film, mais aussi leurs proches qui sont, d’une certaine manière, ramenés à la vie.
Il est émouvant de partager leur joie, leur excitation et leurs larmes lorsqu’ils voient les membres de leur famille et leurs amis, aujourd’hui décédés, projetés sur un écran de fortune. C’est le genre de séquences inestimables qui revêtent une grande importance historique et culturelle pour un peuple fier, mais qui s’accompagnent aussi d’une dose de douleur.
Le regard de la communauté Kuna
Le film de Peyrot réfléchit à la construction d’une identité. Au-delà de la récupération du film, ce qui préoccupe les Kunas, c’est son contenu et l’intentionnalité de l’enregistrement : que dit-on des Kunas, sur quelle idéologie se construit ce regard, à qui s’adresse le documentaire, et ce qu’a produit Gaisseau peut-il être considéré comme un outrage ou une exploitation culturelle alors qu’il s’agit de la première mémoire audiovisuelle de la communauté ?
Ce sont des questions qui s’insinuent et auxquelles on répond en observant une génération Kuna, jeune et âgée, consciente de son identité, qui comprend certaines choses, comme le machisme, une réalité contraire au fantasme que Gaisseau a imaginé – ou forcé – dans son documentaire.
La partie la plus intéressante du film de Peyrot se situe sans doute ici, dans la manière dont plusieurs Kunas sont blessés par la façon dont Gaisseau a déformé les récits et les traditions pour les faire paraître plus « primitifs » aux yeux des spectateurs occidentaux, et comment l’agenda personnel ou les préjugés d’un cinéaste peuvent l’amener à façonner son projet pour qu’il corresponde à sa propre vision.
La frontière entre l’art et l’empathie est ténue, surtout lorsqu’il s’agit de sujets réels qui n’auront peut-être jamais leur mot à dire sur la manière dont ils sont dépeints. Pour le réalisateur Andrés Peyrot, la valeur du film initial est « essentiellement mémorielle : ses images ont une énorme valeur personnelle et familiale pour la communauté. En plus, elles sont esthétiquement très belles. En revanche, la dimension ethnographique que le cinéaste revendiquait laisse sans doute à désirer. Il y a beaucoup de raccourcis. Le film obéit à certains canons de l’époque, au mythe romantique de retrouver des populations qui auraient totalement échappé au progrès, ce qui n’est évidemment pas le cas. »

Sur la dimension spirituelle du titre Dieu est une femme, Peyrot explique que dans la spiritualité des Kunas, les forces créatrices, qu’on pourrait apparenter à Dieu, sont duelles. Tout est fondé sur l’équilibre entre les forces, la force spirituelle masculine et la force spirituelle féminine. Cependant, il est vrai que les rites d’initiations sont réservés aux femmes et que ce sont les femmes qui possèdent les terres : c’est ce que l’on pourrait appeler une société « matrilocale », un terme que Gaisseau finira par utiliser lui-même à la fin de sa vie.
Si le film souffre légèrement de la lenteur de son rythme, il réussit néanmoins à capturer un véritable sens de la culture et du lieu tout en suscitant un débat éthique.