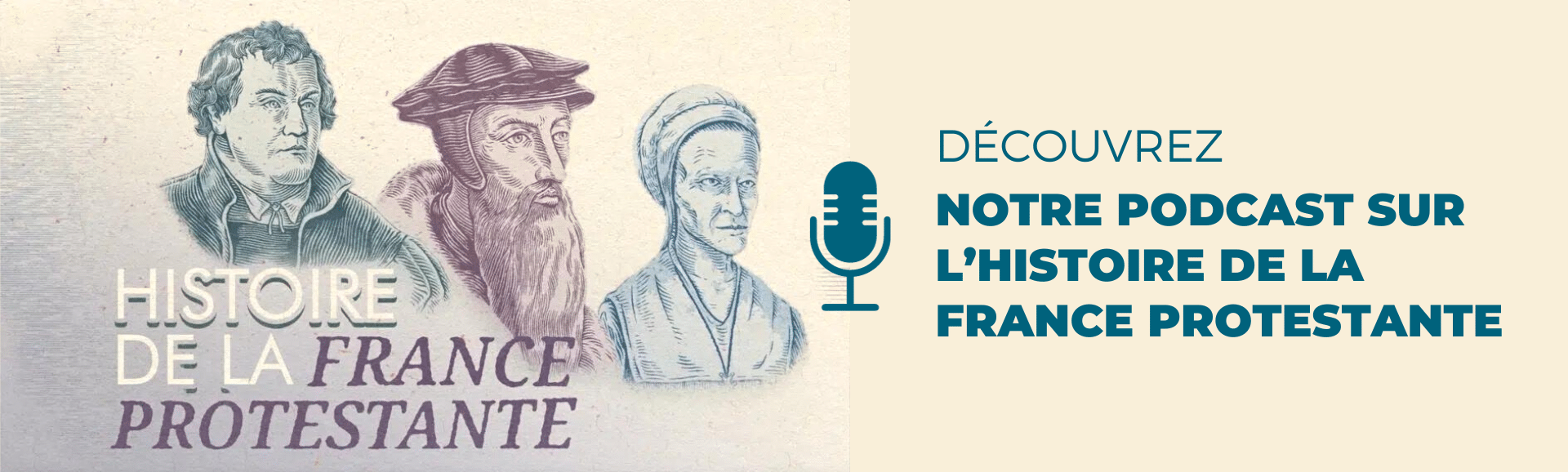Dunkerque, c’est pas le club Med chez Christopher Nolan, mais l’occasion pour lui d’utiliser cette histoire d’évacuation des troupes britanniques et françaises piégées par l’ennemi afin de travailler sur ses thèmes fétiches et aboutir à une œuvre magistrale.
La jetée, une semaine
La mer, un jour
Le ciel, une heure
Après une introduction qui nous plante le décor d’un combat où l’ennemi est invisible mais tout-puissant et des soldats qui sont pris comme des rats cherchant à s’échapper pour survivre, Christopher Nolan nous fait entrer véritablement dans le film avec ces trois positionnements géographiques et temporels. Dans ces trois décors se jouent alors de multiples histoires qui se font écho, qui se croisent, qui s’entremêlent tout en ne se déroulant pas dans la même échelle de temps. Dis ainsi, on pourrait s’inquiéter qu’une certaine complexité apparaisse mais c’est au contraire un élément de force qui apporte un rythme étonnant et qui ajoute à l’histoire en amplifiant cette thématique de la survie qui éclate extraordinairement tout au long du récit.
Christopher Nolan touche au génie dans sa réalisation et ses choix scénaristiques. Pour faire un film de guerre (du moins racontant un épisode d’un guerre), il choisit de ne pas parler du conflit mais de suivre des itinéraires… qui vont d’ailleurs en sens contraires pour une même alternative : s’enfuir et vivre. Alors il y a ceux bien sûr qui veulent quitter la plage par tous les moyens possibles et mais aussi d’autres qui veulent la rejoindre pour les aider ou les transporter. Et qui dit guerre induit aussi camps adverses, et là aussi il y a cet ennemi qui est forcément présent. Présent mais pourtant toujours invisible. Les Allemands n’existent que par leurs balles, par leurs avions mais sans même apercevoir leurs pilotes et donc par une présence quasi fantomatique, tels des rôdeurs dont les ombres entourent la plage. Et le spectateur se retrouve au cœur de l’histoire, lui aussi dans cette impression d’être chassé, de suffoquer que l’eau monte ou que le cockpit de l’avion ne s’ouvre plus… Il vit la fuite comme les soldats et les civils ont pu la vivre et la ressentir. Et dans la survit, c’est le silence qui l’emporte. Les mots sont en trop, superflus, voir perturbants… Alors le film est justement avare de parole. Et Nolan privilégie un regard, un visage, une émotion, une action.
Et puis il y a Hans Zimmer, le Maestro (et habitué du tandem avec Nolan) qui nous livre sans doute l’une de ses plus belles partitions, élément fondamental de Dunkerque. À la fois porteur comme la chape d’une maison en construction, la BO est aussi là l’élément qui relie les unités de temps et les histoires. Une partition quasi unique qui ne semble n’avoir ni commencement, ni fin… mais qui est là et accompagne la douceur, la tension, la joie, la vie, l’espérance ou la mort.
1h47 ! Dans cette indication de durée qui correspond précisément à la longueur de Dunkerque, se joue aussi l’une des réussites de Christopher Nolan. Il ne fait pas trop et terriblement efficace. Juste ce qu’il faut pour développer et couper quand il le faut, filer droit et virevolter au dernier moment comme le fait d’ailleurs un Spitfire dans les airs pour échapper au chasseur ennemi ou le little ship britannique dans la ligne de mire du Stuka allemand. Pas de superflus, de bons sentiments, de larmes ou de rires qui n’ont pas leurs places dans cette histoire. C’est à l’économie que Nolan travaille question émotions, du moins économie visible car on est loin d’être en manque, mais c’est à l’intérieur que tout se passe, au fond des tripes des acteurs… comme dans celles des spectateurs.