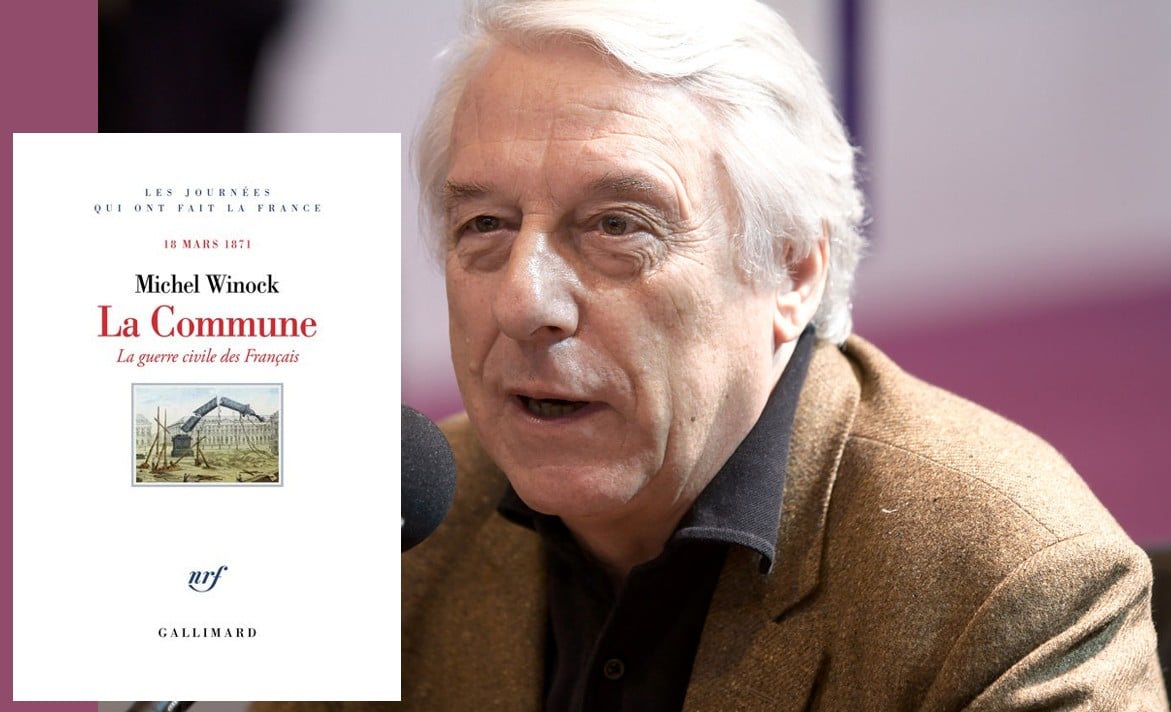Le grand homme est d’abord un enfant. La Domus de Rome, la demeure d’Ajaccio, le septième arrondissement de Paris, c’est tout comme : un écrin de songes où déposer son désir, où faire naître une ambition, s’inventer un avenir. Avec ça, le hasard, les têtes qui tombent, les promis qui s’évanouissent et les cartes enfin redistribuées. La chance. Le grand homme – attention, de nos jours, il ne faut pas manquer de le dire – est aussi grande femme. Et cependant la roulette est la même, qui distingue Germaine, fille de banquier suisse, plutôt que telle égérie des Lumières, dont l’intelligence est pourtant formidable. Tout n’est donc pas prémédité. Voilà pourquoi nous émeut le nouveau livre de l’historienne Hélène Harter, « Eisenhower, le chef de guerre devenu président » (Tallandier, 510 p. 25,90 €).
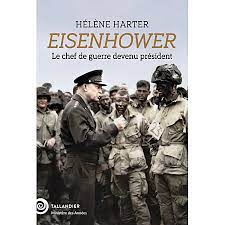
Ce n’est pas seulement le portrait d’un militaire peu conforme et d’un président subtil qui nous est proposé, mais le récit bouleversant d’une ascension fondée sur des principes, une forme de souplesse, un sens de l’aventure collective. A chaque page ou presque, on murmure en soi : « quel magnifique personnage ».
« Eisenhower est né le 14 octobre 1890 dans une famille nombreuse et nous savons qu’il a d’emblée manifesté pour l’Histoire une intense passion, nous explique Hélène Harter. Il possédait de très nombreux ouvrages portant sur l’Antiquité grecque et romaine. Et si nombre de garçons de sa génération se laissaient captiver par la relation des batailles – nous n’étions pas loin de la Guerre de Sécession, l’Espagne et les Etats Unis se faisaient la guerre – Eisenhower dévorait des livres plus que les autres, une façon pour lui d’ouvrir une porte sur le monde. »
Un véritable coach de football
Chacun son génie. Celui de notre homme résidait dans sa capacité à faire jouer des types ensemble sur un terrain de football américain. Oui, vous avez bien lu. C’est même l’une des raisons qui lui firent présenter le concours d’entrée de l’académie militaire de West Point : il avait la certitude, là-bas, de pouvoir pratiquer son sport préféré, mieux encore d’entraîner ses camarades et de les faire gagner. « C’était un coach, analyse Hélène Harter. Il disait lui-même que l’armée peut être commandée comme une équipe de foot : il faut motiver les soldats, donner du sens à leur mission – savoir pourquoi on se bat, la défense de la démocratie, les principes et les valeurs qui s’y rattachent – faire tenir le collectif. Eisenhower n’était pas le chef de guerre du coup d’éclat, mais l’homme qui savait gérer la logistique, préparer des plans de batailles, et tisser des liens diplomatiques avec des responsables politiques de toutes sortes. »
On pourrait dire de lui qu’il était là au bon moment. Mais cette expression masque bien des incertitudes. Oui, Dwight Eisenhower avait été préparé, par les différentes responsabilités qu’il avait exercées durant les années vingt et trente, à conduire la coalition dont il fut le chef contre les troupes nazies. Cela ne doit pas nous faire oublier la somme des situations qui ne dépendaient ni de sa volonté, ni de son talent, qui lui permirent à de si hautes fonctions.
Devenu président des Etats-Unis, le général Eisenhower ne s’est pas départi de ce qui l’avait toujours guidé : la fermeté des convictions, la patience et la détermination face à l’adversité, l’esprit d’équipe.
Contre Joe Mc Carthy, sénateur déchaîné voyant des communistes partout, contre la ségrégation raciale, Eisenhower a soutenu la justice.
A petit pas, mais à coup sûr, d’une manière plus efficace en tout cas que celle de son successeur, playboy prometteur et chef d’Etat pusillanime. On ne doit pas non plus négliger son action en faveur de la paix. Certes, elle impliquait le renforcement de l’hégémonie américaine et menaçait la souveraineté des autres nations. Mais dans cette aventure, Eisenhower portait le plus haut possible la lumière de son propre pays. Qui songerait à lui reprocher ? Pas même Charles de Gaulle, opposant de toujours quand il s’agissait des intérêts supérieurs de la France.
Une religiosité profonde
Eisenhower n’était pas un saint. Lucide, il n’a jamais prétendu l’être. Sa religiosité même a suivi des chemins de traverse. Elle n’en était pas moins profonde. « On peut dire que, durant ses jeunes années, Dwight Eisenhower se situait à la marge de la société américaine, estime Hélène Harter. Il avait grandi dans un milieu mennonite mais sa mère, à la suite de la perte d’un fils, avait choisi de rejoindre les Témoins de Jéhovah. Nous ne savons pas tout de son parcours intérieur, parce qu’Eisenhower parlait peu, et surtout très peu de lui-même. Il est probable que c’est l’expérience de la guerre – en particulier la découverte des camps d’extermination – qui l’a conduit à se faire baptiser protestant au début des années cinquante. Une aventure intérieure soutenue par les pasteurs, avec lesquels, au fil des années, le général avait noué un dialogue régulier. »
L’ouvrage d’Hélène Harter nous donne à comprendre que c’est l’être, plus que le paraître, qui permit au général Eisenhower de réaliser de si grandes choses. Chaque fois qu’il eut à choisir un chemin, il se détermina selon ce qu’il croyait de la façon la plus intense. A cent lieues d’un Mac Arthur ou d’un Patton, il détestait l’épate, avec un sens très sûr des altitudes. En ce sens, il était admirable. Un moment clé nous le révèle. Quand l’état-major de la Wehrmacht est venu reconnaître sa défaite, les équipes d’Eisenhower ont rédigé des projets de communiqué triomphants, lyriques, éclairés de gloire. Le petit gars du Kansas a balayé tout cela et rédigé ceci : « La mission de cette force alliée a été remplie le 7 mai 1945 à 2 h 41 heure locale. » La grandeur ne supporte que la simplicité.