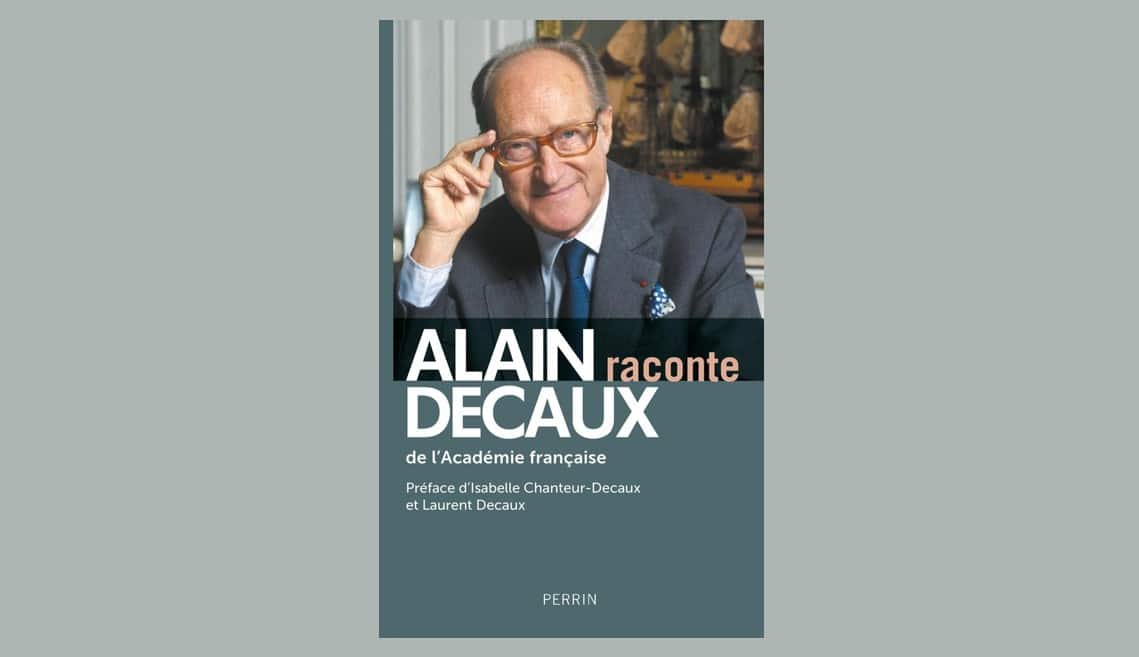A l’automne 1972, Aragon dominait. Ne s’embarrassant plus de rien depuis la mort d’Elsa, le grand homme de nos lettres- on aurait presque pu dire, à quelques mois près, des Lettres Françaises- avait des idées sur les étoffes : en couleurs, à fleurs, et les cheveux battant la Campagne-Première. Mais pendant ce temps-là, depuis le royaume des morts, un génie travaillait sans relâche à l’éclat de sa gloire. Aujourd’hui, Proust occupe le sommet du pavé tandis que l’étoile d’Aurélien paraît pâle à beaucoup. La mémoire collective a jugé.
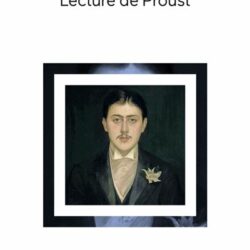
« l’œuvre de Proust n’est pas de celles qui souhaitent dissimuler leur secret. Fidèle à cette auto-contemplation où elle voit le signe de la modernité artistique, elle prend conscience en marchant de sa propre démarche. Les dernières pages du Temps retrouvé contiennent la justification et l’explication de l’entreprise.»
L’incorrigible Marcel faisait littérature de tout. C’est la raison pour laquelle sa correspondance, un océan dont on peine à deviner l’étendue, réserve tant de surprises. Les 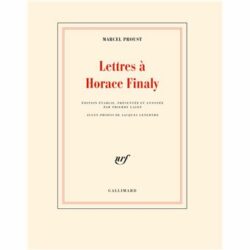
Pourquoi ? Comment ? Mystère encore. Mais il est une réalité que nul ne peut contester : par sa mère, Proust était juif. Et c’est bel et bien le sujet du nouveau livre d’Antoine Compagnon, 
« Il n’y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter, le long de la rue du Repos, le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu’il n’avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents.»
Bien que fidèle à son baptême catholique, l’écrivain s’est engagé de façon fervente en faveur du capitaine Dreyfus et demeura fidèle à la foi de ses ancêtres maternels. En suivant Compagnon, nous comprenons qu’il fut même très instruit des Textes.
Un après-midi, l’auteur de ces lignes, installé sur un banc, relisait Du côté de Guermantes, quand un loubavitch, en souriant, s’approcha, puis, désignant le nom de l’écrivain, déclara: « Celui-là, il est à nous.» Presque aussitôt l’homme de piété développa tout un argumentaire où la judéité de Proust était mise en lumière. C’était il y a trente ans peut-être, au parc des Buttes-Chaumont.
Les Buttes-Chaumont ? D’y songer nous fait revivre des pages oubliées.
« Parmi les forces naturelles, il en est une, de laquelle le pouvoir reconnu de tout temps reste en tout temps mystérieux, et tout mêlé à l’homme : c’est la nuit. Cette grande illusion noire suit la mode, et les variations sensibles des esclaves. La nuit de nos villes ne ressemble plus à cette clameur des chiens des ténèbres latines, ni à la Chauve-souris du Moyen Âge, ni à cette image des douleurs qui est la nuit de la Renaissance. C’est un monstre immense de tôle, percé mille fois de couteaux.»
Louis Aragon, de nouveau !
Qu’importent les antagonismes de la postérité. La littérature, en bonne louve, invite à prendre nos désirs pour des réalités. N’est ce pas le chemin qui mène à l’amour ?